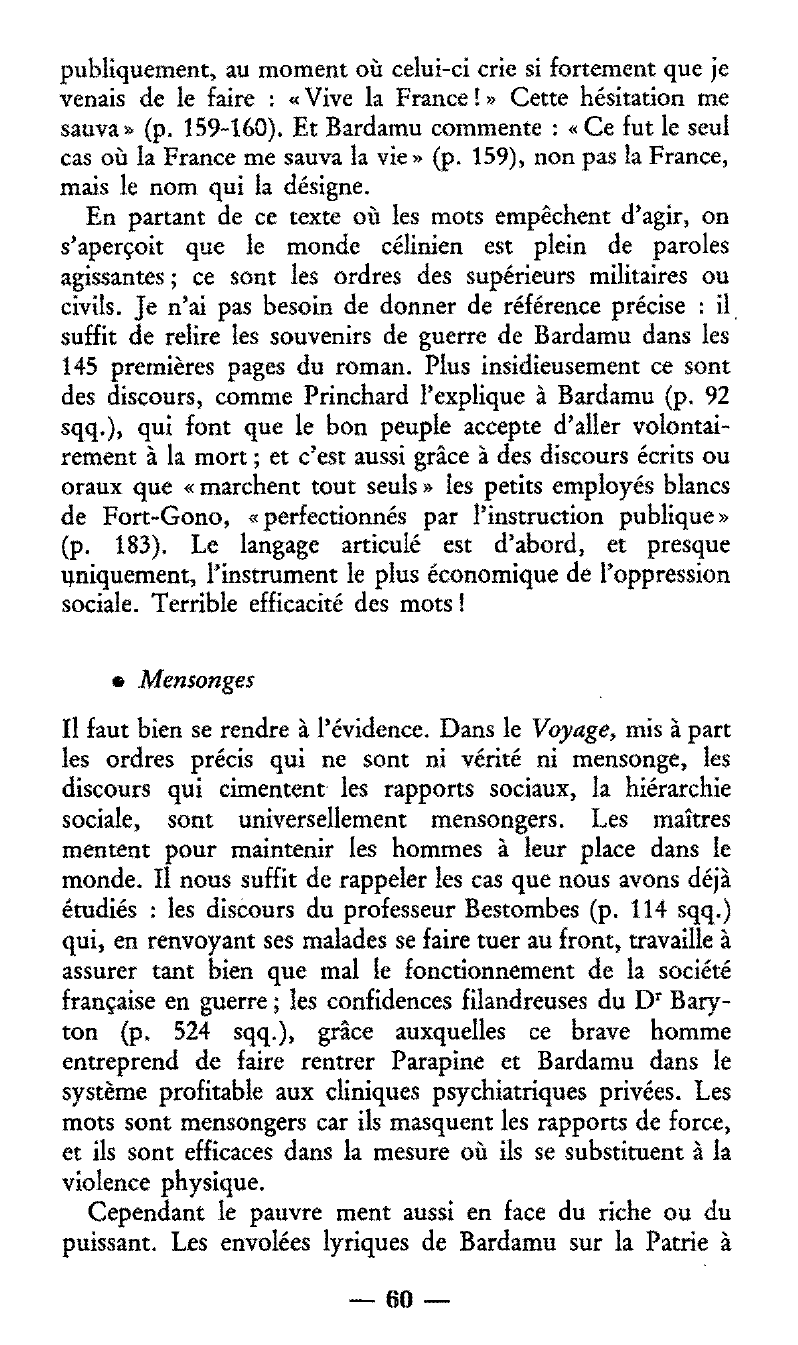Céline et le langage
Publié le 23/01/2020

Extrait du document

• La langue populaire
Au premier abord le lecteur a le sentiment que la langue de Céline est la langue parlée populaire, et plus précisément la langue populaire parisienne. J’avoue à ma honte qu’en 1939 je n’avais pas encore lu le Voyage; j’ai donc découvert Céline pendant la drôle de guerre et je retrouvais avec délices dans ces pages la langue de mon régiment composé presque entièrement de Parisiens. Disons tout de suite que la langue du roman ne doit pas grand-chose à l’argot; tout le monde l’admet aujourd’hui. En fait, on trouve dans les textes de Céline les mots d’argot qu’adopte et vulgarise la langue populaire d’une métropole.
, Naturellement on a accusé Céline de n’avoir obtenu qu’une fausse langue populaire, reproche qui n’a pas grand sens car la langue populaire est si libre que nul ne peut en définir les normes. D’ailleurs tout le monde est d’accord, et Céline serait le premier à l’être, pour dire que le langage de ses œuvres n’est pas un langage parlé. M. Marc Hanrez, dans son Céline', l’a affirmé et a bien montré qu’on ne pouvait en faire grief à l’écrivain. Indiquons, pour abréger, que l’on trouvera dans ce petit livre l’étude la plus complète et la meilleure sur la langue et le style de Céline. Je ne puis qu’y renvoyer. Toutefois, je ne pense pas, comme le dit M. Hanrez, que la syntaxe de Céline soit le fruit d’une distorsion du français réputé correct. En mettant avec raison l’accent sur ce qu’a d’élaboré la phrase célinienne, M. Hanrez néglige le fait que tous les procédés dont il attribue l’invention au romancier sont tirés du parler populaire parisien : par exemple, M. Hanrez cite1 2 une phrase extraite de Normance : «Ils insistent tous que je boive chaud » où pour n’a pas disparu, comme le croit M. Hanrez, mais où Céline retrouve seulement un trait de la syntaxe populaire qui ne connaît guère qu’un subordonnant : que. Il est certain qu’écrire une pareille phrase suppose beaucoup de travail pour un homme qui, sous l’influence de son milieu familial et de ses études universitaires, devait normalement employer la langue offi
bord de l'Amiral Bragueton sont des mensonges. Sont des mensonges les calembredaines héroïques du sergent Brande-lore (p. 119), les imprécations de la mère dont la fille s’est fait avorter (p. 330 sqq.), les vantardises de Robinson et de Bardamu dans le salon de la péniche (p. 508 sqq.) : « La vérité ne demande qu’à vous quitter», dit Bardamu (p. 509). C’est qu’il faut jouer le jeu si l’on veut garder sa place dans le monde ou s’y insérer et y survivre. Brandelore, à grand renfort de tirades patriotiques, évitera, quoi qu’il arrive, de passer devant le Conseil de guerre ; la mère, qui affirme, que le déshonneur de sa fille la tuera, s’agrippe au rang social qu’elle croit avoir atteint ; Robinson et Bardamu espèrent être traités sur pied d’égalité par les riches bourgeois qui les reçoivent : « On en sort des humiliations quotidiennes en essayant comme Robinson de se mettre à l’unisson des gens riches, par des mensonges, ces monnaies du pauvre» (p. 509-510). Ces mensonges sont peut-être pardonnables, ils ne sont ni pieux ni touchants ; ils sont un des pires malheurs de la condition du pauvre, car on n’a pas toujours le courage de refuser les appâts de la société.
• Bavardages et injures
Il arrive cependant qu’on ne mente pas dans le Voyage au bout de la nuit. Nous avons déjà parlé des rencontres entre deux pauvres, amis ou camarades. Pourquoi alors mentir puisqu’on voit la vie du même point de vue et que celui qui parle ne cherche pas à contraindre celui qui écoute ? Et nous avions noté le plaisir que semblent prendre les interlocuteurs à leur conversation. Mais il faut appeler les choses par leur nom : c’est purement et simplement du bavardage : bavardage de Bardamu avec Arthur Ganate, avec Princhard, avec Parapine. Le langage fonctionne alors à vide. Il faut aussi faire une place spéciale aux injures, qui n’ont pas toujours un objet précis dans notre roman. Le matin, quand on va travailler, « on s’engueule dans le tramway déjà un bon coup pour se faire la bouche. Les femmes sont plus râleuses encore que des moutards » (p. 305). Au temps où il écrivait le Voyage, Céline semble s’être contenté de reproduire ces échanges d’insultes, sans y voir, semble-t-il, autre chose qu’une sorte de rage

«
publiquement, au moment où celui-ci crie si fortement que je
venais de le faire : «Vive la France ! » Cette hésitation me
sauva» (p.
159-160).
Et Bardamu commente : «Ce fut le seul
cas où la France me sauva la vie» (p.
159), non pas la France,
mais le nom qui la désigne.
En partant de ce texte où les mots empêchent d'agir, on
s'aperçoit que le monde célinien est plein de paroles
agissantes ; ce sont les ordres des supérieurs militaires ou
civils.
Je n'ai pas besoin de donner de référence précise : il,
suffit de relire les souvenirs de guerre de Bardamu dans les
145 premières pages du roman.
Plus insidieusement ce sont
des discours, comme Princhard l'explique à Bardamu (p.
92
sqq.), qui font que le bon peuple accepte d'aller volontai
rement à la mort; et c'est aussi grâce à des discours écrits ou
oraux que «marchent tout seuls» les petits employés blancs
de Fort-Gono, «perfectionnés par l'instruction publique»
(p.
183).
Le langage articulé est d'abord, et presque
l),niquement, l'instrument le plus économique de l'oppression
sociale.
Terrible efficacité des mots!
• Mensonges
Il faut bien se rendre à l'évidence.
Dans le Voyage, mis à part
les ordres précis qui ne sont ni vérité ni mensonge, les
discours qui cimentent les rapports sociaux, la hiérarchie
sociale, sont universellement mensongers.
Les maîtres
mentent pour maintenir les hommes à leur place dans le
monde.
Il nous suffit de rappeler les cas que nous avons déjà
étudiés : les discours du professeur Bestombes (p.
114 sqq.)
qui, en renvoyant ses malades se faire tuer au front, travaille à
assurer tant bien que mal le fonctionnement de la société
française en guerre; les confidences filandreuses du D' Bary
ton (p.
524 sqq.), grâce auxquelles ce brave homme
entreprend de faire rentrer Pa.rapine et Bardamu dans le
système profitable aux cliniques psychiatriques privées.
Les
mots sont mensongers car ils masquent les rapports de force,
et ils sont efficaces dans la mesure où ils se substituent à la
violence physique.
Cependant le pauvre ment aussi en face du riche ou du
puissant.
Les envolées lyriques de Bardamu sur la Patrie à
-60-.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Céline et le langage - Voyage au bout de la nuit (Céline)
- Céline, le langage du blasphème et du refus.
- LES BALISAGES DU LANGAGE HTML
- Le langage – cours
- HdA au Brevet 3e1 Objet d’étude : Arts et progrès techniques Thématique Domaine Période Arts, rupture et continuité Art du langage XXe siècle