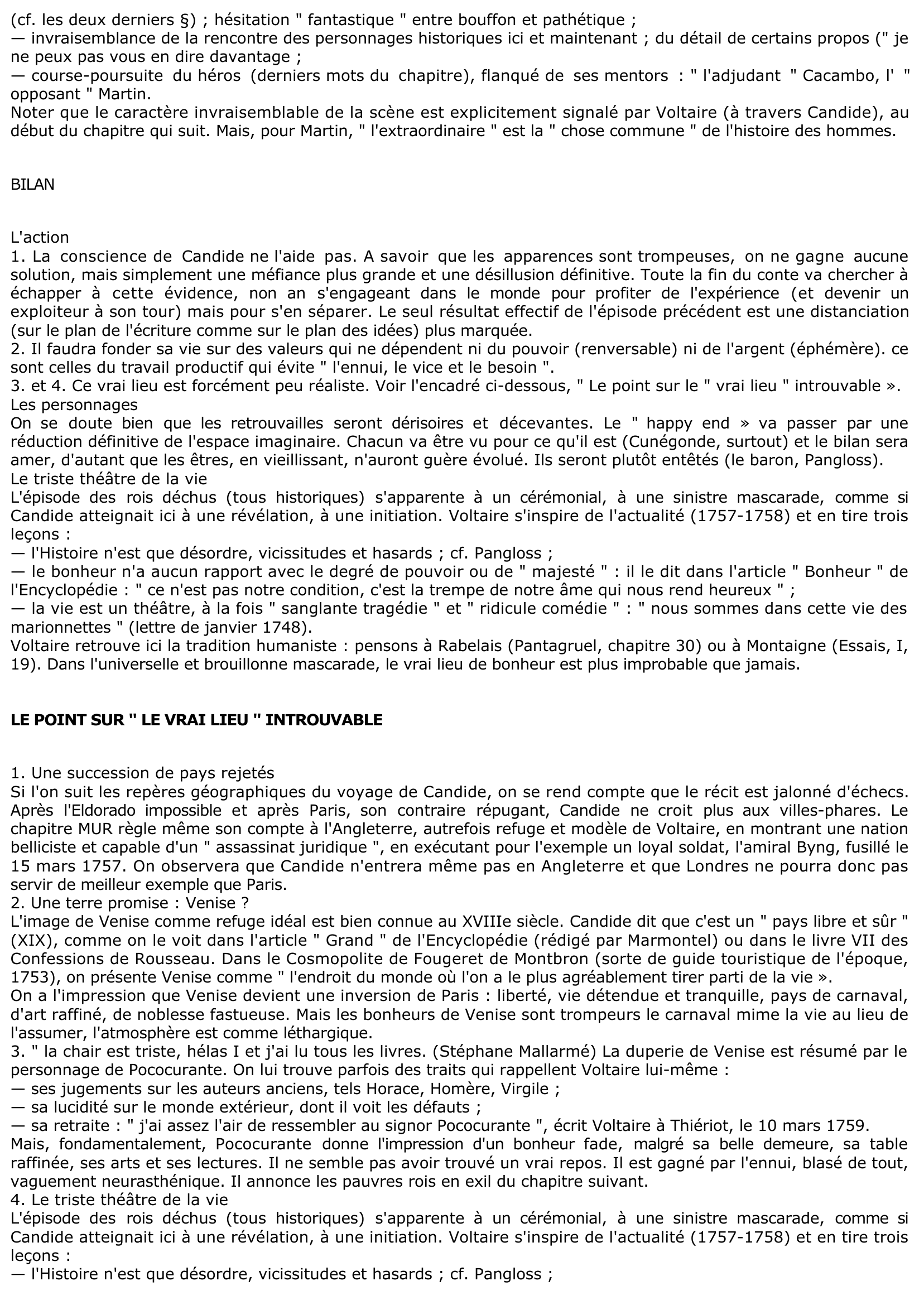CHAPITRE 26 de CANDIDE DE VOLTAIRE (lecture analytique)
Publié le 17/06/2011

Extrait du document

COMPRÉHENSION
1. Voltaire veut éviter que le lecteur se laisse prendre à une impression de réalisme historique. Certes, il utilise de l'actualité contemporaine, avec une certaine précision, mais les personnages ici présentés n'appartiennent pas exactement aux mêmes lieux et au même temps : leur rencontre est totalement invraisemblable. La répétition de la même histoire permet : — d'éviter que nous nous intéressions à chaque cas comme s'il faisait exception, comme s'il était une " ratée " de l'histoire, comme s'il s'agissait de faits divers ; — de révéler une vérité qui dépasse les cas particuliers : ces personnages obéissent à une fonctionnalité, ils illustrent la mascarade des destins, de tous les destins. On a ainsi un va-et-vient entre la véracité historique et l'imagination qui utilise le fait authentique pour faire prendre l'essor à la pensée philosophique, qui transcende le cas particulier pour aboutir à une vérité universelle.

«
(cf.
les deux derniers §) ; hésitation " fantastique " entre bouffon et pathétique ;— invraisemblance de la rencontre des personnages historiques ici et maintenant ; du détail de certains propos (" jene peux pas vous en dire davantage ;— course-poursuite du héros (derniers mots du chapitre), flanqué de ses mentors : " l'adjudant " Cacambo, l' "opposant " Martin.Noter que le caractère invraisemblable de la scène est explicitement signalé par Voltaire (à travers Candide), audébut du chapitre qui suit.
Mais, pour Martin, " l'extraordinaire " est la " chose commune " de l'histoire des hommes.
BILAN
L'action1.
La conscience de Candide ne l'aide pas.
A savoir que les apparences sont trompeuses, on ne gagne aucunesolution, mais simplement une méfiance plus grande et une désillusion définitive.
Toute la fin du conte va chercher àéchapper à cette évidence, non an s'engageant dans le monde pour profiter de l'expérience (et devenir unexploiteur à son tour) mais pour s'en séparer.
Le seul résultat effectif de l'épisode précédent est une distanciation(sur le plan de l'écriture comme sur le plan des idées) plus marquée.2.
Il faudra fonder sa vie sur des valeurs qui ne dépendent ni du pouvoir (renversable) ni de l'argent (éphémère).
cesont celles du travail productif qui évite " l'ennui, le vice et le besoin ".3.
et 4.
Ce vrai lieu est forcément peu réaliste.
Voir l'encadré ci-dessous, " Le point sur le " vrai lieu " introuvable ».Les personnagesOn se doute bien que les retrouvailles seront dérisoires et décevantes.
Le " happy end » va passer par uneréduction définitive de l'espace imaginaire.
Chacun va être vu pour ce qu'il est (Cunégonde, surtout) et le bilan seraamer, d'autant que les êtres, en vieillissant, n'auront guère évolué.
Ils seront plutôt entêtés (le baron, Pangloss).Le triste théâtre de la vieL'épisode des rois déchus (tous historiques) s'apparente à un cérémonial, à une sinistre mascarade, comme siCandide atteignait ici à une révélation, à une initiation.
Voltaire s'inspire de l'actualité (1757-1758) et en tire troisleçons :— l'Histoire n'est que désordre, vicissitudes et hasards ; cf.
Pangloss ;— le bonheur n'a aucun rapport avec le degré de pouvoir ou de " majesté " : il le dit dans l'article " Bonheur " del'Encyclopédie : " ce n'est pas notre condition, c'est la trempe de notre âme qui nous rend heureux " ;— la vie est un théâtre, à la fois " sanglante tragédie " et " ridicule comédie " : " nous sommes dans cette vie desmarionnettes " (lettre de janvier 1748).Voltaire retrouve ici la tradition humaniste : pensons à Rabelais (Pantagruel, chapitre 30) ou à Montaigne (Essais, I,19).
Dans l'universelle et brouillonne mascarade, le vrai lieu de bonheur est plus improbable que jamais.
LE POINT SUR " LE VRAI LIEU " INTROUVABLE
1.
Une succession de pays rejetésSi l'on suit les repères géographiques du voyage de Candide, on se rend compte que le récit est jalonné d'échecs.Après l'Eldorado impossible et après Paris, son contraire répugant, Candide ne croit plus aux villes-phares.
Lechapitre MUR règle même son compte à l'Angleterre, autrefois refuge et modèle de Voltaire, en montrant une nationbelliciste et capable d'un " assassinat juridique ", en exécutant pour l'exemple un loyal soldat, l'amiral Byng, fusillé le15 mars 1757.
On observera que Candide n'entrera même pas en Angleterre et que Londres ne pourra donc passervir de meilleur exemple que Paris.2.
Une terre promise : Venise ?L'image de Venise comme refuge idéal est bien connue au XVIIIe siècle.
Candide dit que c'est un " pays libre et sûr "(XIX), comme on le voit dans l'article " Grand " de l'Encyclopédie (rédigé par Marmontel) ou dans le livre VII desConfessions de Rousseau.
Dans le Cosmopolite de Fougeret de Montbron (sorte de guide touristique de l'époque,1753), on présente Venise comme " l'endroit du monde où l'on a le plus agréablement tirer parti de la vie ».On a l'impression que Venise devient une inversion de Paris : liberté, vie détendue et tranquille, pays de carnaval,d'art raffiné, de noblesse fastueuse.
Mais les bonheurs de Venise sont trompeurs le carnaval mime la vie au lieu del'assumer, l'atmosphère est comme léthargique.3.
" la chair est triste, hélas I et j'ai lu tous les livres.
(Stéphane Mallarmé) La duperie de Venise est résumé par lepersonnage de Pococurante.
On lui trouve parfois des traits qui rappellent Voltaire lui-même :— ses jugements sur les auteurs anciens, tels Horace, Homère, Virgile ;— sa lucidité sur le monde extérieur, dont il voit les défauts ;— sa retraite : " j'ai assez l'air de ressembler au signor Pococurante ", écrit Voltaire à Thiériot, le 10 mars 1759.Mais, fondamentalement, Pococurante donne l'impression d'un bonheur fade, malgré sa belle demeure, sa tableraffinée, ses arts et ses lectures.
Il ne semble pas avoir trouvé un vrai repos.
Il est gagné par l'ennui, blasé de tout,vaguement neurasthénique.
Il annonce les pauvres rois en exil du chapitre suivant.4.
Le triste théâtre de la vieL'épisode des rois déchus (tous historiques) s'apparente à un cérémonial, à une sinistre mascarade, comme siCandide atteignait ici à une révélation, à une initiation.
Voltaire s'inspire de l'actualité (1757-1758) et en tire troisleçons :— l'Histoire n'est que désordre, vicissitudes et hasards ; cf.
Pangloss ;.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Lecture analytique : Chapitre 6 de Candide, Voltaire
- Lecture Analytique Candide, Chapitre 30, Voltaire
- LECTURE ANALYTIQUE CANDIDE, VOLTAIRE: Chapitre III « La guerre »
- CANDIDE , Voltaire : Lecture analytique chapitre I le paradis terrestre
- Lecture analytique du Chapitre 19 de Candide, Voltaire de « en approchant de la ville » jusqu'à « il entra dans Surinam »