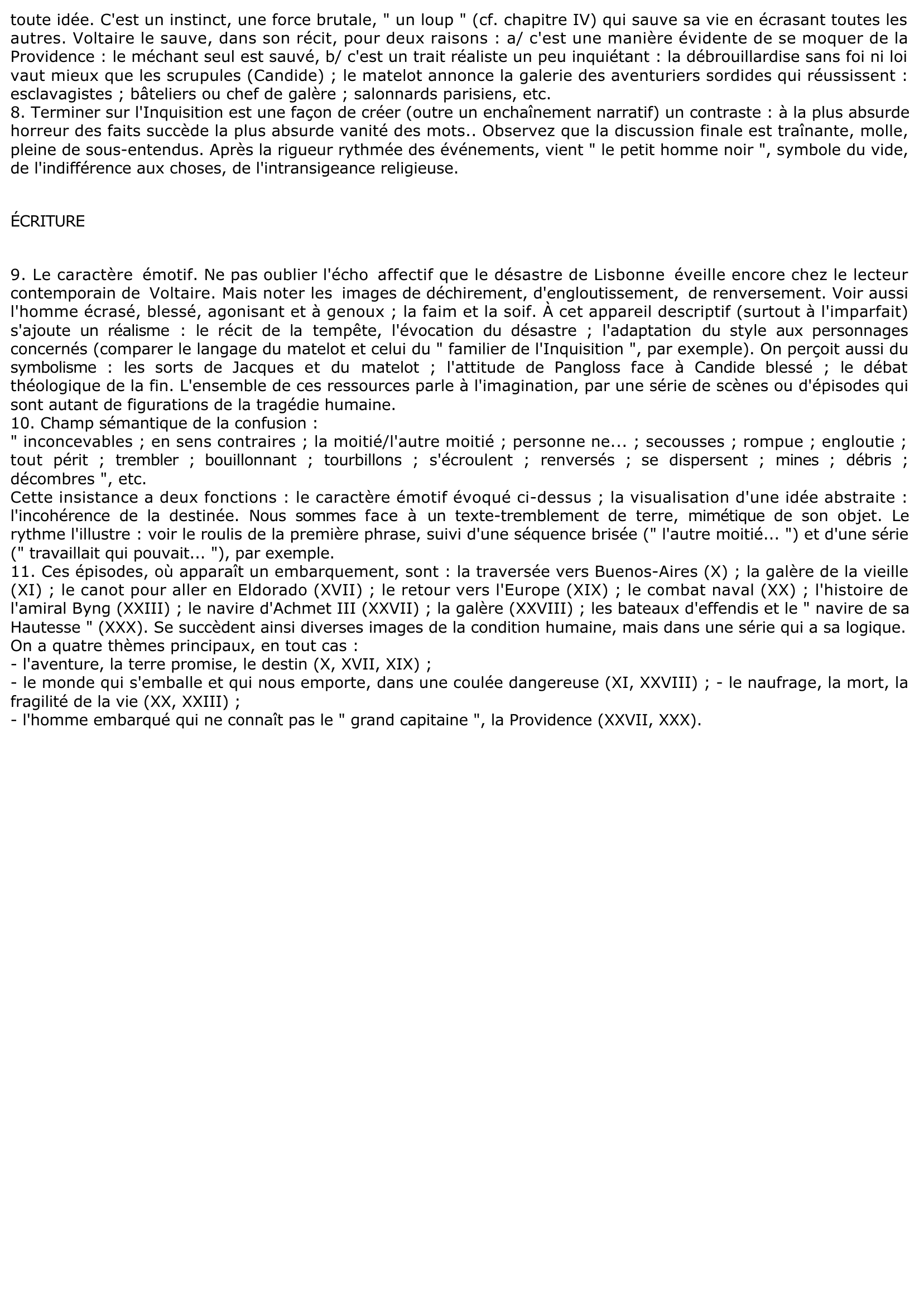CHAPITRE 5 DU CANDIDE DE VOLTAIRE (lecture analytique)
Publié le 16/06/2011
Extrait du document

On retrouve ici des éléments du récit traditionnel : affolement des passagers, cris, prières, le vaisseau qui se brise, le bruit, l'épouvante, les êtres en contraste (Jacques/le matelot ; Pangloss/Candide) face au danger, la noyade, le sauvetage du héros et sa blessure, etc. Le récit ne comporte pas de commentaires et évite le pittoresque (voir la neutralité des adjectifs, peu " picturaux ") : Voltaire accumule les substantifs et les verbes, présentant des choses et des faits. Cette sobriété a une double valeur : une parodie ; une démonstration. La parodie suppose une culture du lecteur qui participera ainsi à une critique du romanesque ; elle repose sur un " compactage " et une accélération, comme un film qui se déroule trop vite et où tout devient saccadé et rythmé. La démonstration procède du même moyen : le monde devient agité et absurde, sans principe de causalité et sans que les êtres aient le temps d'évoluer par eux-mêmes.

«
toute idée.
C'est un instinct, une force brutale, " un loup " (cf.
chapitre IV) qui sauve sa vie en écrasant toutes lesautres.
Voltaire le sauve, dans son récit, pour deux raisons : a/ c'est une manière évidente de se moquer de laProvidence : le méchant seul est sauvé, b/ c'est un trait réaliste un peu inquiétant : la débrouillardise sans foi ni loivaut mieux que les scrupules (Candide) ; le matelot annonce la galerie des aventuriers sordides qui réussissent :esclavagistes ; bâteliers ou chef de galère ; salonnards parisiens, etc.8.
Terminer sur l'Inquisition est une façon de créer (outre un enchaînement narratif) un contraste : à la plus absurdehorreur des faits succède la plus absurde vanité des mots..
Observez que la discussion finale est traînante, molle,pleine de sous-entendus.
Après la rigueur rythmée des événements, vient " le petit homme noir ", symbole du vide,de l'indifférence aux choses, de l'intransigeance religieuse.
ÉCRITURE
9.
Le caractère émotif.
Ne pas oublier l'écho affectif que le désastre de Lisbonne éveille encore chez le lecteurcontemporain de Voltaire.
Mais noter les images de déchirement, d'engloutissement, de renversement.
Voir aussil'homme écrasé, blessé, agonisant et à genoux ; la faim et la soif.
À cet appareil descriptif (surtout à l'imparfait)s'ajoute un réalisme : le récit de la tempête, l'évocation du désastre ; l'adaptation du style aux personnagesconcernés (comparer le langage du matelot et celui du " familier de l'Inquisition ", par exemple).
On perçoit aussi dusymbolisme : les sorts de Jacques et du matelot ; l'attitude de Pangloss face à Candide blessé ; le débatthéologique de la fin.
L'ensemble de ces ressources parle à l'imagination, par une série de scènes ou d'épisodes quisont autant de figurations de la tragédie humaine.10.
Champ sémantique de la confusion :" inconcevables ; en sens contraires ; la moitié/l'autre moitié ; personne ne...
; secousses ; rompue ; engloutie ;tout périt ; trembler ; bouillonnant ; tourbillons ; s'écroulent ; renversés ; se dispersent ; mines ; débris ;décombres ", etc.Cette insistance a deux fonctions : le caractère émotif évoqué ci-dessus ; la visualisation d'une idée abstraite :l'incohérence de la destinée.
Nous sommes face à un texte-tremblement de terre, mimétique de son objet.
Lerythme l'illustre : voir le roulis de la première phrase, suivi d'une séquence brisée (" l'autre moitié...
") et d'une série(" travaillait qui pouvait...
"), par exemple.11.
Ces épisodes, où apparaît un embarquement, sont : la traversée vers Buenos-Aires (X) ; la galère de la vieille(XI) ; le canot pour aller en Eldorado (XVII) ; le retour vers l'Europe (XIX) ; le combat naval (XX) ; l'histoire del'amiral Byng (XXIII) ; le navire d'Achmet III (XXVII) ; la galère (XXVIII) ; les bateaux d'effendis et le " navire de saHautesse " (XXX).
Se succèdent ainsi diverses images de la condition humaine, mais dans une série qui a sa logique.On a quatre thèmes principaux, en tout cas :- l'aventure, la terre promise, le destin (X, XVII, XIX) ;- le monde qui s'emballe et qui nous emporte, dans une coulée dangereuse (XI, XXVIII) ; - le naufrage, la mort, lafragilité de la vie (XX, XXIII) ;- l'homme embarqué qui ne connaît pas le " grand capitaine ", la Providence (XXVII, XXX)..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Lecture analytique : Chapitre 6 de Candide, Voltaire
- Lecture Analytique Candide, Chapitre 30, Voltaire
- LECTURE ANALYTIQUE CANDIDE, VOLTAIRE: Chapitre III « La guerre »
- CANDIDE , Voltaire : Lecture analytique chapitre I le paradis terrestre
- Lecture analytique du Chapitre 19 de Candide, Voltaire de « en approchant de la ville » jusqu'à « il entra dans Surinam »