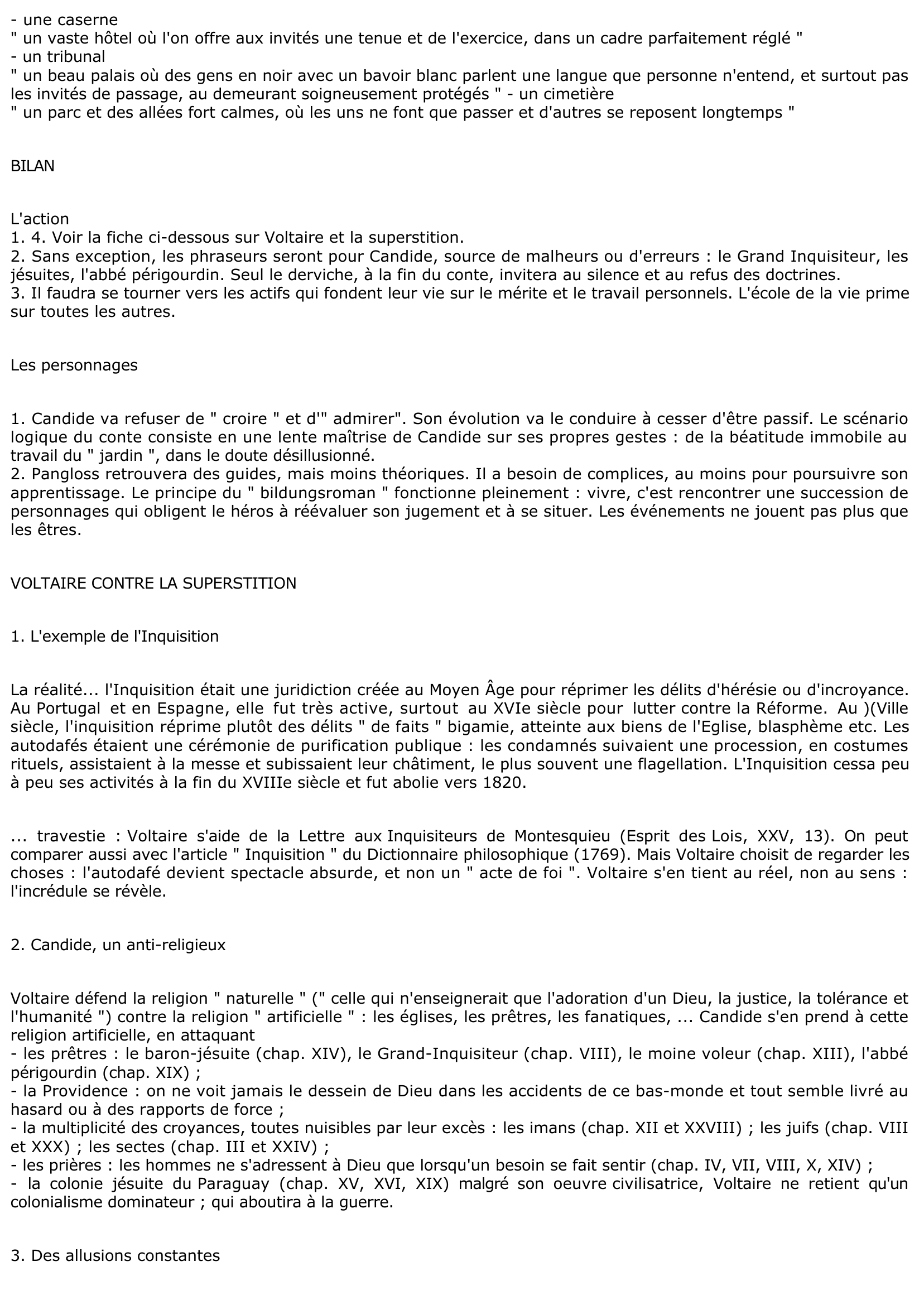CHAPITRE 6 DU CANDIDE DE VOLTAIRE (lecture analytique)
Publié le 16/06/2011
Extrait du document

L'alliance de mots Inadéquats : tous les exemples ci-dessus répondent plus ou moins à cette technique. Mais noter aussi le burlesque qui fait employer des termes bas ou aimables pour des sujets gravés : Candide " fessé en cadence pendant qu'on chantait " ; le détail des exécutions (brûlés/pendu " quoique ce ne fût pas la coutume ") ; " perle des filles/fendu le ventre etc.

«
- une caserne" un vaste hôtel où l'on offre aux invités une tenue et de l'exercice, dans un cadre parfaitement réglé "- un tribunal" un beau palais où des gens en noir avec un bavoir blanc parlent une langue que personne n'entend, et surtout pasles invités de passage, au demeurant soigneusement protégés " - un cimetière" un parc et des allées fort calmes, où les uns ne font que passer et d'autres se reposent longtemps "
BILAN
L'action1.
4.
Voir la fiche ci-dessous sur Voltaire et la superstition.2.
Sans exception, les phraseurs seront pour Candide, source de malheurs ou d'erreurs : le Grand Inquisiteur, lesjésuites, l'abbé périgourdin.
Seul le derviche, à la fin du conte, invitera au silence et au refus des doctrines.3.
Il faudra se tourner vers les actifs qui fondent leur vie sur le mérite et le travail personnels.
L'école de la vie primesur toutes les autres.
Les personnages
1.
Candide va refuser de " croire " et d'" admirer".
Son évolution va le conduire à cesser d'être passif.
Le scénariologique du conte consiste en une lente maîtrise de Candide sur ses propres gestes : de la béatitude immobile autravail du " jardin ", dans le doute désillusionné.2.
Pangloss retrouvera des guides, mais moins théoriques.
Il a besoin de complices, au moins pour poursuivre sonapprentissage.
Le principe du " bildungsroman " fonctionne pleinement : vivre, c'est rencontrer une succession depersonnages qui obligent le héros à réévaluer son jugement et à se situer.
Les événements ne jouent pas plus queles êtres.
VOLTAIRE CONTRE LA SUPERSTITION
1.
L'exemple de l'Inquisition
La réalité...
l'Inquisition était une juridiction créée au Moyen Âge pour réprimer les délits d'hérésie ou d'incroyance.Au Portugal et en Espagne, elle fut très active, surtout au XVIe siècle pour lutter contre la Réforme.
Au )(Villesiècle, l'inquisition réprime plutôt des délits " de faits " bigamie, atteinte aux biens de l'Eglise, blasphème etc.
Lesautodafés étaient une cérémonie de purification publique : les condamnés suivaient une procession, en costumesrituels, assistaient à la messe et subissaient leur châtiment, le plus souvent une flagellation.
L'Inquisition cessa peuà peu ses activités à la fin du XVIIIe siècle et fut abolie vers 1820.
...
travestie : Voltaire s'aide de la Lettre aux Inquisiteurs de Montesquieu (Esprit des Lois, XXV, 13).
On peutcomparer aussi avec l'article " Inquisition " du Dictionnaire philosophique (1769).
Mais Voltaire choisit de regarder leschoses : l'autodafé devient spectacle absurde, et non un " acte de foi ".
Voltaire s'en tient au réel, non au sens :l'incrédule se révèle.
2.
Candide, un anti-religieux
Voltaire défend la religion " naturelle " (" celle qui n'enseignerait que l'adoration d'un Dieu, la justice, la tolérance etl'humanité ") contre la religion " artificielle " : les églises, les prêtres, les fanatiques, ...
Candide s'en prend à cettereligion artificielle, en attaquant- les prêtres : le baron-jésuite (chap.
XIV), le Grand-Inquisiteur (chap.
VIII), le moine voleur (chap.
XIII), l'abbépérigourdin (chap.
XIX) ;- la Providence : on ne voit jamais le dessein de Dieu dans les accidents de ce bas-monde et tout semble livré auhasard ou à des rapports de force ;- la multiplicité des croyances, toutes nuisibles par leur excès : les imans (chap.
XII et XXVIII) ; les juifs (chap.
VIIIet XXX) ; les sectes (chap.
III et XXIV) ;- les prières : les hommes ne s'adressent à Dieu que lorsqu'un besoin se fait sentir (chap.
IV, VII, VIII, X, XIV) ;- la colonie jésuite du Paraguay (chap.
XV, XVI, XIX) malgré son oeuvre civilisatrice, Voltaire ne retient qu'uncolonialisme dominateur ; qui aboutira à la guerre.
3.
Des allusions constantes.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Lecture analytique : Chapitre 6 de Candide, Voltaire
- Lecture Analytique Candide, Chapitre 30, Voltaire
- LECTURE ANALYTIQUE CANDIDE, VOLTAIRE: Chapitre III « La guerre »
- CANDIDE , Voltaire : Lecture analytique chapitre I le paradis terrestre
- Lecture analytique du Chapitre 19 de Candide, Voltaire de « en approchant de la ville » jusqu'à « il entra dans Surinam »