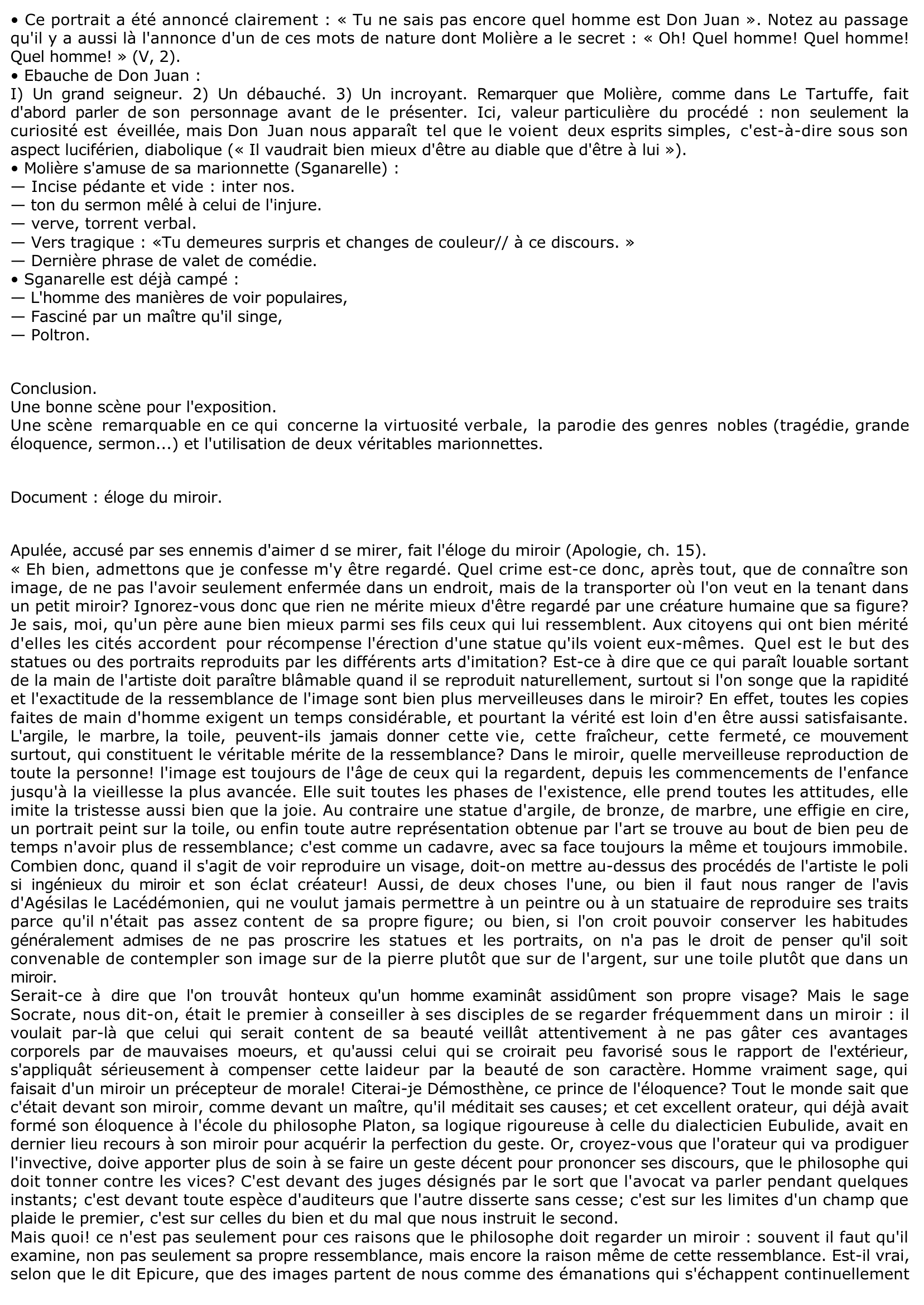Commentaire littéraire de Dom Juan : ACTE I (Molière)
Publié le 03/05/2011

Extrait du document

C'est nécessairement un acte d'exposition : chacune des scènes devra donc être étudiée de ce point de vue (ce qui évidemment n'exclut pas l'existence d'autres aspects intéressants). Ce premier acte est magistral : chaque scène est riche; la scène 2 semble cependant la plus profonde et la plus originale.
SCÈNE 1
Deux valets. Il y aura lieu de rappeler quelques-uns des traits fondamentaux des « gens de maison « au xviie : • La médisance à propos des maîtres (cf. Le roman comique). • La tendance à singer les maîtres, à se donner de l'importance (cf. Les précieuses ridicules, etc.). • Une relative familiarité entre maître et valet (cf. les servantes de Molière! A la fin du XVIIIe siècle, l'Anglais Young sera frappé par ce trait de la domesticité française).

«
• Ce portrait a été annoncé clairement : « Tu ne sais pas encore quel homme est Don Juan ».
Notez au passagequ'il y a aussi là l'annonce d'un de ces mots de nature dont Molière a le secret : « Oh! Quel homme! Quel homme!Quel homme! » (V, 2).• Ebauche de Don Juan :I) Un grand seigneur.
2) Un débauché.
3) Un incroyant.
Remarquer que Molière, comme dans Le Tartuffe, faitd'abord parler de son personnage avant de le présenter.
Ici, valeur particulière du procédé : non seulement lacuriosité est éveillée, mais Don Juan nous apparaît tel que le voient deux esprits simples, c'est-à-dire sous sonaspect luciférien, diabolique (« Il vaudrait bien mieux d'être au diable que d'être à lui »).• Molière s'amuse de sa marionnette (Sganarelle) :— Incise pédante et vide : inter nos.— ton du sermon mêlé à celui de l'injure.— verve, torrent verbal.— Vers tragique : «Tu demeures surpris et changes de couleur// à ce discours.
»— Dernière phrase de valet de comédie.• Sganarelle est déjà campé :— L'homme des manières de voir populaires,— Fasciné par un maître qu'il singe,— Poltron.
Conclusion.Une bonne scène pour l'exposition.Une scène remarquable en ce qui concerne la virtuosité verbale, la parodie des genres nobles (tragédie, grandeéloquence, sermon...) et l'utilisation de deux véritables marionnettes.
Document : éloge du miroir.
Apulée, accusé par ses ennemis d'aimer d se mirer, fait l'éloge du miroir (Apologie, ch.
15).« Eh bien, admettons que je confesse m'y être regardé.
Quel crime est-ce donc, après tout, que de connaître sonimage, de ne pas l'avoir seulement enfermée dans un endroit, mais de la transporter où l'on veut en la tenant dansun petit miroir? Ignorez-vous donc que rien ne mérite mieux d'être regardé par une créature humaine que sa figure?Je sais, moi, qu'un père aune bien mieux parmi ses fils ceux qui lui ressemblent.
Aux citoyens qui ont bien méritéd'elles les cités accordent pour récompense l'érection d'une statue qu'ils voient eux-mêmes.
Quel est le but desstatues ou des portraits reproduits par les différents arts d'imitation? Est-ce à dire que ce qui paraît louable sortantde la main de l'artiste doit paraître blâmable quand il se reproduit naturellement, surtout si l'on songe que la rapiditéet l'exactitude de la ressemblance de l'image sont bien plus merveilleuses dans le miroir? En effet, toutes les copiesfaites de main d'homme exigent un temps considérable, et pourtant la vérité est loin d'en être aussi satisfaisante.L'argile, le marbre, la toile, peuvent-ils jamais donner cette vie, cette fraîcheur, cette fermeté, ce mouvementsurtout, qui constituent le véritable mérite de la ressemblance? Dans le miroir, quelle merveilleuse reproduction detoute la personne! l'image est toujours de l'âge de ceux qui la regardent, depuis les commencements de l'enfancejusqu'à la vieillesse la plus avancée.
Elle suit toutes les phases de l'existence, elle prend toutes les attitudes, elleimite la tristesse aussi bien que la joie.
Au contraire une statue d'argile, de bronze, de marbre, une effigie en cire,un portrait peint sur la toile, ou enfin toute autre représentation obtenue par l'art se trouve au bout de bien peu detemps n'avoir plus de ressemblance; c'est comme un cadavre, avec sa face toujours la même et toujours immobile.Combien donc, quand il s'agit de voir reproduire un visage, doit-on mettre au-dessus des procédés de l'artiste le polisi ingénieux du miroir et son éclat créateur! Aussi, de deux choses l'une, ou bien il faut nous ranger de l'avisd'Agésilas le Lacédémonien, qui ne voulut jamais permettre à un peintre ou à un statuaire de reproduire ses traitsparce qu'il n'était pas assez content de sa propre figure; ou bien, si l'on croit pouvoir conserver les habitudesgénéralement admises de ne pas proscrire les statues et les portraits, on n'a pas le droit de penser qu'il soitconvenable de contempler son image sur de la pierre plutôt que sur de l'argent, sur une toile plutôt que dans unmiroir.Serait-ce à dire que l'on trouvât honteux qu'un homme examinât assidûment son propre visage? Mais le sageSocrate, nous dit-on, était le premier à conseiller à ses disciples de se regarder fréquemment dans un miroir : ilvoulait par-là que celui qui serait content de sa beauté veillât attentivement à ne pas gâter ces avantagescorporels par de mauvaises moeurs, et qu'aussi celui qui se croirait peu favorisé sous le rapport de l'extérieur,s'appliquât sérieusement à compenser cette laideur par la beauté de son caractère.
Homme vraiment sage, quifaisait d'un miroir un précepteur de morale! Citerai-je Démosthène, ce prince de l'éloquence? Tout le monde sait quec'était devant son miroir, comme devant un maître, qu'il méditait ses causes; et cet excellent orateur, qui déjà avaitformé son éloquence à l'école du philosophe Platon, sa logique rigoureuse à celle du dialecticien Eubulide, avait endernier lieu recours à son miroir pour acquérir la perfection du geste.
Or, croyez-vous que l'orateur qui va prodiguerl'invective, doive apporter plus de soin à se faire un geste décent pour prononcer ses discours, que le philosophe quidoit tonner contre les vices? C'est devant des juges désignés par le sort que l'avocat va parler pendant quelquesinstants; c'est devant toute espèce d'auditeurs que l'autre disserte sans cesse; c'est sur les limites d'un champ queplaide le premier, c'est sur celles du bien et du mal que nous instruit le second.Mais quoi! ce n'est pas seulement pour ces raisons que le philosophe doit regarder un miroir : souvent il faut qu'ilexamine, non pas seulement sa propre ressemblance, mais encore la raison même de cette ressemblance.
Est-il vrai,selon que le dit Epicure, que des images partent de nous comme des émanations qui s'échappent continuellement.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Commentaire De Texte Sur Le Dom Juan De Molière, Acte V, Scènes 5 Et 6
- Commentaire Littéraire: tirade de la scène 2 de l’acte V, Dom Juan
- Dom Juan de Molière: Acte 1 scène 2 (commentaire)
- Molière Dom Juan acte 1 scène 1, commentaire
- Commentaire Composé Acte III, Scène 5 Dom Juan De Molière