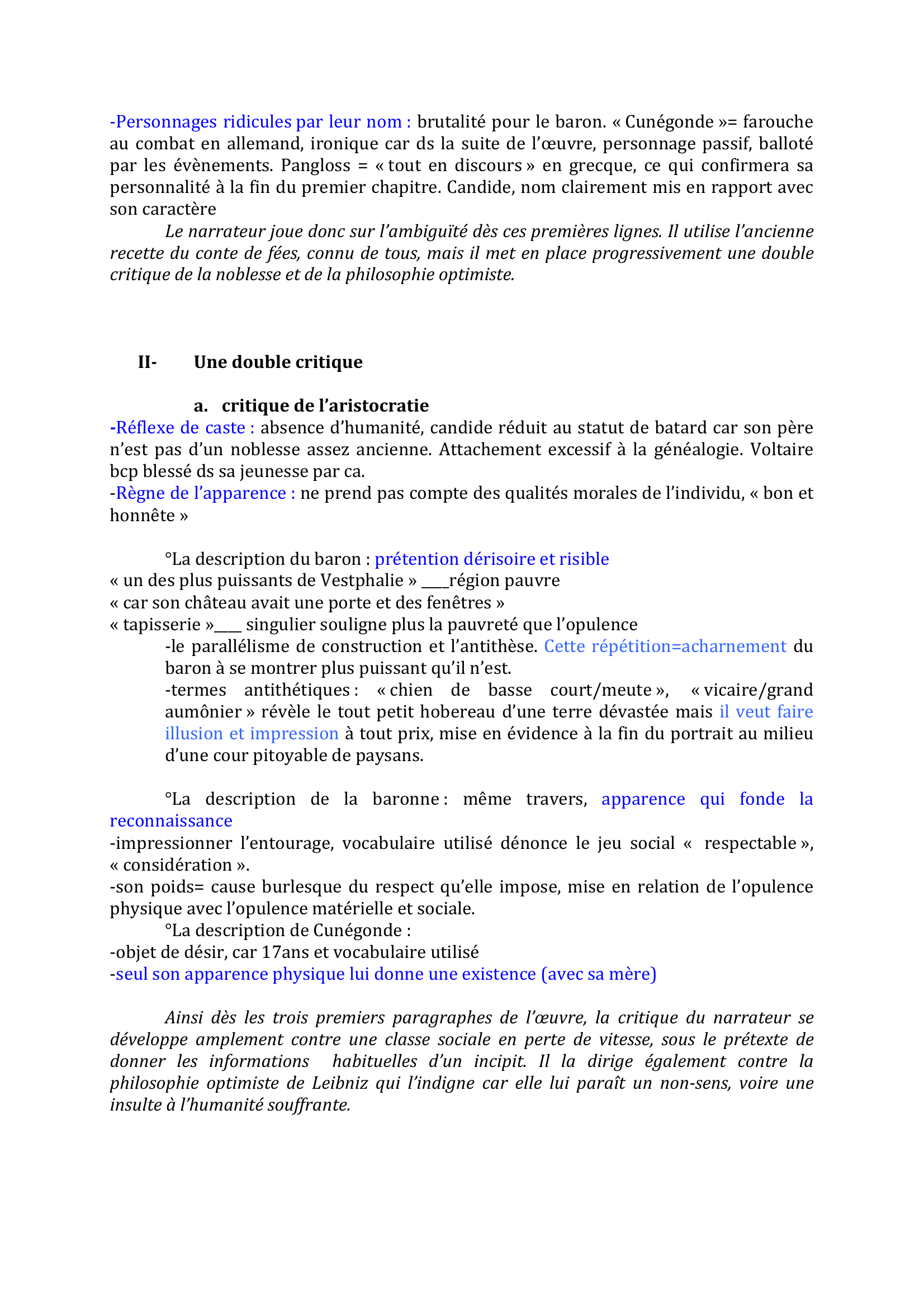Commentaire littéraire du Chapitre 1 de Candide
Publié le 24/03/2012

Extrait du document
Introduction :
Après le long règne absolutiste de Louis 14, les philosophes des Lumières ont porté un regard critique sur les grandes institutions politiques, sociales et religieuses de leur temps. Ainsi Voltaire a-t-il dénoncé sans relâche les dysfonctionnements causés par les inégalités et les préjugés. Dans son conte philosophique Candide en particulier, il brosse un tableau désastreux de l’humanité, au gré des déplacements de son héros éponyme.
-Personnage et cadre présentés selon le procédé habituel d’un incipit.
-Lecteur se rend compte que le récit comporte des failles avec un univers décrit loin d’être aussi paradisiaque qu’au premier abord.
-Quelles sont les cibles du narrateur dès ce premier chapitre liminaire et comment orchestre t il sa critique ?
«
-Personnages ridicules par leur nom : brutalité pour le baron.
« Cunégonde »= farouche
au combat en allemand, ironique car ds la suite de l’ œuvre, personnage passif, balloté
par les évènements.
Pangloss = « tout en discours » en grecque, ce qui confirmera sa
personnalité à la fin du premier chapitre.
Candide, nom clairement mis en rapport avec
son caractère
Le narrateur joue donc sur l’ambiguïté dès ces premières lignes.
Il utilise l’ancienne
recette du conte de fées, connu de tous, mais il met en place progressivement une double
critique de la noblesse et de la philosophie optimiste.
II- Une double critique
a. critique de l’aristocratie
-Réflexe de caste : absence d’humanité, candide réduit au statut de batard car son père
n’est pas d’un noblesse assez ancienne.
Attachement excessif à la généalogie.
Voltaire
bcp blessé ds sa jeunesse par ca.
-Règne de l’apparence : ne prend pas compte des qualités morales de l’individu, « bon et
honnête »
°La description du baron : prétention dérisoire et risible
« un des plus puissants de Vestphalie » ____région pauvre
« car son château avait une porte et des fenêtres »
« tapisserie »____ singulier souligne plus la pauvreté que l’opulence
-le parallélisme de construction et l’antithèse. Cette répétition=acharnement du
baron à se montrer plus puissant qu’il n’est.
-termes antithétiques : « chien de basse court/meute », « vicaire/grand
aumônier » révèle le tout petit hobereau d’une terre dévastée mais il veut faire
illusion et impression à tout prix, mise en évidence à la fin du portrait au milieu
d’une cour pitoyable de paysans.
°La description de la baronne : même travers, apparence qui fonde la
reconnaissance
-impressionner l’entourage, vocabulaire utilisé dénonce le jeu social « respectable »,
« considération ».
-son poids= cause burlesque du respect qu’elle impose, mise en relation de l’opulence
physique avec l’opulence matérielle et sociale.
°La description de Cunégonde :
-objet de désir, car 17ans et vocabulaire utilisé
-seul son apparence physique lui donne une existence (avec sa mère)
Ainsi dès les trois premiers paragraphes de l’ œuvre, la critique du narrateur se
développe amplement contre une classe sociale en perte de vitesse, sous le prétexte de
donner les informations habituelles d’un incipit.
Il la dirige également contre la
philosophie optimiste de Leibniz qui l’indigne car elle lui paraît un non-sens, voire une
insulte à l’humanité souffrante..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Commentaire littéraire de Candide de Voltaire, Chapitre 3
- commentaire littéraire: Le Rouge et Le Noir, chapitre 41
- Candide – CHAPITRE DIX-NEUF (commentaire gratuit)
- Chapitre 2 Commentaire composé Candide
- Commentaire littéraire Thérèse Desqueyroux, François Mauriac Chapitre IV de « Ce dernier soir avant le retour au pays » à « déjà il se rapprochait.