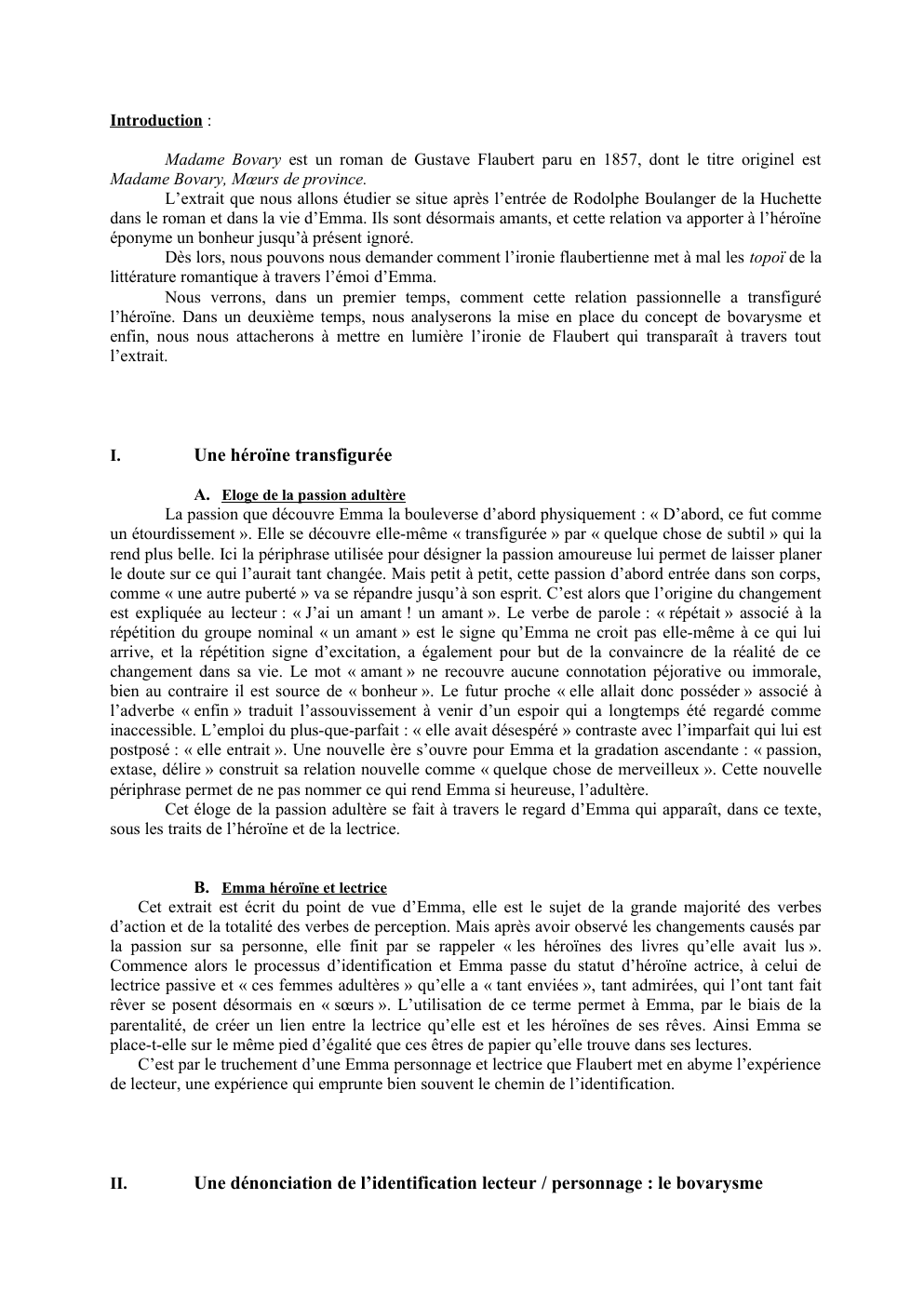commentaire Madame Bovary : j'ai un amant
Publié le 07/09/2025
Extrait du document
«
Introduction :
Madame Bovary est un roman de Gustave Flaubert paru en 1857, dont le titre originel est
Madame Bovary, Mœurs de province.
L’extrait que nous allons étudier se situe après l’entrée de Rodolphe Boulanger de la Huchette
dans le roman et dans la vie d’Emma.
Ils sont désormais amants, et cette relation va apporter à l’héroïne
éponyme un bonheur jusqu’à présent ignoré.
Dès lors, nous pouvons nous demander comment l’ironie flaubertienne met à mal les topoï de la
littérature romantique à travers l’émoi d’Emma.
Nous verrons, dans un premier temps, comment cette relation passionnelle a transfiguré
l’héroïne.
Dans un deuxième temps, nous analyserons la mise en place du concept de bovarysme et
enfin, nous nous attacherons à mettre en lumière l’ironie de Flaubert qui transparaît à travers tout
l’extrait.
I.
Une héroïne transfigurée
A.
Eloge de la passion adultère
La passion que découvre Emma la bouleverse d’abord physiquement : « D’abord, ce fut comme
un étourdissement ».
Elle se découvre elle-même « transfigurée » par « quelque chose de subtil » qui la
rend plus belle.
Ici la périphrase utilisée pour désigner la passion amoureuse lui permet de laisser planer
le doute sur ce qui l’aurait tant changée.
Mais petit à petit, cette passion d’abord entrée dans son corps,
comme « une autre puberté » va se répandre jusqu’à son esprit.
C’est alors que l’origine du changement
est expliquée au lecteur : « J’ai un amant ! un amant ».
Le verbe de parole : « répétait » associé à la
répétition du groupe nominal « un amant » est le signe qu’Emma ne croit pas elle-même à ce qui lui
arrive, et la répétition signe d’excitation, a également pour but de la convaincre de la réalité de ce
changement dans sa vie.
Le mot « amant » ne recouvre aucune connotation péjorative ou immorale,
bien au contraire il est source de « bonheur ».
Le futur proche « elle allait donc posséder » associé à
l’adverbe « enfin » traduit l’assouvissement à venir d’un espoir qui a longtemps été regardé comme
inaccessible.
L’emploi du plus-que-parfait : « elle avait désespéré » contraste avec l’imparfait qui lui est
postposé : « elle entrait ».
Une nouvelle ère s’ouvre pour Emma et la gradation ascendante : « passion,
extase, délire » construit sa relation nouvelle comme « quelque chose de merveilleux ».
Cette nouvelle
périphrase permet de ne pas nommer ce qui rend Emma si heureuse, l’adultère.
Cet éloge de la passion adultère se fait à travers le regard d’Emma qui apparaît, dans ce texte,
sous les traits de l’héroïne et de la lectrice.
B.
Emma héroïne et lectrice
Cet extrait est écrit du point de vue d’Emma, elle est le sujet de la grande majorité des verbes
d’action et de la totalité des verbes de perception.
Mais après avoir observé les changements causés par
la passion sur sa personne, elle finit par se rappeler « les héroïnes des livres qu’elle avait lus ».
Commence alors le processus d’identification et Emma passe du statut d’héroïne actrice, à celui de
lectrice passive et « ces femmes adultères » qu’elle a « tant enviées », tant admirées, qui l’ont tant fait
rêver se posent désormais en « sœurs ».
L’utilisation de ce terme permet à Emma, par le biais de la
parentalité, de créer un lien entre la lectrice qu’elle est et les héroïnes de ses rêves.
Ainsi Emma se
place-t-elle sur le même pied d’égalité que ces êtres de papier qu’elle trouve dans ses lectures.
C’est par le truchement d’une Emma personnage et lectrice que Flaubert met en abyme l’expérience
de lecteur, une expérience qui emprunte bien souvent le chemin de l’identification.
II.
Une dénonciation de l’identification lecteur / personnage : le bovarysme
A.
Quand le rêve devient réalité
Le monde du roman et le monde réel étant bien séparés, le lien qui unit le lecteur au personnage
relève de l’imaginaire.
Or dans ce texte, Emma rejoint le « type d’amoureuse » qu’elle trouve dans ses
livres.
Après avoir passé ses années de jeunesse à rêver en faisant siennes leurs passions, elle devient
« comme une partie véritable de ces imaginations ».
Le rapport antithétique entre « véritable » et
« imagination » met en opposition la réalité de la situation vécue par Emma et le caractère fictif des
aventures que connaissent « ces femmes adultères ».
Mais avec Emma, la fiction rejoint la réalité et elle
en vient à réaliser « la longue rêverie de sa jeunesse ».
Après avoir tant espéré, Rodolphe lui donne
enfin l’occasion de vivre ce qu’elle avait toujours regardé comme irréel, imaginaire.
Désormais, il ne
s’agit plus, pour Emma, de s’identifier aux héroïnes de roman, elle en devient une elle-même.
C’est donc à corps perdu qu’Emma se jette dans cette relation adultère tant louée par ses
lectures de prédilection.
B.
Une littérature qui pousse à l’immoralité
Lorsque Emma fait appel à ses souvenirs de lecture, voici quel tableau elle dresse de ce qui lui
apparaît : « la légion lyrique de ces femmes adultères se mit à chanter […] avec des voix de sœurs qui
la charmaient.
» Le chant de ces femmes rappelle celui des Sirènes qui, dans l’Antiquité séduisaient....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Introduction d'un commentaire composé madame bovary
- Commentaire chapitre6 madame bovary
- Commentaire Madame Bovary
- Madame Bovary Commentaire Composé Chapitre IX Partie II
- J'ai un amant - Madame Bovary de Flaubert