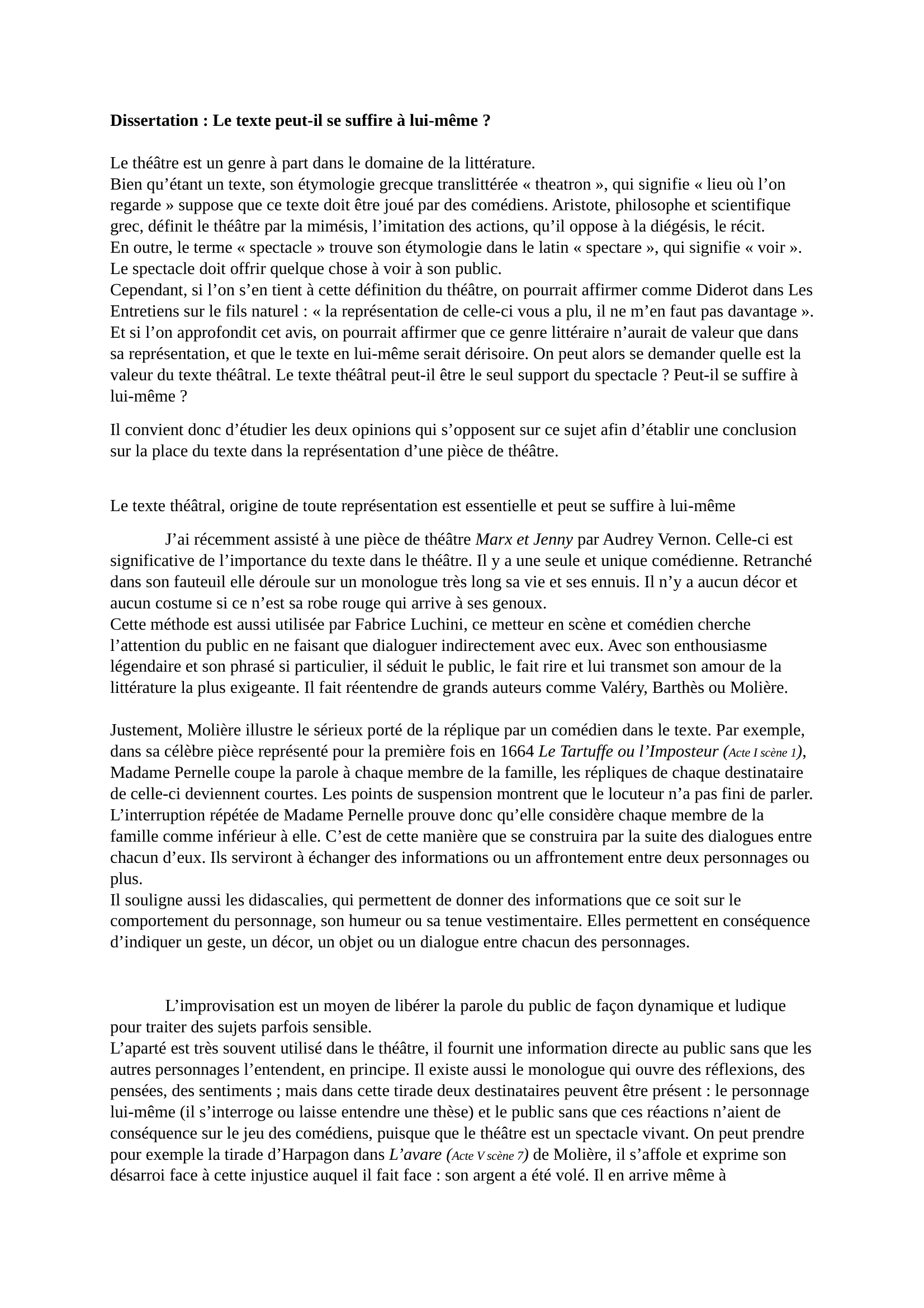CommentaireLe texte peut-ilse suffire à lui même
Publié le 23/03/2015

Extrait du document
«
Dissertation : Le texte peut-il se suffire à lui-même ?
Le théâtre est un genre à part dans le domaine de la littérature.
Bien qu’étant un texte, son étymologie grecque translittérée « theatron », qui signifie « lieu où l’on
regarde » suppose que ce texte doit être joué par des comédiens.
Aristote, philosophe et scientifique
grec, définit le théâtre par la mimésis, l’imitation des actions, qu’il oppose à la diégésis, le récit.
En outre, le terme « spectacle » trouve son étymologie dans le latin « spectare », qui signifie « voir ».
Le spectacle doit offrir quelque chose à voir à son public.
Cependant, si l’on s’en tient à cette définition du théâtre, on pourrait affirmer comme Diderot dans Les
Entretiens sur le fils naturel : « la représentation de celle-ci vous a plu, il ne m’en faut pas davantage ».
Et si l’on approfondit cet avis, on pourrait affirmer que ce genre littéraire n’aurait de valeur que dans
sa représentation, et que le texte en lui-même serait dérisoire.
On peut alors se demander quelle est la
valeur du texte théâtral.
Le texte théâtral peut-il être le seul support du spectacle ? Peut-il se suffire à
lui-même ?
Il convient donc d’étudier les deux opinions qui s’opposent sur ce sujet afin d’établir une conclusion
sur la place du texte dans la représentation d’une pièce de théâtre.
Le texte théâtral, origine de toute représentation est essentielle et peut se suffire à lui-même
J’ai récemment assisté à une pièce de théâtre Marx et Jenny par Audrey Vernon.
Celle-ci est
significative de l’importance du texte dans le théâtre.
Il y a une seule et unique comédienne.
Retranché
dans son fauteuil elle déroule sur un monologue très long sa vie et ses ennuis.
Il n’y a aucun décor et
aucun costume si ce n’est sa robe rouge qui arrive à ses genoux.
Cette méthode est aussi utilisée par Fabrice Luchini, ce metteur en scène et comédien cherche
l’attention du public en ne faisant que dialoguer indirectement avec eux.
Avec son enthousiasme
légendaire et son phrasé si particulier, il séduit le public, le fait rire et lui transmet son amour de la
littérature la plus exigeante.
Il fait réentendre de grands auteurs comme Valéry, Barthès ou Molière.
Justement, Molière illustre le sérieux porté de la réplique par un comédien dans le texte.
Par exemple,
dans sa célèbre pièce représenté pour la première fois en 1664 Le Tartuffe ou l’Imposteur ( Acte I scène 1 ) ,
Madame Pernelle coupe la parole à chaque membre de la famille, les répliques de chaque destinataire
de celle-ci deviennent courtes.
Les points de suspension montrent que le locuteur n’a pas fini de parler.
L’interruption répétée de Madame Pernelle prouve donc qu’elle considère chaque membre de la
famille comme inférieur à elle.
C’est de cette manière que se construira par la suite des dialogues entre
chacun d’eux.
Ils serviront à échanger des informations ou un affrontement entre deux personnages ou
plus.
Il souligne aussi les didascalies, qui permettent de donner des informations que ce soit sur le
comportement du personnage, son humeur ou sa tenue vestimentaire.
Elles permettent en conséquence
d’indiquer un geste, un décor, un objet ou un dialogue entre chacun des personnages.
L’improvisation est un moyen de libérer la parole du public de façon dynamique et ludique
pour traiter des sujets parfois sensible.
L’aparté est très souvent utilisé dans le théâtre, il fournit une information directe au public sans que les
autres personnages l’entendent, en principe.
Il existe aussi le monologue qui ouvre des réflexions, des
pensées, des sentiments ; mais dans cette tirade deux destinataires peuvent être présent : le personnage
lui-même (il s’interroge ou laisse entendre une thèse) et le public sans que ces réactions n’aient de
conséquence sur le jeu des comédiens, puisque que le théâtre est un spectacle vivant.
On peut prendre
pour exemple la tirade d’Harpagon dans L’avare ( Acte V scène 7 ) de Molière, il s’affole et exprime son
désarroi face à cette injustice auquel il fait face : son argent a été volé.
Il en arrive même à.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- TEXTE D’ETUDE : Jean-Jacques Rousseau, Emile ou De l’Education, 1762, chapitre III
- texte francais lettre persane 30
- COMMENTAIRE DE TEXTE (concours administratifs)
- Texte 1: Gargantua, 1534 (extrait 2 ) chapitre XXIII
- Texte d’étude : Charles Baudelaire, « L’Ennemi », Les Fleurs du Mal (1857): Le temps mange-t-il la vie ? (HLP Philo)