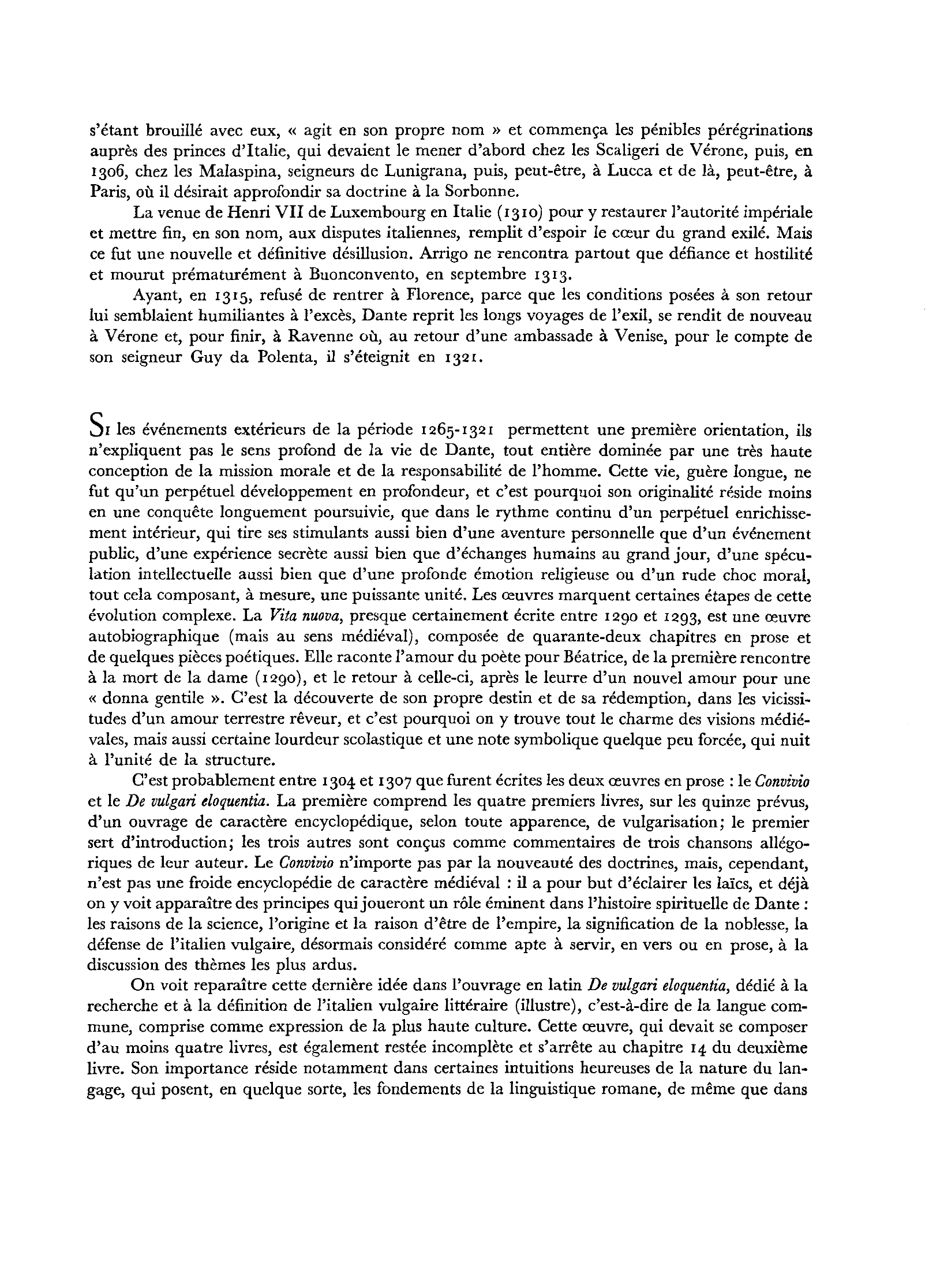DANTE ALIGHIERI
Publié le 02/09/2013

Extrait du document


«
s'étant brouillé avec eux, « agit en son propre nom » et commença les pénibles pérégrinations
auprès des princes
d'Italie, qui devaient le mener d'abord chez les Scaligeri de Vérone, puis, en
1306, chez les Malaspina, seigneurs de Lunigrana, puis, peut-être, à Lucca et de là, peut-être, à
Paris, où il désirait approfondir sa doctrine à la Sorbonne.
La venue de Henri VII de Luxembourg en Italie (1310) pour y restaurer l'autorité impériale
et mettre fin, en son nom, aux disputes italiennes, remplit d'espoir le cœur du grand exilé.
Mais
ce fut
une nouvelle et définitive désillusion.
Arrigo ne rencontra partout que défiance et hostilité
et mourut prématurément à Buonconvento, en septembre 1313.
Ayant, en 1315, refusé de rentrer à Florence, parce que les conditions posées à son retour
lui semblaient humiliantes à l'excès, Dante reprit les longs voyages de l'exil, se rendit de nouveau
à
Vérone et, pour finir, à Ravenne où, au retour d'une ambassade à Venise, pour le compte de
son seigneur Guy da Polenta, il s'éteignit en l 32 I.
S1 les événements extérieurs de la période 1265-132 l permettent une première orientation, ils
n'expliquent pas le sens profond de la vie de Dante, tout entière dominée par une très haute
conception de la mission morale et de la responsabilité de l'homme.
Cette vie, guère longue, ne
fut qu'un perpétuel développement en profondeur, et c'est pourquoi son originalité réside moins
en une conquête longuement poursuivie, que dans le rythme continu d'un perpétuel enrichisse
ment intérieur, qui tire ses stimulants aussi bien d'une aventure personnelle que d'un événement
public,
d'une expérience secrète aussi bien que d'échanges humains au grand jour, d'une spécu
lation intellectuelle aussi bien que d'une profonde émotion religieuse ou d'un rude choc moral,
tout cela composant, à mesure, une puissante unité.
Les œuvres marquent certaines étapes de cette
évolution complexe.
La Vita nuova, presque certainement écrite entre 1290 et 1293, est une œuvre
autobiographique (mais au sens médiéval), composée de quarante-deux chapitres en prose et
de quelques pièces poétiques.
Elle raconte l'amour du poète pour Béatrice, de la première rencontre
à
la mort de la dame ( l 290), et le retour à celle-ci, après le leurre d'un nouvel amour pour une
« donna gentile ».
C'est la découverte de son propre destin et de sa rédemption, dans les vicissi
tudes d'un amour terrestre rêveur, et c'est pourquoi on y trouve tout le charme des visions médié
vales, mais aussi certaine lourdeur scolastique et une note symbolique quelque peu forcée, qui nuit
à l'unité de la structure.
C'est probablement entre 1304 et 1307 que furent écrites les deux œuvres en prose: le Convivio
et le De vulgari eloquentia.
La première comprend les quatre premiers livres, sur les quinze prévus,
d'un ouvrage de caractère encyclopédique, selon toute apparence, de vulgarisation; le premier
sert d'introduction; les trois autres sont conçus comme commentaires de trois chansons allégo
riques de leur auteur.
Le Convivio n'importe pas par la nouveauté des doctrines, mais, cependant,
n'est pas une froide encyclopédie de caractère médiéval : il a pour but d'éclairer les laïcs, et déjà
on y voit apparaître des principes qui joueront un rôle éminent dans l'histoire spirituelle de Dante :
les raisons
de la science, l'origine et la raison d'être de l'empire, la signification de la noblesse, la
défense de l'italien vulgaire, désormais considéré comme apte à servir, en vers ou en prose, à la
discussion des thèmes les plus ardus.
On voit reparaître cette dernière idée dans l'ouvrage en latin De vulgari eloquentia, dédié à la
recherche et à la définition de l'italien vulgaire littéraire (illustre), c'est-à-dire de la langue com
mune, comprise comme expression de la plus haute culture.
Cette œuvre, qui devait se composer
d'au moins quatre livres, est également restée incomplète et s'arrête au chapitre 14 du deuxième
livre.
Son
importance réside notamment dans certaines intuitions heureuses de la nature du lan
gage, qui posent, en quelque sorte, les fondements de la linguistique romane, de même que dans.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- DIVINE COMÉDIE (LA), La Divina Commedia, 1472. Dante Alighieri - résumé de l'œuvre
- MONARCHIE (DE LA), Dante Alighieri - résumé de l'oeuvre
- BANQUET (LE), Dante Alighieri, 1265-1321 (résumé)
- QUESTION DE L’EAU ET DE LA TERRE de Dante Alighieri
- Dante Alighieri: Die göttliche Komödie (Sprache & Litteratur).