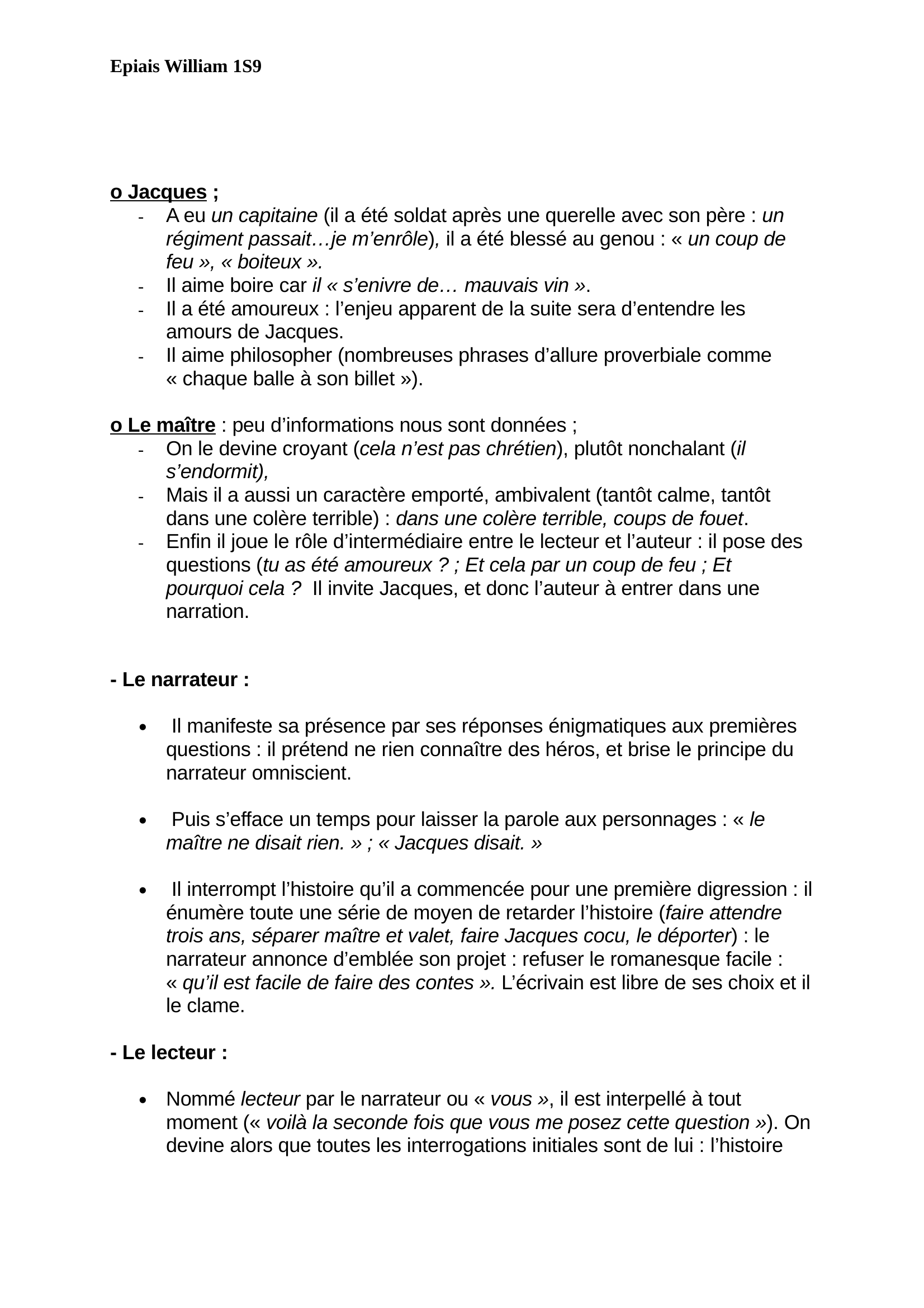Diderot, étude d'un incipit
Publié le 23/10/2012
Extrait du document
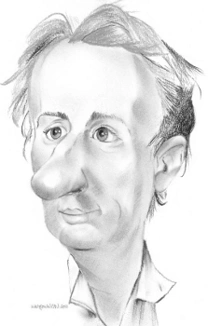
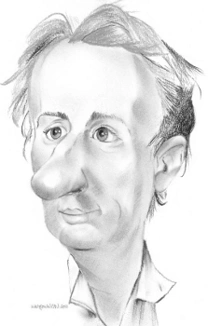
«
Epiais William 1S9
o Jacques ;
- A eu un capitaine (il a été soldat après une querelle avec son père : un
régiment passait…je m’enrôle ) , il a été blessé au genou : « un coup de
feu », « boiteux ».
- Il aime boire car il « s’enivre de… mauvais vin » .
- Il a été amoureux : l’enjeu apparent de la suite sera d’entendre les
amours de Jacques.
- Il aime philosopher (nombreuses phrases d’allure proverbiale comme
« chaque balle à son billet »).
o Le maître : peu d’informations nous sont données ;
- On le devine croyant ( cela n’est pas chrétien ), plutôt nonchalant ( il
s’endormit),
- Mais il a aussi un caractère emporté, ambivalent (tantôt calme, tantôt
dans une colère terrible) : dans une colère terrible, coups de fouet .
- Enfin il joue le rôle d’intermédiaire entre le lecteur et l’auteur : il pose des
questions ( tu as été amoureux ? ; Et cela par un coup de feu ; Et
pourquoi cela ? Il invite Jacques, et donc l’auteur à entrer dans une
narration.
- Le narrateur :
· Il manifeste sa présence par ses réponses énigmatiques aux premières
questions : il prétend ne rien connaître des héros, et brise le principe du
narrateur omniscient.
· Puis s’efface un temps pour laisser la parole aux personnages : « le
maître ne disait rien.
» ; « Jacques disait.
»
· Il interrompt l’histoire qu’il a commencée pour une première digression : il
énumère toute une série de moyen de retarder l’histoire ( faire attendre
trois ans, séparer maître et valet, faire Jacques cocu, le déporter ) : le
narrateur annonce d’emblée son projet : refuser le romanesque facile :
« qu’il est facile de faire des contes ».
L’écrivain est libre de ses choix et il
le clame.
- Le lecteur :
· Nommé lecteur par le narrateur ou « vous » , il est interpellé à tout
moment (« voilà la seconde fois que vous me posez cette question » ).
On
devine alors que toutes les interrogations initiales sont de lui : l’histoire.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Le texte proposé à notre étude est l'Incipit du roman "La fée Carabine" écrit par Daniel Pennac
- Étude et plan détaillé de l'incipit - L'éducation sentimentale, Flaubert
- Incipit - Jacques le fataliste de Diderot
- Commentaire de texte sur l'incipit de Jacques le fataliste de Diderot
- LA 1 : Incipit de Jacques Le Fataliste de Denis Diderot.