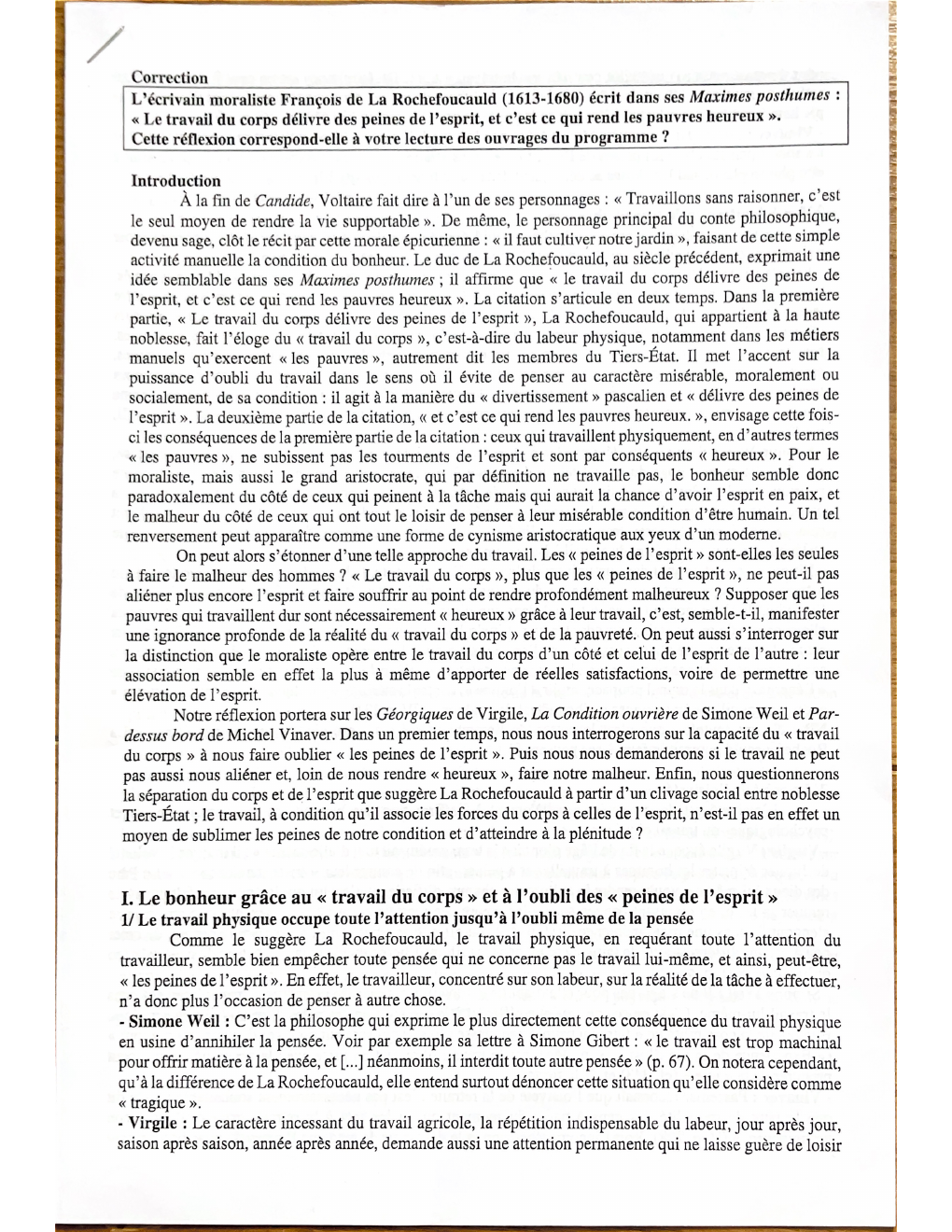Dissertation de La Rochefoucauld
Publié le 23/04/2023
Extrait du document
«
Correction
L'écrivain moraliste François de La Rochefoucauld (1613-1680) écrit dans ses Maximes posthumes :
« Le travail du corps délivre des peines de l’esprit, et e'est ce qui rend les pauvres heureux »,
Cette réflexion correspond-elle à votre lecture des ouvrages du programme ?
introduction
À la fin de Candide, Voltaire fait dire àl’un de ses personnages : « Travaillons sans raisonner, C'est
le seul moyen de rendre la vie supportable ».
De même, le personnage principal du conte philosophique
devenu sage, clôt le récit par cette morale épicurienne : «il faut cultiver notre jardin », faisant de cette simple
activité manuelle la condition du bonheur.
Le duc de La Rochefoucauld, au siècle précédent, exprimait une
idée semblable dans ses Maximes posthumes ; il affirme que « le travail du corps délivre des peines de
l’esprit, et c’est ce qui rend les pauvres heureux ».
La citation s’articule en deux temps.
Dans la première
partie, « Le travail du corps délivre des peines de l’esprit », La Rochefoucauld, qui appartient à la haute
noblesse, fait l'éloge du « travail du corps », c’est-à-dire du labeur physique, notamment dans les métiers
manuels qu'exercent « les pauvres », autrement dit les membres du Tiers-État.
Il met l’accent sur la
puissance d’oubli du travail dans le sens où il évite de penser au caractère misérable, moralement ou
alement, de sa condition :il agit à la manière du « divertissement » pascalien et « délivre des peines de
l’esprit ».
La deuxième partie de la citation, « et c’est ce qui rend les pauvres heureux.
», envisage cette fois-
ci les conséquences de la première partie de la citation: ceux qui travaillent physiquement, en d’'autres termes
les pauvres », ne subissent pas les tourments de l’esprit et sont par conséquents « heureux ».
Pour le
moraliste, mais aussi le grand aristocrate, qui par définition ne travaille pas, le bonheur semble dor
paradoxalement du côté de ceux qui peinent à la tâche mais qui aurait la chance d’aavoir l'esprit en paix, et
le malheur du côté de ceux qui ont tout le loisir de penser à leur misérable condition d’être humain.
Un tel
peut apparaître comme une forme de cynisme aristocratique aux yeux d’un moderne.
On peut alors s’étonner d’une telle approche du travail.
Les « peines del'esprit » Sont-elles les seules
à faire le malheur des hommes ? « Le travail du corps », plus que les « peines de l’esprit », ne peut-il pas
aliéner plus encore l'esprit et faire souffrir au point de rendre profondément malheureux ? Supposer que les
pauvres qui travaillent dur sont nécessairement « heureux » grâce à leur travail, c’est, semble-til, manifester
une ignorance profonde de la réalité du « travail du corps » et de la pauvreté.
On peut aussi s’interroger su
la distinction que le moraliste opère entre le travail du corps d’un côté et celui de l’esprit de l’autre :l
association semble en effet la plus à méme d’apporter de réelles satisfactions, voire de permettre une
élévation de l’esprit.
Notre réflexion portera sur les Géorgiques de Virgile, La Condition ou rière de Simone Weil et Pardessus bord de Michel Vinaver.
Dans un premier temps, nous nous interrogerons sur la capacité du « travail
du corps »à nous faire oublier « les peines de l’esprit », Puis nous nous demanderons si le travail ne peut
pas aussi nous aliéner et, loin de nous rendre « heureux », faire notre malheur.
Enfin, nous questionnerons
la séparation du corps et de l'esprit que suggère La Rochefoucauld à partir d’un clivage social entre nobles
Tiers-État ; le travail, à condition qu’il associe les forces du corps à celles de l’esprit, n’est-il pas en effet un
moyen de sublimer les peines de notre condition et d’atteindre à la plénitude ?
I.
Le bonheur grâce au « travail du corps » et à l’oubli des « peines de l’esprit »
1/ Le travail physique occupe toute l’attention jusqu’à l’oubli même de la pensée
Comme le suggère La Rochefoucauld, le travail physique, en requérant toute l’attention du
travailleur, semble bien empêcher toute pensée qui ne concerne pas le travail lui-même, et ainsi, peut-être,
« les peines de l'esprit ».
En effet, le travailleur, concentré sur son labeur, sur la réalité de la tâche à effectuer,
n’a donc plus l’occasion de penser à autre chose.
Simone Weil :C'est la philosophe qui exprime le plus directement cette conséquence du travail physique
en usine d'annihiler la pensée.
Voir par exemple sa lettre à Simone Gibert : « le travail est trop machinal
pour offrir matière à la pensée, et [.J néanmoins, il interdit toute autre pensée » (p.
67).
On notera cependant,
qu’à la différence de La Rochefoucauld, elle entend surtout dénoncer cette situation qu'elle considère comme
« tragique »,
Vin
Virgile
: Le caractère incessant du travail agricole, la répétition indispensable du labeur, jour après jour,
saison après saison, année après année, demande aussi une attention permanente qui ne laisse guère de loisir
l
e
l
e
travai
l
cel
l
e
s
ne
pour
que
j
a
mai
s
peut
paysan
De
fai
t
,
cent
r
é
es
fai
r
e,
d'
a
utres
vrai
m
ent
pensées
sur
à
rames,ne pousse
force del'entraî
relparlchasard
her sonseseffort:
quef saicelsiuiparquile, àcourant
« relToutâchent,
de même
save,bar»q(I,ue p.contre
le courant, si
5
0),
déri
l
a
l
'
esqui
bras
se
à
Mmet »Lép«Siine quelele
travai
l, loersntqu'icomme
nes apeif irmneesausi à
Vinaver : Lubi
l donne
sataisfiatctçaion, aipermet
l
personnel
s
,
marchai
affai
r
es
on
de
à
voul
d
erai
t
s
l
'
e
spri
lêtrees souci
«
s
philosophe quand les choses se détraquent dans votre foyer » (I , p.129).
Aussi, les auteurs, comme La Rochefoucauld, font l'éloge du travail physique et du bonheur simple
le :Ilssaifaietntl'éleloursge bitouten, spéci
fortunés,
travaiarmées,
l du paysanvoient; «Óla trèstropjuste
vateursde IlaEuxvie quichampétre
, loin desetdiduscordes
les culaletiment
terre
s'ilsVirgiconnai
2/ Les joies simples du travail physique
table.
qu'il procure.
Le travailleur, tout à son travail, semble toucher à un bonheur vérita
leurs
qualifiseés prélde a«ssent
facileguerri
» (II,ersp.
et99).de Les
nouriture
fortunés
lefforts,
eur verser
sol uneàl'écart
paysansdanssontlaquelle
l'oisiveté
des fracas
les pl»ucar
qui ldees son
s riche
tiennent
de joies
sourceriche
sont treès justement récompensés.
Ce travail, nécessairement pénible, est biencomper,
simples,
en ressources
essentielles et justes ; « du moins un repos assuré, une vie qui ne sait point les t
variées, du moins les loisirs en de vastes domaines, les grottes, les lacs d'eau vive, du moins les frais Tempé
(vallons), les mugissements de bæœufs et les doux sommes sous l’arbre ne leurs sont point étrangers.
» (II,
p.100),
Simone Weil : Bien qu’elle dénonce les réalités insupportables du travail à l'usine tel qu'il est organisé,
elle fait elle aussi l'éloge du travail tel qu'il pourrait être et des vertus que cela engendrerait : «L'usine
pourrait combler l’âme par le puissant sentiment de vie collective – on pourrait dire unanime – que donne la
participation au travail d'une grande usine » (« Expérience de la vie d'usine », p.
329), of, aussi « Si c'était
cela, la vie d’usine, ce serait trop beau » (Ibid.
p.
330).
Dans « Condition d'un travail non servile », elle
réfléchit aux moyens de faire du travail à l'usine une source de « joie »,
Vinaver :on est surtout dans un univers de bureau, d’où la réalité de la production industrielle et donc le
« travail du corps » est peu présente ou du moins peu visible.
Benoît Dehaze fait cependant l'éloge de
l'activité, de l'engagement dans le travail dans son discours aux salariés : « nous allons bondir oui nou
allons cesser de rester assis pour adopter une attitude bondissante la seule possible devant le défi qui nous
est fait la seule qui me plaise aussi et ceux d’entre vous qui n’adopteront pas la cadence eh bien ils rester
ur le quai ce n'est pas une menace c’est une constatation » (TV, p.131).
Il poursuit avec la valorisation de
«l'énergie » dans le travail pour accomplir «l’œuvre », contre la stérilité des « chamailleries entre certains »
et du « grenouillage (= intrigues malhonnêtes) de couloirs » (TV, p.131).
NB: Notons toutefois que c'est le patron de l’entreprise qui s’adresse ainsi à ses salariés (comme La
Rochefoucauld pourrait le faire à ses paysans ?)
3/ Le rejet de l’oisiveté
L’oisiveté est donc rejetée, parallèlement à l’affirmation des bienfaits et des vertus morales et
psychologiques du travail physique.
- Virgile:Virgile évoque la fin de l’'âge d’or où « la terre produisait tout d’elle-même »;il indique la volonté
de Jupiter d’inciter les hommes à travailler et à peiner, afin de contrer leur « triste indolence »: « Le Père
des dieux lui-méme a voulu rendre la culture des champs difficile, et c'est lui qui le premier a fait un art de
remuer la terre, en aiguisant par les soucis les cœurs des mortels et en ne souffrant pas que son empire
s’engourdit dans....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- philo: Méthode de la dissertation.
- Dissertation: Peut-on considérer que la métropolisation engendre à la fois un processus de concentration et d’accentuation des inégalités ?
- Dissertation: conseils
- dissertation des cannibales et des coches
- Dissertation Fables: II y a longtemps que les fables ne nous intéressent plus pour la moralité