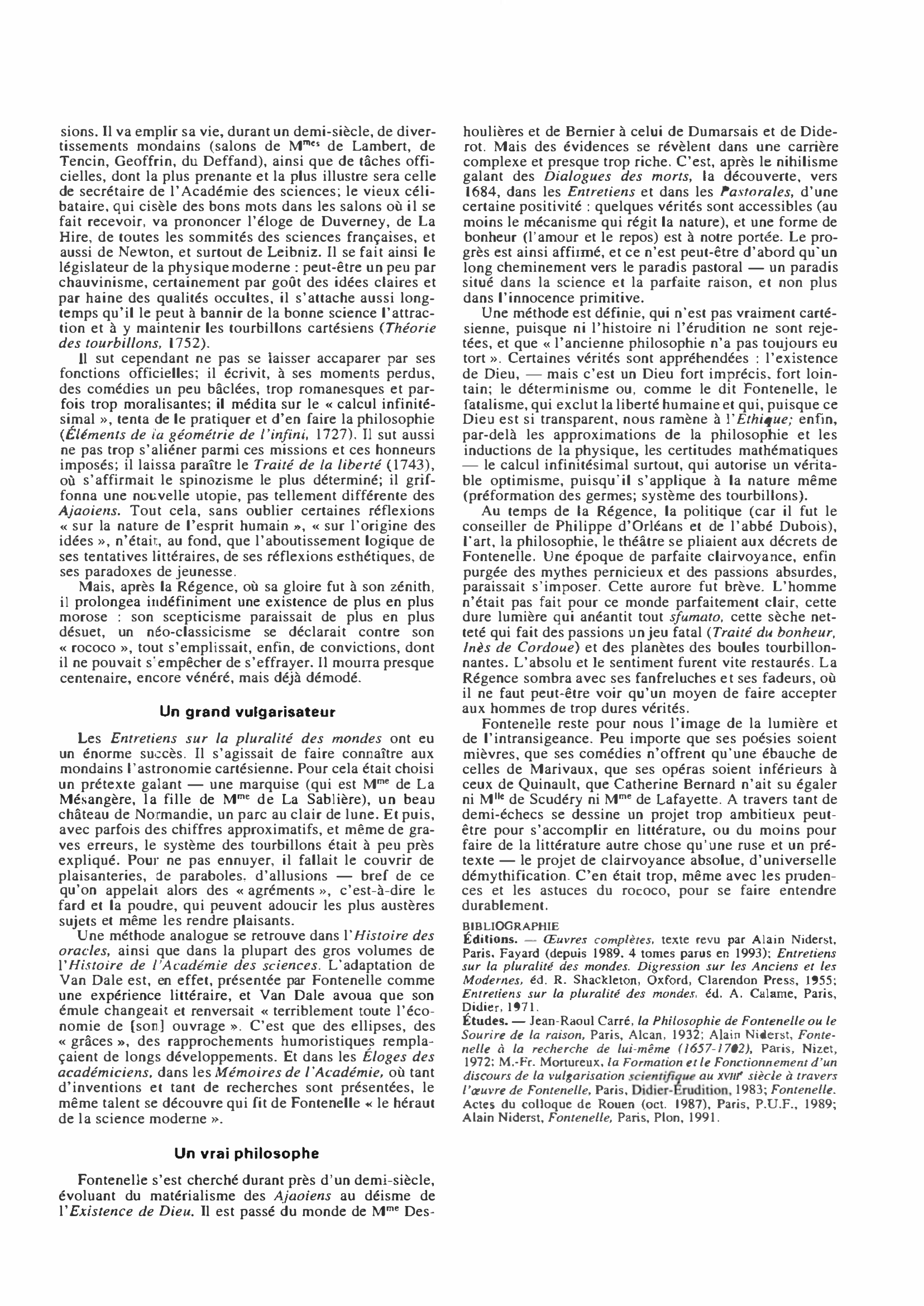FONTENELLE Bernard Le Bovier de : sa vie et son oeuvre
Publié le 06/12/2018

Extrait du document

FONTENELLE Bernard Le Bovier de (1657-1757). Fontenelle est longtemps resté, il demeure encore, aux yeux du public, un bel esprit sage et plaisant; ses bons mots sont illustres, mais on se refuse à croire à la gravité de sa philosophie, à l’originalité de ses œuvres littéraires. Tout au plus consent-on à le considérer comme un habile vulgarisateur.
Né à Rouen, il fut d’abord le neveu des Corneille — de Pierre sans doute (dont il écrira une Vie) —, mais plus encore de Thomas, auquel il ressemble si souvent. C’est Thomas Corneille qui le fit entrer au Mercure galant, où il donna nombre de petits poèmes dans les années 1678-1681 et aussi une intéressante lettre critique sur la Princesse de Clèves (1678). C’est également Thomas qui lui fit écrire la plus grande part des opéras de Psyché (1678) et de Bellérophon (1679) signés du nom de... Corneille. C’est encore Thomas qui l’encouragea à écrire des comédies, la Pierre philosophale (1681), la Comète (1681), et une tragédie, Aspar (1680), qui n’eut que deux représentations.
Ce littérateur doué qui touche à tout devra, après la chute (l'Aspar, attendre quelques années avant de connaître le grand succès avec les Lettres galantes du chevalier d’Her*** (1683), où, dans un style fort épi-grammatique, fort « rococo », il présente une sorte d’enquête romancée sur la société parisienne, la société de sa province (Rouen et la haute Normandie) et « l’amour à la mode ». Le projet est plus ambitieux dans les Dialogues des morts (1683), imités de Lucien : le rococo règne toujours; ce sont d’incessants paradoxes et, dans chaque dialogue, le désir de faire paraître des morts qui semblent fort étonnés de se trouver réunis. Mais ce livre forme surtout une sorte de bréviaire du libertinage de 1680. Sans doute est-ce vers la même époque que Fontenelle, décidément beaucoup moins « charmant », beaucoup moins anodin qu’on ne veut le voir, écrira sa grande utopie, la République des Ajaoiens (publiée en 1768).
La gloire vient avec les Entretiens sur la pluralité des mondes (1686) et l’Histoire des oracles (1687) — deux ouvrages de vulgarisation : il s’agit de répandre dans le public et de faire connaître, par les dames, l’astronomie cartésienne et l’érudition de Van Dale... Au même moment, Fontenelle publie ses Pastorales (1688). Peut-être lui manque-t-il, comme on l’a dit si souvent, le sens de la nature, mais nous sommes au siècle de Segrais, et non à celui de Lamartine. Cette nature enrubannée est celle de Lancret et de Boucher, et ces poésies ne sont
pas gratuites; elle concourent, aussi bien que les Lettres galantes, les Dialogues et la Pluralité, à dessiner l’idéal de Fontenelle : l’amour et le repos, l’innocence loin des fléaux des villes et des cours (ambition, superstition, mensonge...).
Son engagement, dès janvier 1688, aux côtés des Modernes contre Boileau et ses amis peut s’expliquer par des motifs personnels (il est l’ami de Perrault; le neveu de Corneille se retrouve logiquement dans le camp opposé à celui de Racine; le Mercure galant est depuis longtemps la feuille des Modernes); mais il s’agit aussi pour Fontenelle de ruiner par une argumentation rigoureuse l’une des erreurs du « vieux monde » : les Anciens n’ont pas été inégalables;

«
sions.
Il va emplir sa vie, durant un demi-siècle, de diver
tissements mondains (salons de Mmes
de Lambert, de
Tencin, Geoffrin, du Deffand), ainsi que de tâches offi
cielles, dont la plus prenante et la plus illustre sera celle
de secrétaire de J'Académie des sciences; le vieux céli
bataire, qui cisèle des bons mots dans les salons où il se
fait recevoir, va prononcer l'éloge de Duverney, de La
Hire, de toutes les sommités des sciences françaises, et
aussi de Newton, et surtout de Leibniz.
Il se fait ainsi le
législateur de la physique moderne : peut-être un peu par
chauvinisme, certainement par goOt des idées claires et
par haine des qualités occultes, il s'attache aussi long
temps qu'ille peut à bannir de la bonne science l'attrac
tion et à y maintenir les tourbillons cartésiens (Théorie
des tourbillons, 1752).
Il sut cependant ne pas se laisser accaparer par ses
fonctions officielles; il écrivit, à ses moments perdus,
des comédies un peu bâclées, trop romanesques et par
fois trop moralisantes; il médita sur le «calcul infinité
simal », tenta de le pratiquer et d'en faire la philosophie
(Éléments de la géométrie de 1 'infini, 1727).
JI sut aussi
ne pas trop s'aliéner parmi ces missions et ces honneurs
imposés; il laissa paraître le Traité de la liberté (1743),
où s'affirmait le spinozisme le plus déterminé; il grif
fonna une nouvelle utopie, pas tellement différente des
Ajaoiens.
Tout cela, sans oublier certaines réflexions
« sur la nature de l'esprit humain », « sur 1 'origine des
idées », n'était, au fond, que l'aboutissement logique de
ses tentatives littéraires, de ses réflexions esthétiques, de
ses paradoxes de jeunesse.
Mais, après la Régence, où sa gloire fut à son zénith,
il prolongea indéfiniment une existence de plus en plus
morose : son scepticisme paraissait de plus en plus
désuet, un néo-classicisme se déclarait contre son
« rococo )), tout s'emplissait, enfin, de convictions, dont
il ne pouvait s· empêcher de s'effrayer.
n mourra presque
centenaire, encore vénéré, mais déjà démodé.
Un grand vulgarisateur
Les Entretiens sur la pluralité des mondes ont eu
un énorme su,;cès.
Il s'agissait de faire connaître aux
mondains l'astronomie cartésienne.
Pour cela était choisi
un prétexte galant -une marquise (qui est Mme de La
Mésangère, la fille de Mm• de La Sablière), un beau
château de Normandie, un parc au clair de lune.
Et puis,
avec parfois des chiffres approximatifs, et même de gra
ves erreurs, Je système des tourbillons était à peu près
expliqué.
Pour ne pas ennuyer, il fallait le couvrir de
plaisanteries, de paraboles, d'allusions -bref de ce
qu'on appelai! alors des «agréments», c'est-à-dire le
fard et la poudre, qui peuvent adoucir les plus austères
sujets et même les rendre plaisants.
Une méthode analogue se retrouve dans l'H is toir e des
oracles, ainsi que dans la plupart des gros volumes de
l' H is to ire de l'Académie des sc ien ces .
L'adaptation de
Van Dale est, en effet, présentée par Fontenelle comme
une expérience littéraire, et Van Dale avoua que son
émule changeait et renversait «terriblement toute l'éco
nomie de [son] ouvrage)>.
C'est que des ellipses, des
« grâces )>, des rapprochements humoristiques rempla
çaient de longs développements.
Et dans les Éloges des
académiciens, dans les Mémoires de l'Académie, où tant
d'inventions et tant de recherches sont présentées, le
même talent se découvre qui fit de Fontenelle ).
Un vrai philosophe
Fontenelle s'est cherché durant près d'un demi-siècle,
évoluant du matérialisme des Ajaoiens au déisme de
1' Existence de Dieu.
Tl est passé du monde de Mme Des- houlières
et de Bernier à celui de Dumarsais et de Dide
rot.
Mais des évidences se révèlent.
dans une carrière
complexe et presque trop riche.
C'est, après le nihilisme
galant des Dialogues des morts, la découverte, vers
1684, dans les Entretiens et dans les Pastorales, d'une
certaine positivité : quelques vérités sont accessibles (au
moins le mécanisme qui régit la nature), et une forme de
bonheur (l'amour et Je repos) est à notre portée.
Le pro
grès est ainsi affirmé, et ce n'est peut-être d'abord qu'un
long cheminement vers le paradis pastoral -un paradis
situé dans la science et la parfaite raison, et non plus
dans l'innocence primitive.
Une méthode est définie, qui n'est pas vraiment carté
sienne, puisque ni l'histoire ni l'érudition ne sont reje
tées, et que.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- HISTOIRE DES ORACLES Fontenelle (Bernard Le Bovier de) (résumé et analyse de l'oeuvre)
- HISTOIRE DES ORACLES, 1686. Fontenelle (Bernard Le Bovier de)
- ENTRETIENS SUR LA PLURALITE DES MONDES de Bernard Le Bovier de Fontenelle (résumé)
- LETTRES GALANTES DU CHEVALIER D’HER... de Bernard Le Bovier de Fontenelle
- Buffet, Bernard - vie et oeuvre du peintre.