Grand oral du bac :André Malraux
Publié le 10/11/2018

Extrait du document
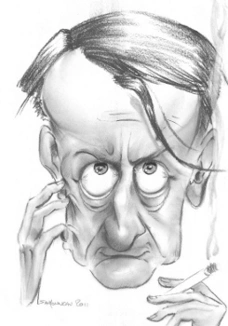
• Rapidement Malraux quitte l'enclos maternel et se préoccupe de gagner sa vie.
• À dix-huit ans, il propose ses services à René-louis Doyon, un libraire spécialisé dans les livres d'occasion. Écumant les bouquinistes, Malraux déniche pour lui des livres rares.
• C'est dans le premier numéro de la revue de ce libraire, La Connaissance, qu'il publie en janvier 1920 son premier article, «Des origines de la poésie cubiste», où il exprime une vive admiration pour les poètes Max Jacob {1876-1944), Pierre Reverdy (1889-1960) et Blaise Cendrars (1887-1961).
• À dix-neuf ans, il collabore à des revues d'avant-garde (Action, Accords Le Disque vert) à une époque où l'effervescence des milieux artistiques est à son comble dans un Paris enregistrant les premières secousses de la révolution surréaliste.
LA VOJX DES GRANDES PENSEES DE L'HISTOIRE
Voyageur infatigable, résistant fédérateur, combattant esthète éclairé, romancier primé, essayiste, orateur, ministre : la liste des facettes est longue, qui rendent à peine compte de la vie mouvementée d'André Malraux (1901-1976}. Ses «plusieurs vies» sont autant le signe d'une curiosité et d'un talent exceptionnels que d'un désir entier de compréhension de la destinée humaine par diverses approches. Malraux est à jamais enraciné dans l'aventure historique, politique et artistique du XX' siècle. Ses recherches artistiques et intellectuelles ont été fortement marquées par un siècle tragique à plus d'un titre.
UNE ENFANCE OCCULTÉE
La formation
• Le 3 novembre 1901, Georges André Malraux voit le jour à Paris. Son père, Fernand, dont la réputation s'est bien plus construite sur des talents de séducteur que sur une brillante activité professionnelle - il est gérant d'une agence bancaire peu rentable - se sépare de sa mère, née Berthe Lamy, quand le jeune André à quatre ans; il restera désormais éloigné de son fils.
• Malraux est élevé par sa mère et sa grand-mère en banlieue parisienne, à Bondy, au-dessus de l'épicerie qu'elles tiennent toutes deux. Peu enclin à s'appesantir sur cette enfance «détestée», Malraux l'évoquera rarement
• On sait néanmoins que le grand-père, personnage haut en couleur, impressionna l'enfant par ses histoires extravagantes, mais il décéda en 1909.
• Alors qu'à dix-sept ans Malraux abandonne la voie du baccalauréat en quittant résolument l'école primaire supérieure, il se jette sur la littérature et se nourrit de Walter Scott, de Gustave Flaubert de Victor Hugo ou encore de Shakespeare et de Balzac.
• La lecture du philosophe Nietzsche associée au spectacle funeste de la Première Guerre mondiale le plonge, à l'aube de ses dix-huit ans, dans des méditations sombres sur l'avenir de la civilisation occidentale.
• Malraux est un autodidacte. «Entre dix-huit et vingt ans, la vie est comme un marché où l'on achète des valeurs, non avec de l'argent mais avec des actes», dira-t-il plus tard.
• Ce credo, il l'applique par ses lectures, par ses visites au musée Guimet par l'apprentissage du sanskri. Déjà, on sent pointer la fascination pour l'Orient.
L'ORIENT AVENTUREUX
• la mauvaise situation financière du couple, la soif d'aventures de Malraux et son attraction pour l'art khmer le poussent à s'embarquer avec Clara pour l'Indochine en 1923.
• Muni d'un vague ordre de mission du ministère des Colonies, Malraux débarque à Hanoï avec l'espoir d'aller exhumer, sous la touffeur de la forêt tropicale cambodgienne, des temples inconnus sur lesquels le prélèvement de quelques statues permettra au couple de renflouer son compte en banque.
• En compagnie d'un ami, l'expédition se concrétise, et les trois compagnons parviennent à arracher du petit temple de Banteaï Srey des statues d'une grande valeur. Mais, quelques jours plus tard, les autorités les rattrapent et l'affaire éclate au grand jour : Malraux est accusé de «pillage de ruines», jugé à Phnom Penh et condamné à trois années de prison.
• Malgré la virulence de la presse coloniale à l'égard de l'écrivain, les efforts de Clara et de nombreux intellectuels permettent sa libération en novembre 1924.
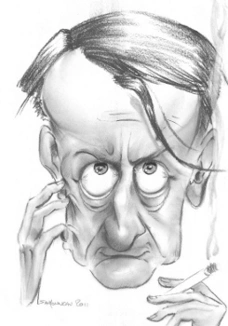
«
L'ESPOIR
Comme dans La Condition humaine,
c'est la conjoncture historique qui
détermine l'écriture de Malraux : en
l'occurrence ici, la guerre d'Espagne.
L' Espoir retrace l'évolution des
premiers mois de la guerre civile entre
les troupes républicaines, assistées des
Brigades internationales, et l'armée
franquiste.
Dans une atmosphère de louange de
la fraternité au combat, l'auteur
montre l'ambivalence d'hommes
idéalistes et réfléchis qui, lorsque les
manœuvres de la guerre le requièrent,
se transforment en techniciens � la
logique implacable.
La touche d'espérance qui clôt le
roman -la camaraderie héroïque
entre des individus d'horizons très
différents sublimès par le combat
militant- semble aboutir � une
réconciliation entre les consciences
convainc son ami aviateur, tdoutlrd
Comiglion-Molinier, de survoler le
désert du Ohana (Yémen actuel) � la
recherche d'une ville mythique : la
capitale de la reine de Saba.
Mais le
mirage est bien vite emporté par une
tempête qui manque de faire s'écraser
les deux explorateurs.
L'ENGAGEMENT POLITIQUE
• En 1933, � l'heure où l'écrivain accède
� la célébrité, Hitler prend le pouvoir en
Allemagne et devient chancelier.
Chez
de nombreux intellectuels de l'époque,
le malaise est profond face � cette
montée des périls.
• Malraux gravite alors près des sphères
communistes.
En présence de Paul
Vaillant-Couturier (1892-1937), membre
du Comité central du PCF et rédacteur
en chef de L'Humanité, et de Maurice
Th orez (1900-1964), secrétaire général
du Parti, il prend la parole � la tribune
de l'Assodtltion des écrivDins et
des Drtistes révolutionnDires.
· Devenu «compagnon de route»
du Parti, il se distingue par sa
condamnation du fascisme au Congrès
des écrivains soviétiques, � Moscou,
où il a été invité.
Il se lie alors avec le
cinéaste S.
M.
Eisenstein (1898-1948),
les écrivains Boris Pasternak (189Q-
1960, futur auteur du Dodeur Jivago)
et Maxime Gorki (1868-1936), et il
rencontre Staline.
• Au côté de son ami André Gide, il se
rend en Allemagne pour réclamer au
Führer la libération de Georgi Dimitrov,
secrétaire de la Ill• Internationale tombé
aux mains de la Gestapo.
Le Temps
du mépris, publié en 1935, résume
ses nouvelles orientations politiques individuelles
et la destinée collective et
historique des hommes.
La succession des plans quasi
cinématographiques a encouragé
Malraux � porter le film � l'écran dès la
publication du livre.
Et c'est dans une
Barcelone en état de guerre que le
tournage commence.
Entre alertes et
bombardements, désistements
d'acteurs et décors réalisés de bric et
de broc, le film est finalement monté,
'----
� ..
·�= '
'
-' �-·
, 1 ,_ ..
.,
malgré l'impossibilité de tourner
certaines séquences.
Sous le titre
Sieml ft Ten�e( le film reçoit le prix
Louis-Delluc en 1945.
antifascistes.
Il participe aussi � la
fondation de la Ligue mondiale contre
l'antisémitisme.
LA GUERRE D'ESPAGNE
• Son engagement aux côtés des
républicains durant la guerre
d'Espflgne va cristalliser dans l'action
ses prises de
1 t
position i.'
théorique.
Malraux se
jette � corps
perdu dans
la bataille
contre le
franquisme,
frôlant� plusieurs reprises les frontières
de la déraison, tant son ardeur au
combat se développe au péril de sa vie
(il gagne le grade de colonel).
Il décide de former la première
escadrille républicaine, baptisée
fspaiia, et, pour cela, il demande
l'appui du gouvernement français en
vue d'obtenir des appareils aptes �
combattre.
Malgré le pacte de non
intervention signé par le cabinet de
Léon Blum, Malraux soutire l'aval du
gouvernement et rentre en Espagne
organiser la résistance.
Bien
qu'absolument incompétent pour
piloter un avion, il fédère ses troupes et
orchestre le déroulement de plusieurs
bombardements (Saragosse, Medellin,
Teruel).
Désigné officieusement ministre
de la Propagande et des Relations
extérieures du gouvernement
républicain, il plaide la cause de celui-ci
aux États-Unis et revient en Espagne
avec plusieurs milliers de dollars.
• Pendant tout ce temps, dans l'ombre
de ses pensées, sommeille L'Espoir,
un livre sur la guerre d'Espagne.
Quand,
en décembre 1937, Gallimard le publie,
le glas sonne déj� pour les républicains,
défaits � la bataille de Teruel.
LA CONVERSION
À L'IDÉE NATIONALE
L'ÉPREUvt DE LA GUERRE
·À peine sorti de la guerre d'Espagne,
Malraux s'engage dans un conflit qui
durera six ans et sera marqué par une
barbarie et une folie humaine
responsables de millions de morts.
• Malraux en septembre 1939 a trente
huit ans.
Il vit alors une liaison avec
Josette Clotis, rencontrée quelques
années plus tôt Lorsque la guerre éclate,
elle interrompt l'écrivain dans
ses réflexions esthétiques sur l'univers
des formes; il s'attelle alors � une
Psychologie de l'art
• Dès septembre 1939, bien que
réformé, Malraux s'engage dans un
régiment de blindés cantonné dans les
environs de la ville de Provins.
L'espoir
d'une victoire dans cette «drôle de
guerre» s'évanouit rapidemen� et le
22 juin 1940, le maréchal Pétain signe
l'armistice.
Une semaine auparavan�
Malraux a été fait prisonnier près de
Sens.
Sa captivité est éphémère,
puisque, � peine trois mois plus tard,
il réussit avec son frère cadet Roland �
s'évader.
• Pendant deux ans et demi, Malraux
s'accorde une trêve.
Avec Josette et son
fils, Pierre-Gauthier, né en novembre
1940, il goûte � la sérénité familiale�
l'abri du tumulte, dans la Drôme, puis
en Corrèze.
LE COLONEL BERGER
• Par l'intermédiaire de ses deux frères,
Claude et Roland, tous deux membres
actifs des réseaux de résistants, Malraux
reprend les armes au printemps de
1944.
En trois mois, aidé par un
charisme et un prestige qui créent le
consensus autour de lui, il réussit
l'exploit de fédérer tous les maquis
du Périgord noir.
Sous le pseudonyme
de «colonel Berger», il rassemble
républicains, socialistes et
conservateurs, et organise des
sabotages.
• Sa détermination, son audace et son
courage lui forgent une solide
réputation, reflétée par de nombreux
témoignages d'admiration.
Le 22 juillet
1944, il est arrêté au hasard d'une
patrouille et dirigé vers Toulouse, où,
après interrogations et simulacres
d'exécution, il est libéré in extremis par
les FFI (Forces françaises de l'Intérieur).
• Dans le feu de l'action -et de manière
assez inattendue -, il se retrouve � la
tête du commandement de la brigade
Alsace-Lorraine, créée pour libérer ces
deux régions.
En janvier 1945, il
chassera les Allemands de Strasbourg.
• La mort comme un refrain acharné
dans sa vie, l'a frappé le 11 novembre
1944 en emportant accidentellement
sa compagne Josette (qui a accouché
en mars 1943 d'un second fils, Vincent),
tandis que ses deux frères, arrêtés en
mars 1944, ont été exécutés.
En mars
1948, Malraux épousera Madeleine,
veuve de son frère Roland.
NAISSANCE D'UN HOMME POLITIQUE
·A deux reprises, Malraux a tenté
pendant la guerre de proposer ses
services au général de Gaulle.
À deux
reprises, le silence a déçu ses attentes.
En 1945, � la faveur d'une rencontre
arrangée, les deux hommes échangent
leurs premières paroles, nouant une
relation que seule la mort du Général
viendra interrompre.
Cette entrevue,
qu'il relatera dans ses Antimémoires,
sonne le départ d'une brillante carrière
politique.
• Alors que le philosophe Jean-Paul
Sartre (1905-1980) s'en prend� de
Gaulle, Malraux plaide pour le Général
et intègre son gouvernement en
novembre 1945 en tant que ministre
de l'Information.
Le divorce avec les
existentialistes sartriens est consommé.
Ils ne pardonneront pas à Malraux sa
conversion au gaullisme.
•
En 1951, il passe délégué � la
propagande du RPF, le parti du
Général.
Pendant deux ans, il se fait
le chantre du patriotisme gaulliste �
travers le monde.
L'AMOUR EUX DE L'ART
• Malraux le proclame � plusieurs
reprises : sa religion, c'est l'art.
De
l'explorateur fasciné par l'art khmer
� l'homme qui deviendra ministre de
la Culture, cette passion semble bien
le fil d'Ariane de sa vie.
Mais elle se
manifeste en premier lieu dans ses
écrits théoriques sur l'art bien que ses
romans soient traversés par des
dialogues sacralisés par le sceau de
l'art
• En 1937, il a publié La Psychologie
de l'art avant-goût du Musée
imaginaire qui parait dix ans plus tard.
Dans cet ouvrage, il montre commen�
par des innovations institutionnelles
ou techniques (naissance des musées,
reprographie), notre regard (et celui
des artistes) s'est métamorphosé sur les
œuvres, rendant possible la naissance
de l'art moderne.
• Dans la foulée du Musée imaginaire
sont publiés La Création artistique
(1948} et La Monnaie de l'absolu
(1949}.
· Responsable chez l'éditeur Skira de
la publication d'albums artistiques,
Malraux signe trois études
importantes : un Léonard de Vinci, un
Vermeer de Delft ainsi qu'un Saturne,
essai sur Goya.
Les Voix du silence
(1951} reviennent méditer sur les
thèmes principaux de La Psychologie.
• Retardée par les années passées au
gouvernement, La Métamorphose des
dieux (1957-1976} demeure son plus
grand chantier artistique.
Composé
essentiellement d'illustrations, le livre
confronte des œuvres et nous entraîne
dans une histoire discontinue des
formes.
De ce dialogue entre les
œuvres surgit un lyrisme malrucien
louant l'universalité de l'art.
• Malraux admire les grands artistes,
capables, par leur puissance créatrice
productrice d'éternité, de renverser
l'absurdité d'un réel limité par la mort
(ici avec M11rc ChDgDII).
L'art est donc
un « anti-destin ».
Ainsi, dans le
prolongement de ses oraisons funèbres
aux grands artistes du XX' siècle
(Georges Braque en 1963, Le Corbusier
en 1965}, il dressera un hommage
éloquent au génie de Picasso dans
La Tête d'obsidienne (1974).
«l'Al EPOUSE lA FRANCE�>
L'ACTION POLITIQUE
• Alors que la guerre de décolonisation
fait rage en Algérie � partir de 1957,
Malraux se mobilise contre les
exactions françaises commises contre
les dissidents.
L'arrivée de De Gaulle à
la tête du pouvoir, le 29 mai 1958, va
déterminer le retour de Malraux� la
politique.
Entre l'homme lige et le
Général, la collaboration durera dix ans.
•
Le 1" juin 1958,
Malraux est
nommé ministre
chargé de
l'Information.
En
janvier 1959, il
devient
officiellement
ministre d'État
chargé des Affaires culturelles.
• Fer de lance de la politique gaullienne,
il sillonne le monde, rencontrant
intellectuels (Aimé Césaire, Léopold
Sédar Senghor, Saint-John Perse), chefs
charismatiques (Nehru, Mao, Kennedy),
portant très haut l'Idée de la
francophonie et de la richesse culturelle
française.
• Le maigre budget attribué � la culture
lui permet néanmoins de réaliser des
opérations populaires entre 1959 et
1969 : inventaire du patrimoine
artistique du pays, sauvetage du
quartier du Marais � Paris, organisation
de grandes rétrospectives («La peinture
du Siècle d'or espagnol», «Picasso» ...
).
• À l'origine des grands travaux de
ravalement des monuments de Paris,
puis des immeubles d'habitation, il leur
restitue à tous leur limpidité originelle.
• C'est dans la création des «maisons
de la Culture» que s'incarne le mythe
de Malraux� la culture.
Conscient du
déficit culturel des villes de province, il
inaugure � Bourges le premier édifice
destiné à populariser la culture :
«Autant qu'� l'école les masses ont
droit au théâtre, au musée.
Il faut faire
pour la culture ce que Jules Ferry faisait
pour l'instruction.»
• Les événements de 1968, qui
annoncent la chute prochaine de
Charles de Gaulle, marquent aussi la fin
de la carrière politique de son fidèle
lieutenant.
lEs DERNIÈRES ŒUVRES
• Les textes rédigés durant la mission
politique de Malraux sont imprégnés de
ses devoirs gouvernementaux : discours
pour le transfert des cendres de Jean
Moulin au Panthéon (déc.
1964),
préfaces d'expositions ...
• En 1967, il publie le début de ses
Antimémoires, texte autobiographique à
l'écriture inventive mêlant de nombreux
procédés d'écriture.
Il y assume sa vie
et son œuvre, en y réaffirmant ses
interrogations fondamentales : le sens
de la vie, la mort, l'action de l'art.
VERRIÈRES·LE·BUISSON • En 1969, il emménage à Verrières
le-Buisson chez la romancière Louise
de Vilmorin (1902-1969), qui décède
rapidement.
En 1970, Malraux ne peut
masquer sa douleur : c'est au tour du
Général de disparaître.
• Ses dernières Dnnks, au côté de
Sophie de
Vilmorin (nièce
de Louise), sont
l'occasion de
composer des
préfaces, de retravailler et compléter ses
Antimémoires, de publier, encore et
toujours : Les chênes qu'on abat (1971},
Lazare (1974), Les H6tes de passage
(1975).
• Le 23 novembre 1976, Malraux s'éteint
à l'hôpital de Créteil.
Vingt ans plus tard
jour pour jour, un hommage national
est décrété pour cet homme qui avait
«épousé la France», et ses cendres
entrent au Panthéon..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Grand oral du bac : ANDRÉ MALRAUX
- Grand oral du bac : Arts et Culture L'ART DE LA PHOTOGRAPHIE
- Grand oral du bac : Arts et Culture LE BAUHAUS
- Grand oral du bac : Arts et Culture LE BAROQUE
- Grand oral du bac : WALT DISNEY

































