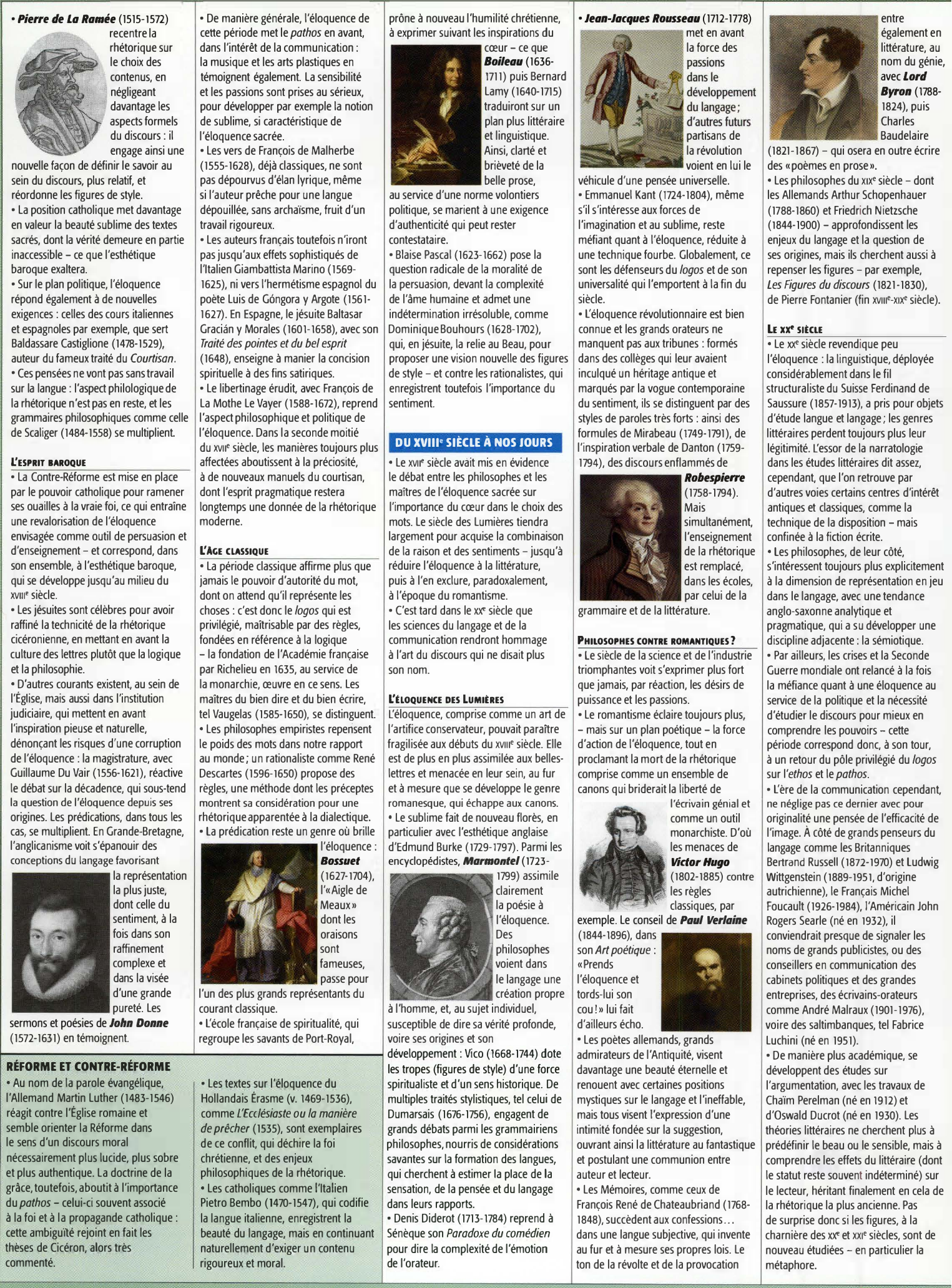Grand oral du bac : Les maîtres de l'éloquence
Publié le 10/11/2018

Extrait du document
LES RACINES ANTIQUES
Les textes grecs révèlent les premières préoccupations de l'homme concernant le débat : dès L'Iliade d'Homère, son importance initie une discipline qui va connaître des raffinements incessants.
L'éloquence GRECQUE
• Le discours oral est très important dans la Cité athénienne. Les pythagoriciens seraient les premiers à réfléchir sur l'efficacité des paroles (en particulier dans les affaires judiciaires) :dès le Ve siècle av. J.-C., ou «siècle de Périclès», Corax définit la rhétorique comme un art «créateur de persuasion», et Tisias élabore un «art oratoire», les deux s'accordant sur la priorité du vraisemblable sur le vrai.
• Platon {427-347 av. J.-C) reprochera précisément leur manque de moralité aux héritiers de cette pensée, en particulier aux sophistes, comme Protagoras (v. 486-410} et Gorgias (v. 485-v. 380}, qui visent la réussite, en passant par la séduction de l'auditoire. Leur rhétorique repose en effet sur la considération pratique des actions et des réactions humaines, plus que sur les idées en elles-mêmes et sur les valeurs. En cela, ils portent une attention réelle au caractère psychologique et social de l'homme (orateur et auditeur), et pensent la parole comme un média inscrit dans l'actualité et qu'il convient d'apprendre à maîtriser - ce qui conduit aussi aux premières ébauches de grammaires et de stylistiques.
• La Rhétorique d'Aristote (384-322), grand texte fondateur, comprend une partie consacrée au syllogisme (logique de l'argumentation), une seconde aux passions et une dernière au style. Aristote, se recentrant sur l'homme, y compris dans sa contingence, estime nécessaire de réfléchir sur les formes de la communication et propose des classements systématiques de celles-ci, qu'il tente de réconcilier avec la pensée philosophique. La rhétorique aristotélicienne reste toutefois définie comme un art de la persuasion, sans toujours reposer sur des principes ou des objets définis et certains, puisqu'elle réserve une place de choix à l'enthymème, syllogisme fondé sur la vraisemblance. L'ethos - ou le caractère et la fiabilité - de l'orateur et le pathos, émotion de ceux à qui il s'adresse, prennent dès lors toute leur importance, à côté du logos, propre à l'argument Trois genres de discours sont également définis par le philosophe : le délibératif, qui fait soupeser l'intérêt d'une action; le judiciaire, qui concerne le jugement relatif à des actions passées; l'épidictique, qui porte sur l'appréciation d'un éloge ou d'une censure. Chacun comprend ses types d'arguments spécifiques. Aristote élabore encore la théorie des lieux communs ou topoï, catégories
EXPERTS DU BIEN DIRE
• L’éloquence, avant de devenir un ensemble de règles concernant le discours et l'écriture, jusqu'à devenir parfois une stylistique, puise ses racines dans la rhétorique, qui est parfois prise comme son synonyme.
• La rhétorique serait apparue vers le viiie -vie siècle avant notre ère, c'est-à-dire, dans l'histoire de l'humanité, au moment de la conversion d'une pensée mythique en une pensée théorique : en même temps qu'il met en place le régime démocratique en Gréce, l'homme développe ses facultés argumentatives et fictionnelles, cherche à construire des discours persuasifs, illustrant le mieux possible les idées à défendre, les jugements à établir, les éloges à composer. La chrétienté reprendra les versions antiques de l'éloquence mise au service de la foi, en faisant de la parole et du récit les vecteurs de la persuasion et des sentiments, contre la raison dialectique.
• Les siècles suivants approfondissent réinventent et diversifient ces réflexions et ces méthodes sur le «bien dire», tour à tour critiquées comme décadentes, car cherchant l'efficacité plus que le vrai, puis mises au service de celui-ci, ensuite réduites à des canons littéraires, critiquées parfois parce qu'opposées à la liberté créatrice et au sentiment naturel, enfin remises au goût du jour au nom de la communication ...
• L'éloquence est en fait aussi ancienne que la parole, et nombre de grands maîtres balisent l'histoire de la pensée et de la littérature.
LA DIALECTIQUE
La dialectique se distingue de la rhétorique en tant qu'art de la discussion qui prend en compte le contenu du discours, et reste revendiquée par les philosophes d'inspiration idéaliste comme une technique plus honnête, qui fait progresser les idées; elle tend à accuser la rhétorique de se soucier seulement de l'opinion et de la forme - opposition qui réapparaît dans des débats ultérieurs récurrents, esthétiques aussi bien que politiques.
«
•
Pierre de La Ramée {1515-1572)
recentre la
rhétorique sur
le choix des
contenus, en
négligeant
davantage les
aspects formels
du discours : il
engage ainsi une
nouvelle façon de définir le savoir au
sein du discours, plus relatif, et
réordonne les figures de style.
• La position catholique met davantage
en valeur la beauté sublime des textes
sacrés, dont la vérité demeure en partie
inaccessible -ce que l'esthétique
baroque exaltera.
• Sur le plan politique, l'éloquence
répond également à de nouvelles
exigences : celles des cours italiennes
et espagnoles par exemple, que sert
Baldassare Castiglione (1478-1529),
auteur du fameux traité du Courtisan.
• Ces pensées ne vont pas sans travail
sur la langue : l'aspect philologique de
la rhétorique n'est pas en reste, et les
grammaires philosophiques comme celle
de Scaliger {1484-1558) se multiplient.
l'ESPRIT BAROQUE
• La Contre-Réforme est mise en place
par le pouvoir catholique pour ramener
ses ouailles à la vraie foi, ce qui entraîne
une revalorisation de l'éloquence
envisagée comme outil de persuasion et
d'enseignement -et correspond, dans
son ensemble, à l'esthétique baroque,
qui se développe jusqu'au milieu du
XVIWSiècle.
• Les jésuites sont célèbres pour avoir
raffiné la technicité de la rhétorique
cicéronienne, en mettant en avant la
culture des lettres plutôt que la logique
et la philosophie.
• D'autres courants existent, au sein de
l'Église, mais aussi dans l'institution
judiciaire, qui mettent en avant
l'inspiration pieuse et naturelle,
dénonçant les risques d'une corruption
de l'éloquence : la magistrature, avec
Guillaume Du Vair (1556-162 1), réactive
le débat sur la décadence, qui sous-tend
la question de l'éloquence depuis ses
origines.
Les prédications, dans tous les
cas, se multiplient En Grande-Bretagne,
l'anglicanisme voit s'épanouir des
conceptions du langage favorisant ,fi_ ..
,/ '� la
représentation
la plus juste,
dont celle du
sentimen� à la
fois dans son
raffinement
complexe et
dans la visée
d'une grande
pureté.
Les
sermons et poésies de John Donne
(157 2-1631) en témoignent.
•
De manière générale, l'éloquence de
cette période met le pathos en avan�
dans l'intérêt de la communication :
la musique et les arts plastiques en
témoignent également.
La sensibilité
et les passions sont prises au sérieux,
pour développer par exemple la notion
de sublime, si caractéristique de
l'éloquence sacrée.
• Les vers de François de Malherbe
{1555-1628), déjà classiques, ne sont
pas dépourvus d'élan lyrique, même
si l'auteur prêche pour une langue
dépouillée, sans archaïsme, fruit d'un
travail rigoureux.
• Les auteurs français toutefois n'iront
pas jusqu'aux effets sophistiqués de
l'Italien Giambattista Marino (1569-
1625), ni vers l'hermétisme espagnol du
poète Luis de G6ngora y Argote {1561-
1627).
En Espagne, le jésuite Baltasar
Gracian y Morales (1601-1658), avec son
Traité des pointes et du bel esprit
{1648), enseigne à manier la concision
spirituelle à des fins satiriques.
• Le libertinage érudit, avec François de
La Mothe Le Vayer {1588-1672), reprend
l'aspect philosophique et politique de
l'éloquence.
Dans la seconde moitié
du XVII' siècle, les manières toujours plus
affectées aboutissent à la préciosité,
à de nouveaux manuels du courtisan,
dont l'esprit pragmatique restera
longtemps une donnée de la rhétorique
moderne.
l'ÂGE CLASSIQUE
• La période classique affirme plus que
jamais le pouvoir d'autorité du mot,
dont on attend qu'il représente les
choses : c'est donc le logos qui est
privilégié, maîtrisable par des règles,
fondées en référence à la logique
-la fondation de l'Académie française
par Richelieu en 1635, au service de
la monarchie, œuvre en ce sens.
Les
maîtres du bien dire et du bien écrire,
tel Vaugelas (1585-1650), se distinguent
• Les philosophes empiristes repensent
le poids des mots dans notre rapport
au monde; un rationaliste comme René
Descartes {1596-1650) propose des
règles, une méthode dont les préceptes
montrent sa considération pour une
rhétorique apparentée à la dialectique.
• La prédication reste un genre où brille
l'éloquen ce:
Bossuet
(1627-1704),
l'« Aigle de
Meaux»
dont les
oraisons
sont
fameuses,
passe pour
l'un des plus grands représentants du
courant classique.
• �école française de spiritualité, qui
regroupe les savants de Port-Royal, prône
à nouveau l'humilité chrétienne,
à exprimer suivant les inspirations du
cœur- ce que
Boileau {1636-
1711) puis Bernard
Lamy {1640-1715)
traduiront sur un
plan plus littéraire
et linguistique.
Ainsi, clarté et
brièveté de la
belle prose,
au service d'une norme volontiers
politique, se marient à une exigence
d'authenticité qui peut rester
contestataire.
• Blaise Pascal (1623-1662) pose la
question radicale de la moralité de
la persuasion, devant la complexité
de l'âme humaine et admet une
indétermination irrésoluble, comme
Dominique Bouhours {162B-1702),
qui, en jésuite, la relie au Beau, pour
proposer une vision nouvelle des figures
de style -et contre les rationalistes, qui
enregistrent toutefois l'importance du
sentiment.
DU XVIII • SIÈCLE À NOS JOURS
• Le XVII' siècle avait mis en évidence
le débat entre les philosophes et les
maîtres de l'éloquence sacrée sur
l'importance du cœur dans le choix des
mots.
Le siècle des Lumières tiendra
largement pour acquise la combinaison
de la raison et des sentiments -jusqu'à
réduire l'éloquence à la littérature,
puis à l'en exclure, paradoxalement,
à l'époque du romantisme.
• C'est tard dans le XX' siècle que
les sciences du langage et de la
communication rendront hommage
à l'art du discours qui ne disait plus
son nom.
L'ÉLOQUENCE DES LUMIÈRES
�éloquence, comprise comme un art de
l'artifice conservateur, pouvait paraître
fragilisée aux débuts du XVIII' siècle.
Elle
est de plus en plus assimilée aux belles
lettres et menacée en leur sein, au fur
et à mesure que se développe le genre
romanesque, qui échappe aux canons.
• Le sublime fait de nouveau florès, en
particulier avec l'esthétique anglaise
d'Edmund Burke {1729-17 97).
Parmi les
encyclopédistes, Marmontel {1723-
1799) assimile
clairement la poésie à
l'éloquence.
Des
philosophes
voient dans
le langage une
création propre
à l'homme, et, au sujet individuel,
susceptible de dire sa vérité profonde,
voire ses origines et son
1-------------.J.._-------------1 développement: Vico (1668-1744) dote
RÉFORME ET CONTRE-RÉFORME
les tropes (figures de style) d'une force
• Au nom de la parole évangélique,
• Les textes sur l'éloquence du
spiritualiste et d'un sens historique.
De
l'Allemand Martin Luther {1483-1546)
Hollandais Érasme (v.
1469-1536),
multiples traités stylistiques, tel celui de
réagit contre l'Église romaine et
comme L'Ecclésiaste ou la manière
Dumarsais {1676-1756), engagent de
semble orienter la Réforme dans
de prêcher (1535), sont exemplaires
grands débats parmi les grammairiens
le sens d'un discours moral
de ce conflit, qui déchire la foi
philosophes, nourris de considérations
nécessairement plus lucide, plus sobre
chrétienne, et des enjeux
savantes sur la formation des langues,
et plus authentique.
La doctrine de la philosophiques de la rhétorique.
qui cherchent à estimer la place de la
grâce, toutefois, aboutit à l'importance
• Les catholiques comme l'Italien
sensation, de la pensée et du langage
du pathos- celui-ci souvent associé Pietro Bembo {1470-15 47), qui codifie
dans leurs rapports.
à la foi et à la propagande catholique:
la langue italienne, enregistrent la • Denis Diderot {1713-1784) reprend à
cette ambiguné rejoint en fait les
beauté du langage, mais en continuant Sénèque son Paradoxe du comédien
thèses de Cicéron, alors très
naturellement d'exiger un contenu
pour dire la complexité de l'émotion
commenté.
rigoureux et moral.
de
l'orateur.
•
Jean-Jacques Rousseau {1712-1778 )
met en avant
la force des
partisans de
la révolution
voient en lui le
véhicule d'une pensée universelle.
· Emmanuel Kant {1724-1804), même
s'il s'intéresse aux forces de
l'imagination et au sublime, reste
méfiant quant à l'éloquence, réduite à
une technique fourbe.
Globalement, ce
sont les défenseurs du logos et de son
universalité qui l'emportent à la fin du
siècle.
• �éloquence révolutionnaire est bien
connue et les grands orateurs ne
manquent pas aux tribunes : formés
dans des collèges qui leur avaient
inculqué un héritage antique et
marqués par la vogue contemporaine
du sentiment, ils se distinguent par des
styles de paroles très forts : ainsi des
formules de Mirabeau {1749-1791 ), de
l'inspiration verbale de Danton {1759-
1794), des discours enflammés de
Robespie"e {1758-1794).
Mais simultanément,
l'enseignement
de la rhétorique
est remplacé,
dans les écoles,
par celui de la
grammaire et de la littérature.
PHILOSOPHES CONTRE ROMANTIQUES?
• Le siècle de la science et de l'industrie
triomphantes voit s'exprimer plus fort
que jamais, par réaction, les désirs de
puissance et les passions.
• Le romantisme éclaire toujours plus,
- mais sur un plan poétique -la force
d'action de l'éloquence, tout en
proclamant la mort de la rhétorique
comprise comme un ensemble de
canons qui briderait la liberté de
l'écrivain génial et
comme un outil
monarchiste.
D'où
les menaces de
Vidor Hugo
{1802-1885) contre
les règles
classiques, par
exemple.
Le conseil de Paul Verlaine
(1844-1896), dans
son Art poétique :
«Prends
l'éloquence et
tords-lui son
cou!» lui fait
d'ailleurs écho.
• Les poètes allemands, grands
admirateurs de l'Antiquité, visent
davantage une beauté éternelle et
renouent avec certaines positions
mystiques sur le langage et l'ineffable,
mais tous visent l'expression d'une
intimité fondée sur la suggestion,
ouvrant ainsi la littérature au fantastique
et postulant une communion entre
auteur et lecteur.
• Les Mémoires, comme ceux de
François René de Chateaubriand {1768-
1848), succèdent aux confessions ...
dans une langue subjective, qui invente
au fur et à mesure ses propres lois.
Le
ton de la révolte et de la provocation entre
également
en
littérature, au
nom du génie,
avec lord
Byron {1788-
1824), puis
Charles
Baudelaire
{182 1-1867) -qui osera en outre écrire
des «poèmes en prose».
• Les philosophes du XIX' siècle -dont
les Allemands Arthur Schopenhauer
{17 88-1860) et Friedr ich Nietzsche
{1844-1900) -approfondissent les
enjeux du langage et la question de
ses origines, mais ils cherchent aussi à
repenser les figures -par exemple,
Les Figures du discours {1821-1830),
de Pierre Fontanier (fin XVIII'-XIX' siècle).
LE xx• SIÈCLE
• Le xX' siècle revend ique peu
l'éloquence : la linguistique, déployée
considérablement dans le fil
structuraliste du Suisse Ferdinand de
Saussure {1857-1913), a pris pour objets
d'étude langue et langage; les genres
littéraires perdent toujours plus leur
légitimité.
�essor de la narratologie
dans les études littéraires dit assez,
cependant, que l'on retrouve par
d'autres voies certains centres d'intérêt
antiques et classiques, comme la
technique de la disposition -mais
confinée à la fiction écrite.
• Les philosophes, de leur côté,
s'intéressent toujours plus explicitement
à la dimension de représentation en jeu
dans le langage, avec une tendance
anglo-saxonne analytique et
pragmatique, qui a su développer une
discipline adjacente : la sémiotique.
• Par ailleurs, les crises et la Seconde
Guerre mondiale ont relancé à la fois
la méfiance quant à une éloquence au
service de la politique et la nécessité
d'étudier le discours pour mieux en
comprendre les pouvoirs -cette
période correspond donc, à son tour,
à un retour du pôle privilégié du logos
sur l'ethos et le pathos.
• �ère de la communication cependant,
ne néglige pas ce dernier avec pour
originalité une pensée de l'efficacité de
l'image.
À côté de grands penseurs du
langage comme les Britanniques
Bertrand Russell {1872-1970) et Ludwig
Wittgenstein {1889-1951, d'origine
autrichienne).
le Français Michel
Foucault {1926-1984), 1'Américain John
Rogers Searle (né en 1932), il
conviendrait presque de signaler les
noms de grands publicistes, ou des
conseillers en communication des
cabinets politiques et des grandes
entreprises, des écrivains-orateurs
comme André Malraux {1901-1976),
voire des saltimbanques, tel Fabrice
Luchini (né en 1951).
• De manière plus académique, se
développent des études sur
l'argumentation, avec les travaux de
Chaïm Perelman (né en 1912) et
d'Oswald Ducrot (né en 1930).
Les
théories littéraires ne cherchent plus à
prédéfinir le beau ou le sensible, mais à
comprendre les effets du littéraire (dont
le statut reste souven t indéterminé) sur
le lecteur, héritant finalement en cela de
la rhétorique la plus ancienne.
Pas
de surprise donc si les figures, à la
charnière des XX' et XXI' siècles, sont de
nouveau étudiées -en particulier la
métaphore..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Grand oral du bac : Arts et Culture L'ART DE LA PHOTOGRAPHIE
- Grand oral du bac : Arts et Culture LE BAUHAUS
- Grand oral du bac : Arts et Culture LE BAROQUE
- Grand oral du bac : WALT DISNEY
- Grand oral du bac : GEORGE ORWELL