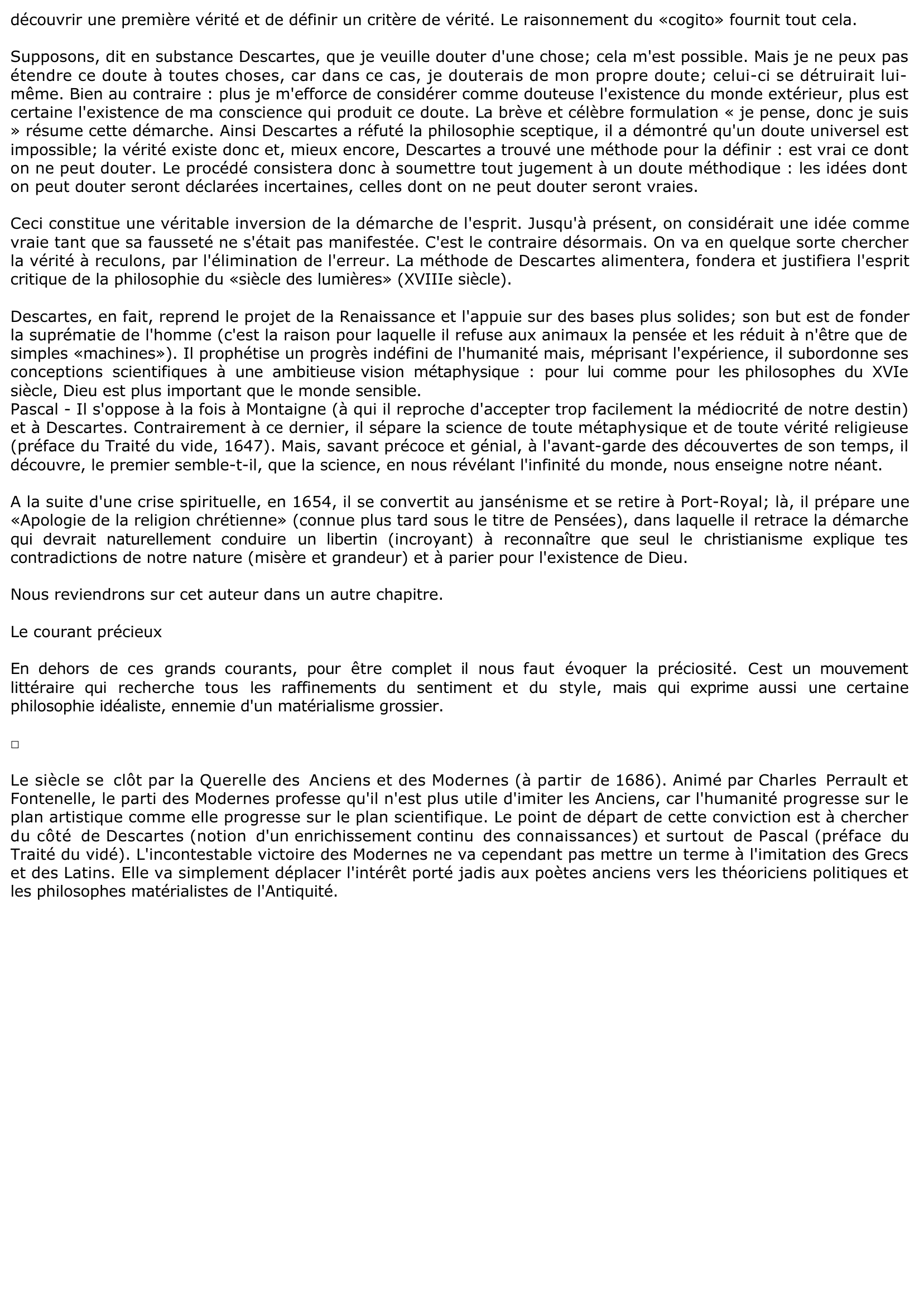HISTOIRE LITTERAIRE: LE XVIIe SIÈCLE
Publié le 22/02/2012

Extrait du document


«
découvrir une première vérité et de définir un critère de vérité.
Le raisonnement du «cogito» fournit tout cela.
Supposons, dit en substance Descartes, que je veuille douter d'une chose; cela m'est possible.
Mais je ne peux pasétendre ce doute à toutes choses, car dans ce cas, je douterais de mon propre doute; celui-ci se détruirait lui-même.
Bien au contraire : plus je m'efforce de considérer comme douteuse l'existence du monde extérieur, plus estcertaine l'existence de ma conscience qui produit ce doute.
La brève et célèbre formulation « je pense, donc je suis» résume cette démarche.
Ainsi Descartes a réfuté la philosophie sceptique, il a démontré qu'un doute universel estimpossible; la vérité existe donc et, mieux encore, Descartes a trouvé une méthode pour la définir : est vrai ce donton ne peut douter.
Le procédé consistera donc à soumettre tout jugement à un doute méthodique : les idées donton peut douter seront déclarées incertaines, celles dont on ne peut douter seront vraies.
Ceci constitue une véritable inversion de la démarche de l'esprit.
Jusqu'à présent, on considérait une idée commevraie tant que sa fausseté ne s'était pas manifestée.
C'est le contraire désormais.
On va en quelque sorte chercherla vérité à reculons, par l'élimination de l'erreur.
La méthode de Descartes alimentera, fondera et justifiera l'espritcritique de la philosophie du «siècle des lumières» (XVIIIe siècle).
Descartes, en fait, reprend le projet de la Renaissance et l'appuie sur des bases plus solides; son but est de fonderla suprématie de l'homme (c'est la raison pour laquelle il refuse aux animaux la pensée et les réduit à n'être que desimples «machines»).
Il prophétise un progrès indéfini de l'humanité mais, méprisant l'expérience, il subordonne sesconceptions scientifiques à une ambitieuse vision métaphysique : pour lui comme pour les philosophes du XVIesiècle, Dieu est plus important que le monde sensible.Pascal - Il s'oppose à la fois à Montaigne (à qui il reproche d'accepter trop facilement la médiocrité de notre destin)et à Descartes.
Contrairement à ce dernier, il sépare la science de toute métaphysique et de toute vérité religieuse(préface du Traité du vide, 1647).
Mais, savant précoce et génial, à l'avant-garde des découvertes de son temps, ildécouvre, le premier semble-t-il, que la science, en nous révélant l'infinité du monde, nous enseigne notre néant.
A la suite d'une crise spirituelle, en 1654, il se convertit au jansénisme et se retire à Port-Royal; là, il prépare une«Apologie de la religion chrétienne» (connue plus tard sous le titre de Pensées), dans laquelle il retrace la démarchequi devrait naturellement conduire un libertin (incroyant) à reconnaître que seul le christianisme explique tescontradictions de notre nature (misère et grandeur) et à parier pour l'existence de Dieu.
Nous reviendrons sur cet auteur dans un autre chapitre.
Le courant précieux
En dehors de ces grands courants, pour être complet il nous faut évoquer la préciosité.
Cest un mouvementlittéraire qui recherche tous les raffinements du sentiment et du style, mais qui exprime aussi une certainephilosophie idéaliste, ennemie d'un matérialisme grossier.
□
Le siècle se clôt par la Querelle des Anciens et des Modernes (à partir de 1686).
Animé par Charles Perrault etFontenelle, le parti des Modernes professe qu'il n'est plus utile d'imiter les Anciens, car l'humanité progresse sur leplan artistique comme elle progresse sur le plan scientifique.
Le point de départ de cette conviction est à chercherdu côté de Descartes (notion d'un enrichissement continu des connaissances) et surtout de Pascal (préface duTraité du vidé).
L'incontestable victoire des Modernes ne va cependant pas mettre un terme à l'imitation des Grecset des Latins.
Elle va simplement déplacer l'intérêt porté jadis aux poètes anciens vers les théoriciens politiques etles philosophes matérialistes de l'Antiquité..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- L'Histoire du Roman du XVIIe siècle à nos jours
- Un peu d’histoire… La notion de dérivée a vu le jour au XVIIe siècle dans les écrits de Leibniz et de Newton qui la nomme fluxion et qui la définit comme « le quotient ultime de deux accroissements évanescents ».
- Les médailles: des origines au milieu du XVIIe siècle (HISTOIRE).
- LA PRÉCIOSITÉ (XVIIe siècle) - HISTOIRE.
- Selon A. Adam, le théâtre racinien dépeint « un monde cruel, peuplé d'êtres pas-sionnés et faibles, entraînés par les fatalités de leur sang. » (Histoire de la litté¬rature française au xviie siècle). Commentez cette affirmation, à la lumière de vos lectures des tragédies raciniennes.