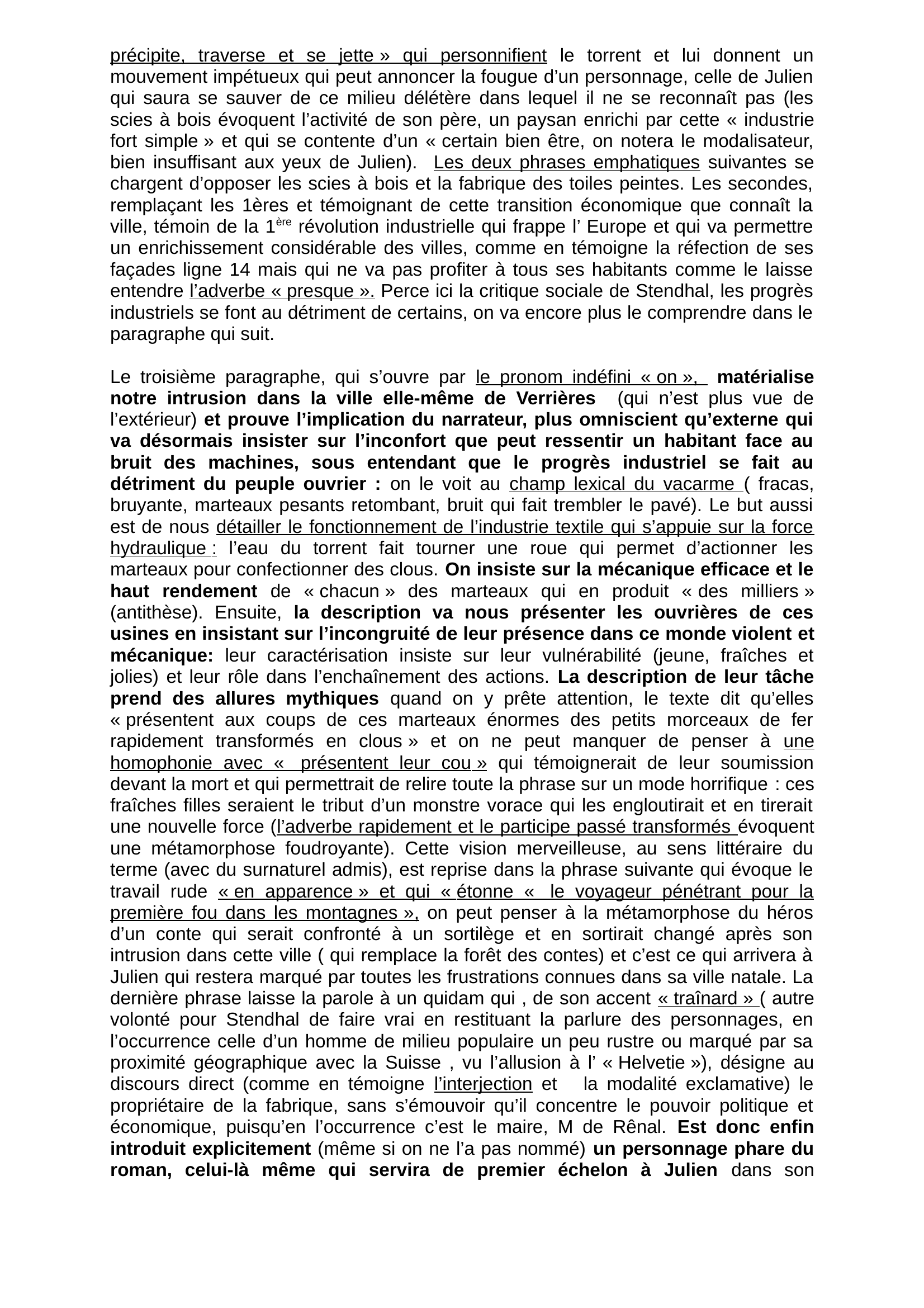incipit rouge et noir
Publié le 26/11/2020
Extrait du document
«
précipite, traverse et se jette » qui personnifient le torrent et lui donnent un
mouvement impétueux qui peut annoncer la fougue d’un personnage, celle de Julien
qui saura se sauver de ce milieu délétère dans lequel il ne se reconnaît pas (les
scies à bois évoquent l’activité de son père, un paysan enrichi par cette « industrie
fort simple » et qui se contente d’un « certain bien être, on notera le modalisateur,
bien insuffisant aux yeux de Julien).
Les deux phrases emphatiques suivantes se
chargent d’opposer les scies à bois et la fabrique des toiles peintes.
Les secondes,
remplaçant les 1ères et témoignant de cette transition économique que connaît la
ville, témoin de la 1 ère
révolution industrielle qui frappe l’ Europe et qui va permettre
un enrichissement considérable des villes, comme en témoigne la réfection de ses
façades ligne 14 mais qui ne va pas profiter à tous ses habitants comme le laisse
entendre l’adverbe « presque ».
Perce ici la critique sociale de Stendhal, les progrès
industriels se font au détriment de certains, on va encore plus le comprendre dans le
paragraphe qui suit.
Le troisième paragraphe, qui s’ouvre par le pronom indéfini « on », matérialise
notre intrusion dans la ville elle-même de Verrières (qui n’est plus vue de
l’extérieur) et prouve l’implication du narrateur, plus omniscient qu’externe qui
va désormais insister sur l’inconfort que peut ressentir un habitant face au
bruit des machines, sous entendant que le progrès industriel se fait au
détriment du peuple ouvrier : on le voit au champ lexical du vacarme ( fracas,
bruyante, marteaux pesants retombant, bruit qui fait trembler le pavé).
Le but aussi
est de nous détailler le fonctionnement de l’industrie textile qui s’appuie sur la force
hydraulique : l’eau du torrent fait tourner une roue qui permet d’actionner les
marteaux pour confectionner des clous.
On insiste sur la mécanique efficace et le
haut rendement de « chacun » des marteaux qui en produit « des milliers »
(antithèse).
Ensuite, la description va nous présenter les ouvrières de ces
usines en insistant sur l’incongruité de leur présence dans ce monde violent et
mécanique: leur caractérisation insiste sur leur vulnérabilité (jeune, fraîches et
jolies) et leur rôle dans l’enchaînement des actions.
La description de leur tâche
prend des allures mythiques quand on y prête attention, le texte dit qu’elles
« présentent aux coups de ces marteaux énormes des petits morceaux de fer
rapidement transformés en clous » et on ne peut manquer de penser à une
homophonie avec « présentent leur cou » qui témoignerait de leur soumission
devant la mort et qui permettrait de relire toute la phrase sur un mode horrifique : ces
fraîches filles seraient le tribut d’un monstre vorace qui les engloutirait et en tirerait
une nouvelle force ( l’adverbe rapidement et le participe passé transformés évoquent
une métamorphose foudroyante).
Cette vision merveilleuse, au sens littéraire du
terme (avec du surnaturel admis), est reprise dans la phrase suivante qui évoque le
travail rude « en apparence » et qui « étonne « le voyageur pénétrant pour la
première fou dans les montagnes », on peut penser à la métamorphose du héros
d’un conte qui serait confronté à un sortilège et en sortirait changé après son
intrusion dans cette ville ( qui remplace la forêt des contes) et c’est ce qui arrivera à
Julien qui restera marqué par toutes les frustrations connues dans sa ville natale.
La
dernière phrase laisse la parole à un quidam qui , de son accent « traînard » ( autre
volonté pour Stendhal de faire vrai en restituant la parlure des personnages, en
l’occurrence celle d’un homme de milieu populaire un peu rustre ou marqué par sa
proximité géographique avec la Suisse , vu l’allusion à l’ « Helvetie »), désigne au
discours direct (comme en témoigne l’interjection et la modalité exclamative) le
propriétaire de la fabrique, sans s’émouvoir qu’il concentre le pouvoir politique et
économique, puisqu’en l’occurrence c’est le maire, M de Rênal.
Est donc enfin
introduit explicitement (même si on ne l’a pas nommé) un personnage phare du
roman, celui-là même qui servira de premier échelon à Julien dans son.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Le Rouge et le Noir Incipit Analyse
- L'incipit extrait de « Le rouge et le Noir » de Stendhal
- Stendhal, LE ROUGE ET LE NOIR
- Oral Stendhal Le Rouge et le noir
- les personnages féminins dans le rouge et le noir