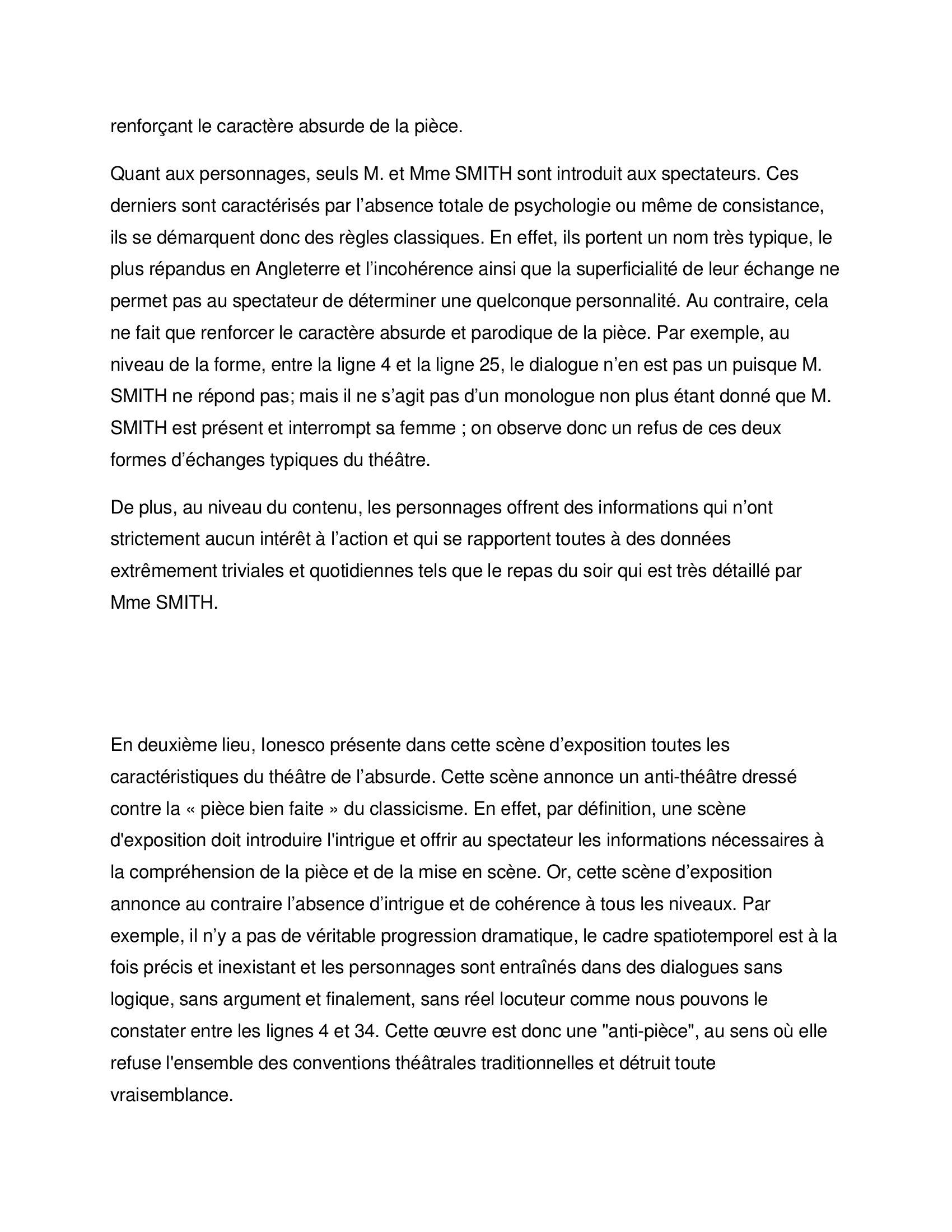Ionesco ou La Cantatrice Chauve, Commentaire
Publié le 15/03/2015

Extrait du document
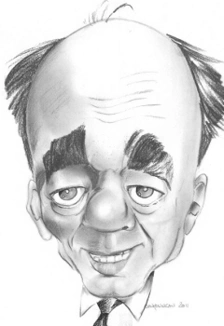
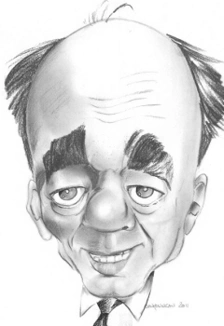
«
renforçant le caract ère absurde de la pi èce.
Quant aux personnages, seuls M. et Mme SMITH sont introduit aux spectateurs. Ces
derniers sont caract
éris és par l’absence totale de psychologie ou m ême de consistance,
ils se d
émarquent donc des r ègles classiques. En effet, ils portent un nom tr ès typique, le
plus r
épandus en Angleterre et l’incoh érence ainsi que la superficialit é de leur échange ne
permet pas au spectateur de d
éterminer une quelconque personnalit é. Au contraire, cela
ne fait que renforcer le caract
ère absurde et parodique de la pi èce. Par exemple, au
niveau de la forme, entre la ligne 4 et la ligne 25, le dialogue n’en est pas un puisque M.
SMITH ne r
épond pas; mais il ne s’agit pas d’un monologue non plus étant donn é que M.
SMITH est pr ésent et interrompt sa femme ; on observe donc un refus de ces deux formes d’ échanges typiques du th éâ tre. De plus, au niveau du contenu, les personnages offrent des informations qui n’ont strictement aucun int érêt à l’action et qui se rapportent toutes à des donn ées extr êmement triviales et quotidiennes tels que le repas du soir qui est tr ès d étaill é par Mme SMITH. En deuxi ème lieu, Ionesco pr ésente dans cette sc ène d’exposition toutes les caract éristiques du th éâ tre de l’absurde. Cette sc ène annonce un antith éâ tre dress é contre la « pi èce bien faite » du classicisme. En effet, par d éfinition, une sc ène d'exposition doit introduire l'intrigue et offrir au spectateur les informations n écessaires à la compr éhension de la pi èce et de la mise en sc ène. Or, cette sc ène d’exposition annonce au contraire l’absence d’intrigue et de coh érence à tous les niveaux. Par exemple, il n’y a pas de v éritable progression dramatique, le cadre spatiotemporel est à la fois pr écis et inexistant et les personnages sont entra înés dans des dialogues sans logique, sans argument et finalement, sans r éel locuteur comme nous pouvons le constater entre les lignes 4 et 34. Cette œuvre est donc une "antipi èce", au sens o ù elle refuse l'ensemble des conventions th éâ trales traditionnelles et d étruit toute vraisemblance.. »
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- CANTATRICE CHAUVE (la) d'Eugène Ionesco
- CANTATRICE CHAUVE (La) Eugène Ionesco. Anti-pièce en un acte
- La Cantatrice chauve d'Eugène Ionesco (analyse détaillée)
- Cantatrice chauve, la [Eugène Ionesco] - Fiche de lecture.
- Cantatrice chauve, la [Eugène Ionesco] - Fiche de lecture.