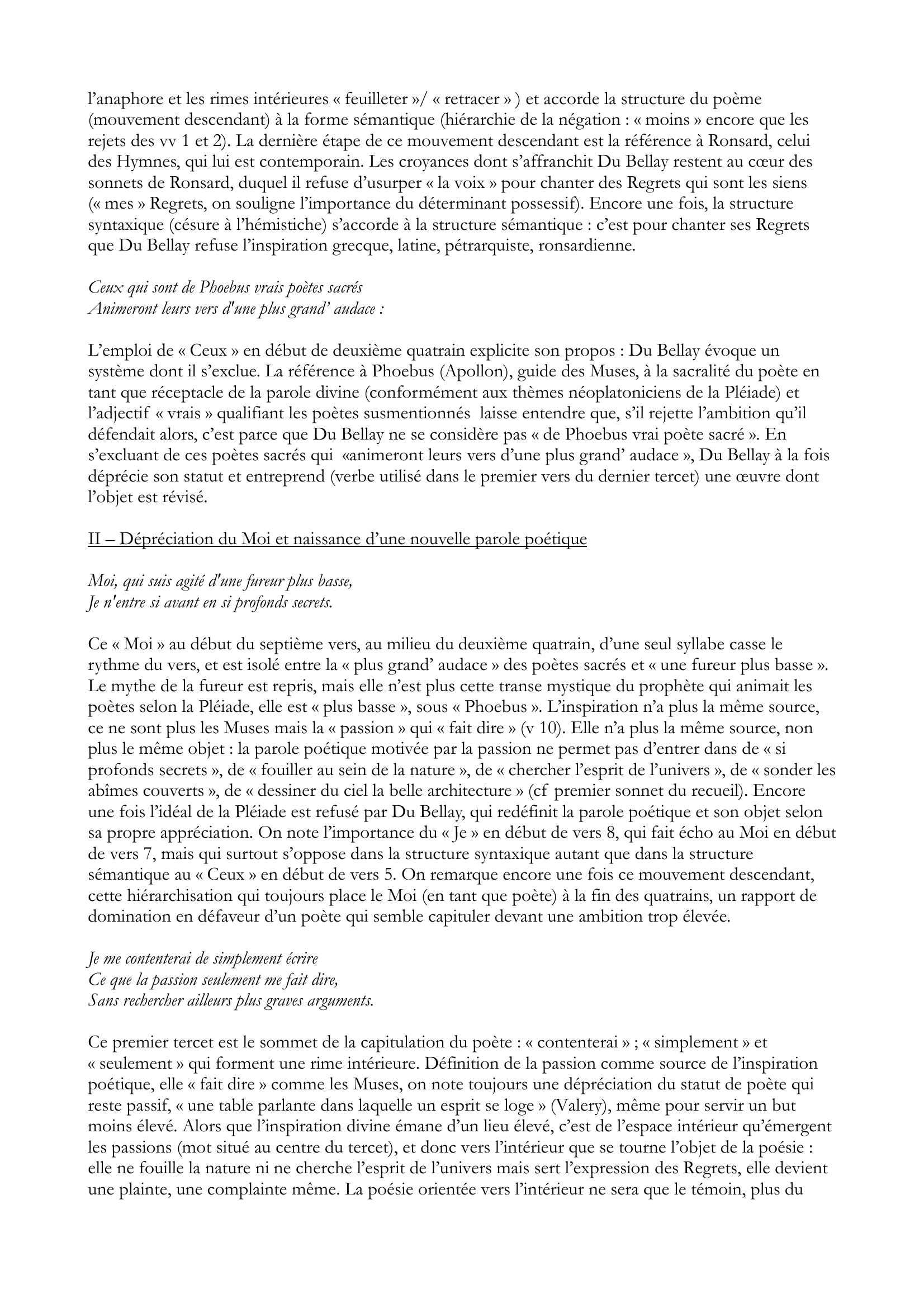Joachim du Bellay - Les regrets - Sonnet IV (Analyse et commentaire)
Publié le 07/10/2014

Extrait du document


«
l’anaphore et les rimes intérieures « feuilleter »/ « retracer » ) et accorde la structure du poème
(mouvement descendant) à la forme sémantique (hiéra rchie de la négation : « moins » encore que les
rejets des vv 1 et 2).
La dernière étape de ce mouv ement descendant est la référence à Ronsard, celui
des Hymnes, qui lui est contemporain.
Les croyances dont s’affranchit Du Bellay restent au cœur des
sonnets de Ronsard, duquel il refuse d’usurper « la voix » pour chanter des Regrets qui sont les siens
(« mes » Regrets, on souligne l’importance du déter minant possessif).
Encore une fois, la structure
syntaxique (césure à l’hémistiche) s’accorde à la s tructure sémantique : c’est pour chanter ses Regret s
que Du Bellay refuse l’inspiration grecque, latine, pétrarquiste, ronsardienne.
Ceux qui sont de Phoebus vrais poètes sacrés
Animeront leurs vers d'une plus grand’ audace :
L’emploi de « Ceux » en début de deuxième quatrain explicite son propos : Du Bellay évoque un
système dont il s’exclue.
La référence à Phoebus (A pollon), guide des Muses, à la sacralité du poète en
tant que réceptacle de la parole divine (conforméme nt aux thèmes néoplatoniciens de la Pléiade) et
l’adjectif « vrais » qualifiant les poètes susmenti onnés laisse entendre que, s’il rejette l’ambition qu’il
défendait alors, c’est parce que Du Bellay ne se co nsidère pas « de Phoebus vrai poète sacré ».
En
s’excluant de ces poètes sacrés qui «animeront leu rs vers d’une plus grand’ audace », Du Bellay à la fois
déprécie son statut et entreprend (verbe utilisé da ns le premier vers du dernier tercet) une œuvre don t
l’objet est révisé.
II – Dépréciation du Moi et naissance d’une nouvell e parole poétique
Moi, qui suis agité d'une fureur plus basse,
Je n'entre si avant en si profonds secrets.
Ce « Moi » au début du septième vers, au milieu du deuxième quatrain, d’une seul syllabe casse le
rythme du vers, et est isolé entre la « plus grand’ audace » des poètes sacrés et « une fureur plus ba sse ».
Le mythe de la fureur est repris, mais elle n’est p lus cette transe mystique du prophète qui animait l es
poètes selon la Pléiade, elle est « plus basse », s ous « Phoebus ».
L’inspiration n’a plus la même sou rce,
ce ne sont plus les Muses mais la « passion » qui « fait dire » (v 10).
Elle n’a plus la même source, non
plus le même objet : la parole poétique motivée par la passion ne permet pas d’entrer dans de « si
profonds secrets », de « fouiller au sein de la nat ure », de « chercher l’esprit de l’univers », de « sonder les
abîmes couverts », de « dessiner du ciel la belle a rchitecture » (cf premier sonnet du recueil).
Encor e
une fois l’idéal de la Pléiade est refusé par Du Be llay, qui redéfinit la parole poétique et son objet selon
sa propre appréciation.
On note l’importance du « J e » en début de vers 8, qui fait écho au Moi en début
de vers 7, mais qui surtout s’oppose dans la struct ure syntaxique autant que dans la structure
sémantique au « Ceux » en début de vers 5.
On remar que encore une fois ce mouvement descendant,
cette hiérarchisation qui toujours place le Moi (en tant que poète) à la fin des quatrains, un rapport de
domination en défaveur d’un poète qui semble capitu ler devant une ambition trop élevée.
Je me contenterai de simplement écrire Ce que la passion seulement me fait dire,
Sans rechercher ailleurs plus graves arguments.
Ce premier tercet est le sommet de la capitulation du poète : « contenterai » ; « simplement » et
« seulement » qui forment une rime intérieure.
Défi nition de la passion comme source de l’inspiration
poétique, elle « fait dire » comme les Muses, on no te toujours une dépréciation du statut de poète qui
reste passif, « une table parlante dans laquelle un esprit se loge » (Valery), même pour servir un but
moins élevé.
Alors que l’inspiration divine émane d ’un lieu élevé, c’est de l’espace intérieur qu’émergent
les passions (mot situé au centre du tercet), et do nc vers l’intérieur que se tourne l’objet de la poésie :
elle ne fouille la nature ni ne cherche l’esprit de l’univers mais sert l’expression des Regrets, elle devient
une plainte, une complainte même.
La poésie orienté e vers l’intérieur ne sera que le témoin, plus du.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- REGRETS (Les) Joachim Du Bellay. Résumé et analyse
- Les Regrets de Joachim du Bellay (analyse détaillée)
- REGRETS (les). Recueil poétique de joachim du Bellay (résumé & analyse)
- Commentaire : sonnet 32 des Regrets de Du Bellay
- Joachim Du Bellay, Les Regrets, sonnet VI « Las où est maintenant »