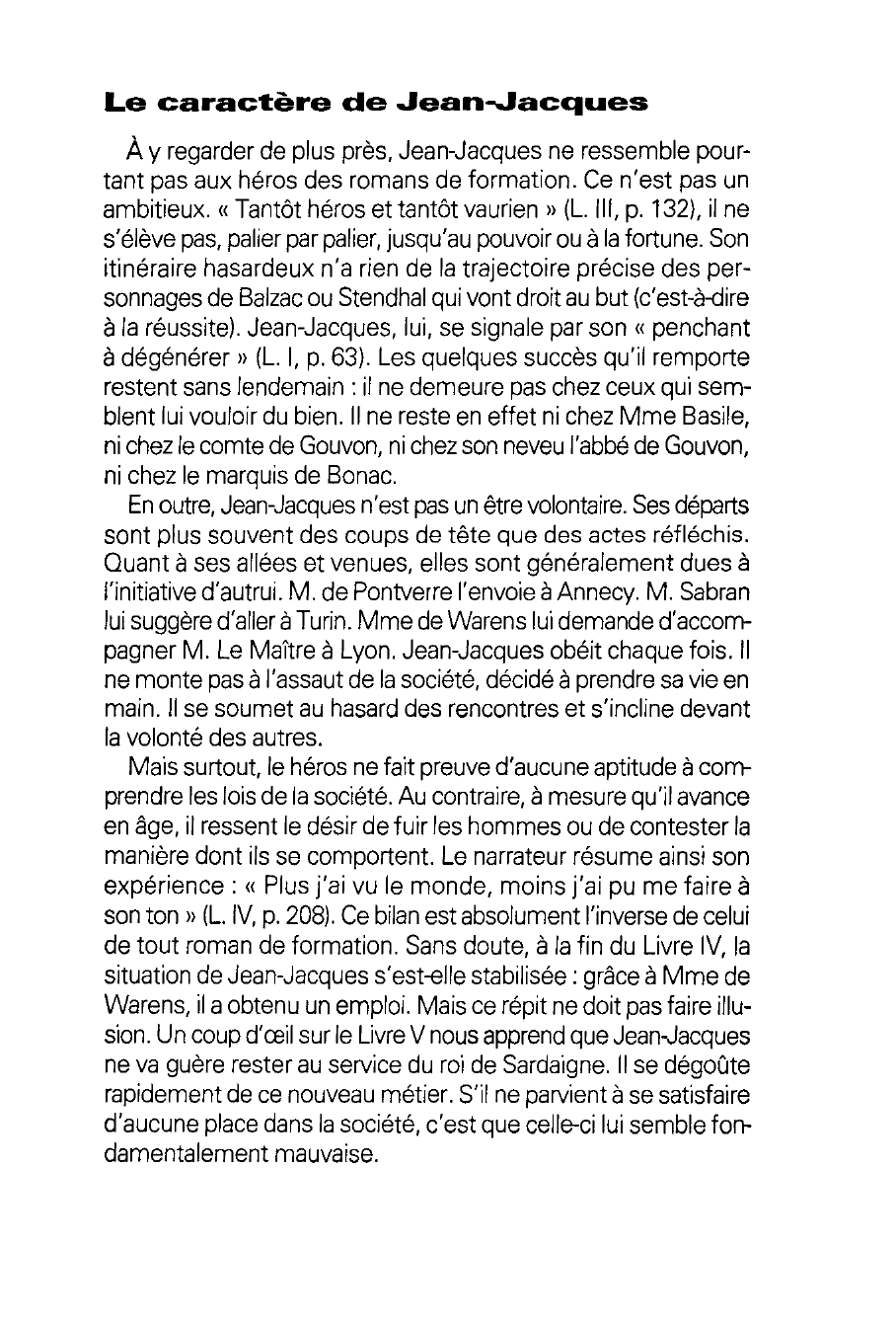La condamnation de la société chez Rousseau
Publié le 23/06/2015

Extrait du document


«
Le caractère de Jean-Jacques
À y regarder de plus près, Jean-Jacques ne ressemble pour
tant pas aux héros des romans de formation.
Ce n'est pas un
ambitieux.
«Tantôt héros et tantôt vaurien » (L.
Ill, p.
132}, il ne
s'élève pas, palier par palier, jusqu'au pouvoir ou à la fortune.
Son
itinéraire hasardeux n'a rien de la trajectoire précise des per
sonnages de Balzac ou Stendhal qui vont droit au but (c'est-à-dire
à la réussite}.
Jean-Jacques, lui, se signale par son « penchant
à dégénérer» (L.
1, p.
63}.
Les quelques succès qu'il remporte
restent
sans lendemain : il ne demeure pas chez ceux qui sem
blent lui vouloir du bien.
Il ne reste en effet ni chez Mme Basile,
ni chez le comte de Gouvon, ni chez son neveu l'abbé de Gouvon,
ni chez le marquis de Bonac.
En outre, Jean-Jacques n'est pas un être volontaire.
Ses départs
sont plus souvent des coups de tête que des actes réfléchis.
Quant à ses allées et venues, elles sont généralement dues à
l'initiative d'autrui.
M.
de Pontverre l'envoie à Annecy.
M.
Sabran
lui suggère d'aller à Turin.
Mme de Warens lui demande d'accom
pagner M.
Le Maître à Lyon.
Jean-Jacques obéit chaque fois.
Il
ne monte pas à l'assaut de la société, décidé à prendre sa vie en
main.
Il se soumet au hasard des rencontres et s'incline devant
la volonté des autres.
Mais surtout, le héros ne fait preuve d'aucune aptitude à corn
prendre les lois de la société.
Au contraire, à mesure qu'il avance
en âge, il ressent le désir de fuir les hommes ou de contester la
manière dont ils se comportent.
Le narrateur résume ainsi son
expérience : « Plus j'ai vu le monde, moins j'ai pu me faire à
son ton » (L.
IV, p.
208}.
Ce bilan est absolument l'inverse de celui
de tout roman de formation.
Sans doute, à la fin du Livre IV, la
situation de Jean-Jacques s'est-elle stabilisée: grâce à Mme de
Warens, il a obtenu un emploi.
Mais ce répit ne doit pas faire illu
sion.
Un coup d'œil sur le Livre V nous apprend que Jean-Jacques
ne va guère rester au service du roi de Sardaigne.
Il se dégoûte
rapidement de ce nouveau métier.
S'il ne parvient à se satisfaire
d'aucune place dans la société, c'est que celle-ci lui semble fon
damentalement mauvaise.
88.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Rousseau - Nature-Famille-Société
- Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes Jean-Jacques Rousseau Le premier qui, ayant enclos un terrain, s'avisa de dire : Ceci est à moi, et trouva des gens assez simples pour le croire, fut le vrai fondateur de la société civile.
- Qu'on admire tant qu'on voudra la société humaine, il n'en sera pas moins vrai qu'elle porte naturellement les hommes à s'entre-haïr, à proportion que les intérêts se croisent, à se rendre mutuellement des services apparents et à se faire, en effet, tous les maux imaginables. J.-J. Rousseau (note 9 du Discours sur l'inégalité)
- Rousseau fait la théorie de l'homme à l'état de nature et de l'établissement de la société
- L'organisation de l’Etat et de la société (Locke, Montesquieu et Rousseau)