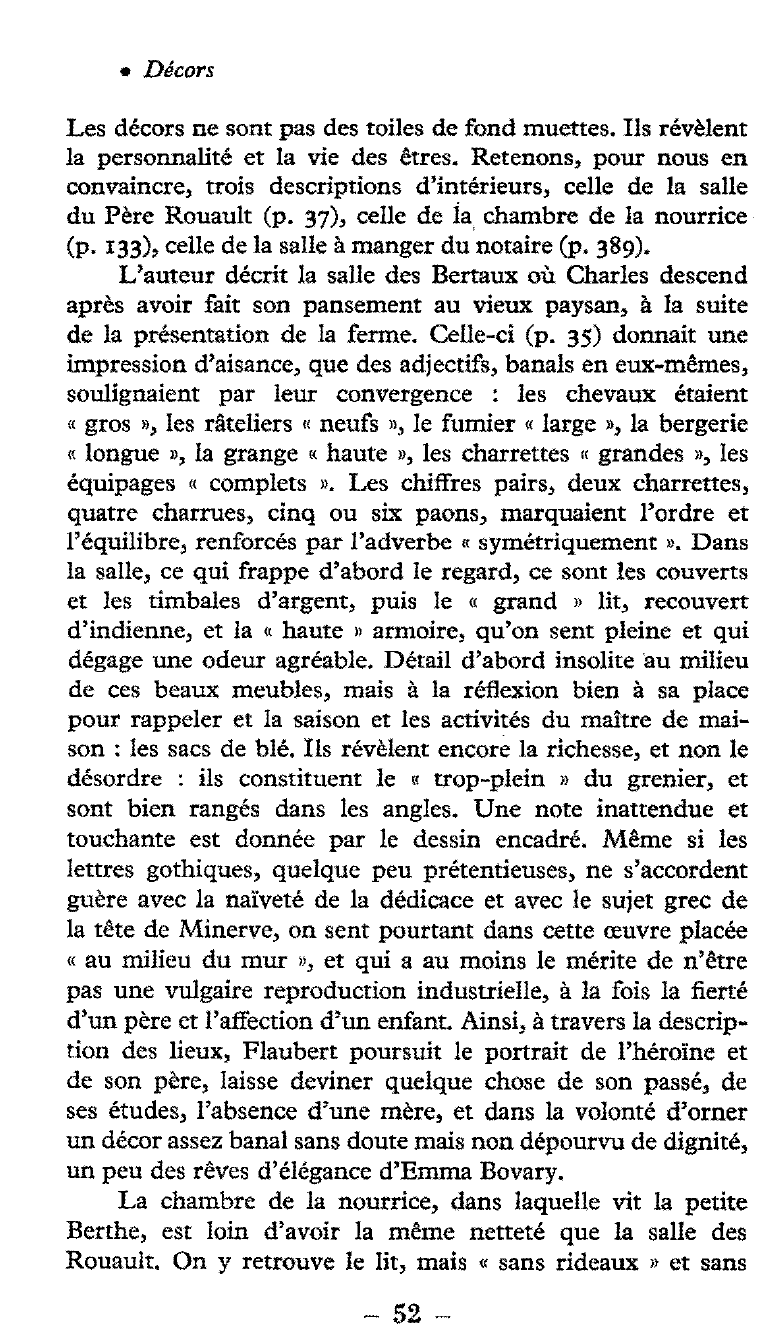LA DESCRIPTION dans Madame Bovary de Gustave Flaubert
Publié le 22/01/2020

Extrait du document
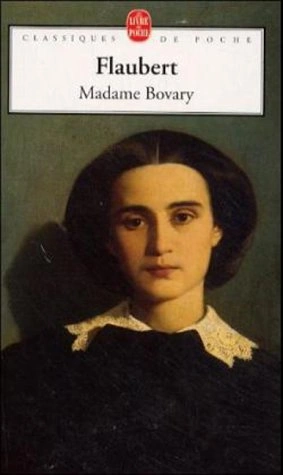
LA DESCRIPTION
• Le calme des choses et l’indifférence de la nature Inertes, privés de sentiment, les objets du monde extérieur sur lesquels se pose notre regard, quels rapports ont-ils avec notre conscience, avec nos rêveries, nos passions, nos projets? Quel sens ont-ils? Sont-ils liés à notre histoire, et comment ?
Leur calme, leur existence immobile de choses sans âme parfois nous étonne quand en nous le mouvement et la vie surabondent. Emma en fait l’expérience, après sa vaine conversation avec le curé. Elle a regagné sa chambre et retrouvé ses meubles familiers et « vaguement s’ébahissait à ce calme des choses, tandis qu’il y avait en elle-même tant de bouleversements » (p. 161). En d’autres circonstances, au contraire, le monde extérieur semble s’opposer à nous par sa vitalité et sa gaieté, mais toujours, en tout cas, par la même indifférence à ce que nous ressentons. C’est ainsi qu’à la troisième partie (p. 432), dans la scène de l’enterrement, un frais paragraphe descriptif évoquant « toutes sortes de bruits joyeux » et de couleurs claires contraste ironiquement avec le désespoir de Charles.
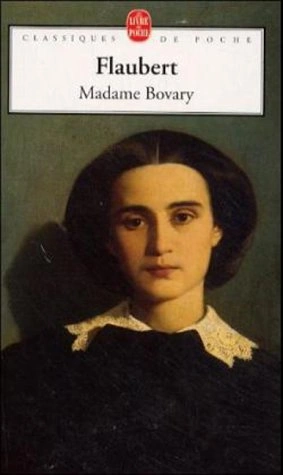
«
• Décors
Les décors ne sont pas des toiles de fond muettes.
Ils révèlent
la personnalité et la vie des êtres.
Retenons, pour nous en
convaincre, trois descriptions d'intérieurs, celle de la salle
du Père Rouault (p.
37), celle de ia.
chambre de la nourrice
(p.
133), celle de la salle à manger du notaire (p.
389).
L'auteur décrit la salle des Bertaux où Charles descend
après avoir fait son pansement au vieux paysan, à la suite
de la présentation de la ferme.
Celle-ci (p.
35) donnait une
impression d'aisance, que des adjectifs, banals en eux-mêmes,
soulignaient par leur convergence : les chevaux étaient
« gros •>, les râteliers « neufs '" le fumier « large », la bergerie
« longue •, la grange « haute '" les charrettes " grandes '" les équipages « complets "· Les chiffres pairs, deux charrettes,
quatre charrues, cinq ou six paons, marquaient l'ordre et
l'équilibre, renforcés par l'adverbe« symétriquement».
Dans
la salle, ce qui frappe d'abord le regard, ce sont les couverts
et les timbales d'argent, puis le « grand » lit, recouvert
d'indienne, et la « haute >> armoire, qu'on sent pleine et qui
dégage une odeur agréable.
Détail d'abord insolite au milieu
de ces beaux meubles, mais à la réflexion bien à sa place
pour rappeler et la saison et les activités du maître de mai
son : les sacs de blé.
Ils révèlent encore la richesse, et non le
désordre : ils constituent le « trop-plein >> du grenier, et
sont bien rangés dans les angles.
Une note inattendue et
touchante est donnée par le dessin encadré.
Même si les
lettres gothiques, quelque peu prétentieuses, ne s'accordent
guère avec la naïveté de la dédicace et avec le sujet grec de
la tête de Minerve, on sent pourtant dans cette œuvre placée
«au milieu du mur '" et qui a au moins le mérite de n'être
pas une vulgaire reproduction industrielle, à la fois la fierté
d'un père et l'affection d'un enfant.
Ainsi, à travers la descrip
tion des lieux, Flaubert poursuit le portrait de l'héroïne et
de son père, laisse deviner quelque chose de son passé, de
ses études, l'absence d'une mère, et dans la volonté d'orner
un décor assez banal sans doute mais non dépourvu de dignité,
un peu des rêves d'élégance d'Emma Bovary.
La chambre de la nourrice, dans laquelle vit la petite
Berthe, est loin d'avoir la même netteté que la salle des
Rouault.
On y retrouve le lit, mais « sans rideaux " et sans
- 52.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Analyse de Madame Bovary de Gustave Flaubert
- Ce corpus est composé de trois extraits, Le Rouge et le Noir écrit en 1830 par Stendhal, Le père Goriot écrit en 1835 par Honoré de Balzac, Madame Bovary écrit en 1857 par Gustave Flaubert.
- Gustave flaubert Madame de Bovary Chapitre 9 partie 2
- MADAME Bovary, de Gustave Flaubert
- Madame Bovary de Gustave Flaubert (Analyse)