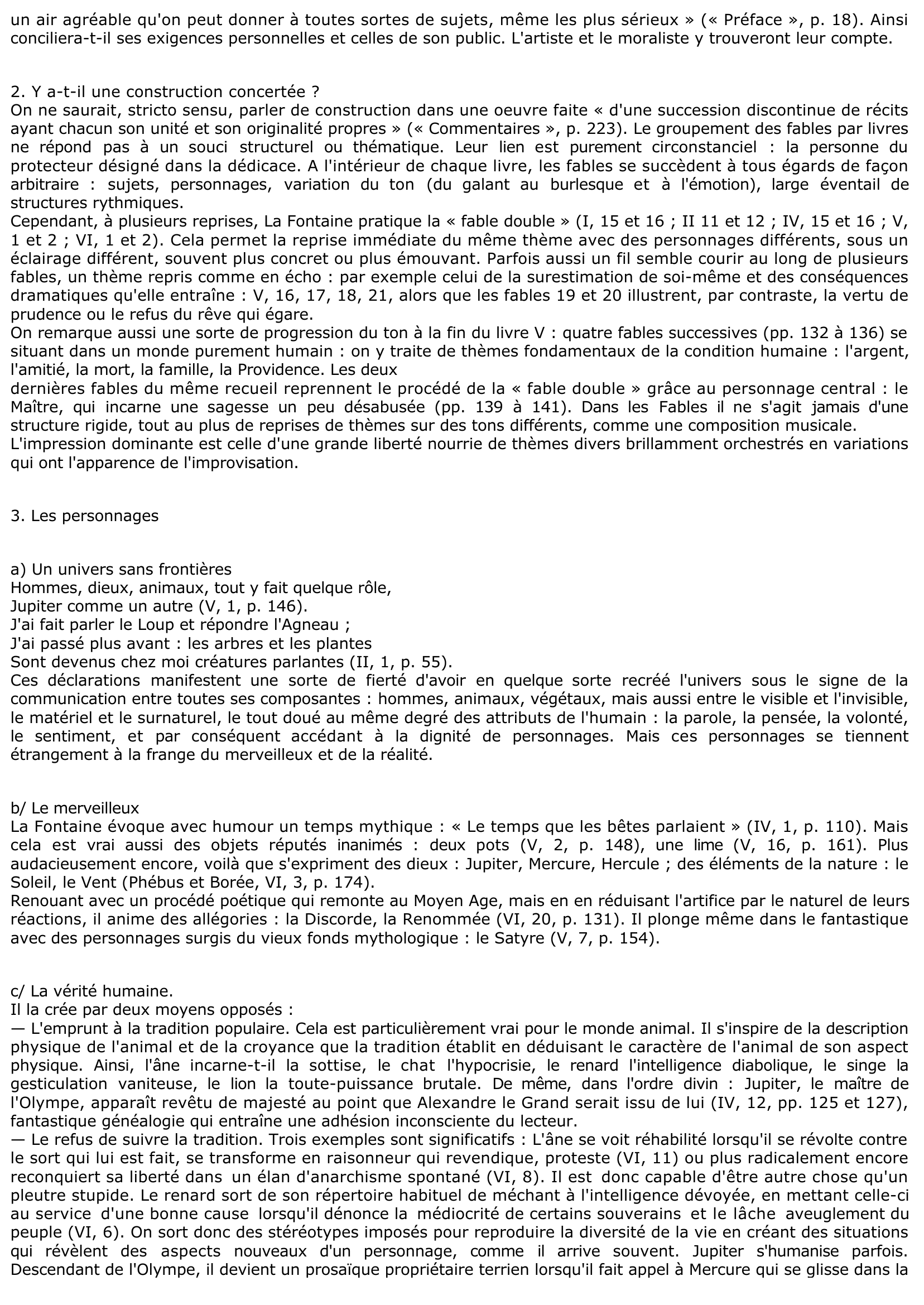LA FONTAINE - Fables - Livres I à VI
Publié le 22/02/2012

Extrait du document
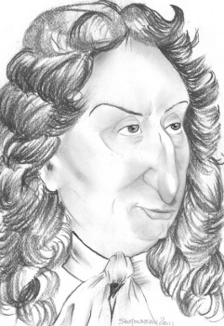
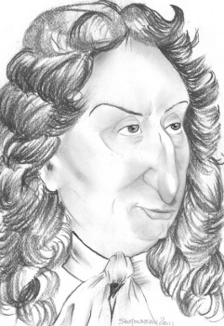
«
un air agréable qu'on peut donner à toutes sortes de sujets, même les plus sérieux » (« Préface », p.
18).
Ainsiconciliera-t-il ses exigences personnelles et celles de son public.
L'artiste et le moraliste y trouveront leur compte.
2.
Y a-t-il une construction concertée ?On ne saurait, stricto sensu, parler de construction dans une oeuvre faite « d'une succession discontinue de récitsayant chacun son unité et son originalité propres » (« Commentaires », p.
223).
Le groupement des fables par livresne répond pas à un souci structurel ou thématique.
Leur lien est purement circonstanciel : la personne duprotecteur désigné dans la dédicace.
A l'intérieur de chaque livre, les fables se succèdent à tous égards de façonarbitraire : sujets, personnages, variation du ton (du galant au burlesque et à l'émotion), large éventail destructures rythmiques.Cependant, à plusieurs reprises, La Fontaine pratique la « fable double » (I, 15 et 16 ; II 11 et 12 ; IV, 15 et 16 ; V,1 et 2 ; VI, 1 et 2).
Cela permet la reprise immédiate du même thème avec des personnages différents, sous unéclairage différent, souvent plus concret ou plus émouvant.
Parfois aussi un fil semble courir au long de plusieursfables, un thème repris comme en écho : par exemple celui de la surestimation de soi-même et des conséquencesdramatiques qu'elle entraîne : V, 16, 17, 18, 21, alors que les fables 19 et 20 illustrent, par contraste, la vertu deprudence ou le refus du rêve qui égare.On remarque aussi une sorte de progression du ton à la fin du livre V : quatre fables successives (pp.
132 à 136) sesituant dans un monde purement humain : on y traite de thèmes fondamentaux de la condition humaine : l'argent,l'amitié, la mort, la famille, la Providence.
Les deuxdernières fables du même recueil reprennent le procédé de la « fable double » grâce au personnage central : leMaître, qui incarne une sagesse un peu désabusée (pp.
139 à 141).
Dans les Fables il ne s'agit jamais d'unestructure rigide, tout au plus de reprises de thèmes sur des tons différents, comme une composition musicale.L'impression dominante est celle d'une grande liberté nourrie de thèmes divers brillamment orchestrés en variationsqui ont l'apparence de l'improvisation.
3.
Les personnages
a) Un univers sans frontièresHommes, dieux, animaux, tout y fait quelque rôle,Jupiter comme un autre (V, 1, p.
146).J'ai fait parler le Loup et répondre l'Agneau ;J'ai passé plus avant : les arbres et les plantesSont devenus chez moi créatures parlantes (II, 1, p.
55).Ces déclarations manifestent une sorte de fierté d'avoir en quelque sorte recréé l'univers sous le signe de lacommunication entre toutes ses composantes : hommes, animaux, végétaux, mais aussi entre le visible et l'invisible,le matériel et le surnaturel, le tout doué au même degré des attributs de l'humain : la parole, la pensée, la volonté,le sentiment, et par conséquent accédant à la dignité de personnages.
Mais ces personnages se tiennentétrangement à la frange du merveilleux et de la réalité.
b/ Le merveilleuxLa Fontaine évoque avec humour un temps mythique : « Le temps que les bêtes parlaient » (IV, 1, p.
110).
Maiscela est vrai aussi des objets réputés inanimés : deux pots (V, 2, p.
148), une lime (V, 16, p.
161).
Plusaudacieusement encore, voilà que s'expriment des dieux : Jupiter, Mercure, Hercule ; des éléments de la nature : leSoleil, le Vent (Phébus et Borée, VI, 3, p.
174).Renouant avec un procédé poétique qui remonte au Moyen Age, mais en en réduisant l'artifice par le naturel de leursréactions, il anime des allégories : la Discorde, la Renommée (VI, 20, p.
131).
Il plonge même dans le fantastiqueavec des personnages surgis du vieux fonds mythologique : le Satyre (V, 7, p.
154).
c/ La vérité humaine.Il la crée par deux moyens opposés :— L'emprunt à la tradition populaire.
Cela est particulièrement vrai pour le monde animal.
Il s'inspire de la descriptionphysique de l'animal et de la croyance que la tradition établit en déduisant le caractère de l'animal de son aspectphysique.
Ainsi, l'âne incarne-t-il la sottise, le chat l'hypocrisie, le renard l'intelligence diabolique, le singe lagesticulation vaniteuse, le lion la toute-puissance brutale.
De même, dans l'ordre divin : Jupiter, le maître del'Olympe, apparaît revêtu de majesté au point que Alexandre le Grand serait issu de lui (IV, 12, pp.
125 et 127),fantastique généalogie qui entraîne une adhésion inconsciente du lecteur.— Le refus de suivre la tradition.
Trois exemples sont significatifs : L'âne se voit réhabilité lorsqu'il se révolte contrele sort qui lui est fait, se transforme en raisonneur qui revendique, proteste (VI, 11) ou plus radicalement encorereconquiert sa liberté dans un élan d'anarchisme spontané (VI, 8).
Il est donc capable d'être autre chose qu'unpleutre stupide.
Le renard sort de son répertoire habituel de méchant à l'intelligence dévoyée, en mettant celle-ciau service d'une bonne cause lorsqu'il dénonce la médiocrité de certains souverains et le lâche aveuglement dupeuple (VI, 6).
On sort donc des stéréotypes imposés pour reproduire la diversité de la vie en créant des situationsqui révèlent des aspects nouveaux d'un personnage, comme il arrive souvent.
Jupiter s'humanise parfois.Descendant de l'Olympe, il devient un prosaïque propriétaire terrien lorsqu'il fait appel à Mercure qui se glisse dans la.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- SYNTHESE FABLES DE LA FONTAINE - LIVRES VII-XII
- Dans le salon de Madame de La Sablière qu'il a fréquenté de 1672 à 1678, La Fontaine s'est mêlé aux discussions des philosophes et des savants. Les fables des Livres VII à XII contiennent des échos de leurs débats. ?
- « Les longs ouvrages me font peur», écrit La Fontaine dans l'Épilogue du Livre VI. A la lumière des fables contenues dans les Livres VII à XII, vous direz en quoi cette confidence du fabuliste éclaire son art poétique. ?
- « Les propriétés des animaux et leurs divers caractères y sont exprimés ; par conséquent les nôtres aussi, puisque nous sommes l'abrégé de ce qu'il y a de bon et de mauvais dans les créatures irraisonnables », écrit La Fontaine dans sa Préface au premier recueil de ses Fables (1668). Trouve-t-on encore dans les Livres VII à XII de quoi justifier cette affirmation du fabuliste ?
- Morales des Fables des livres VIII et IX. La Fontaine