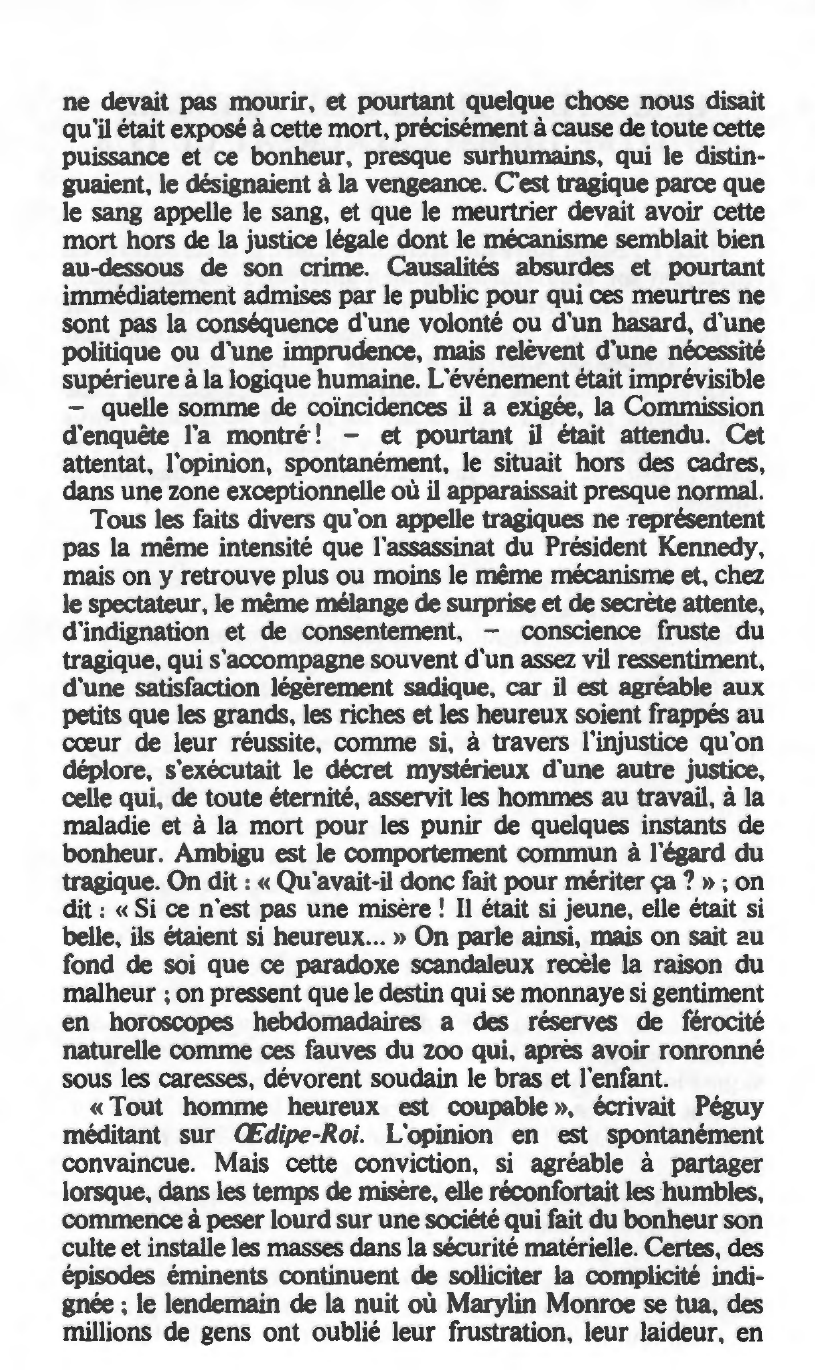La langue française
Publié le 30/06/2012
Extrait du document
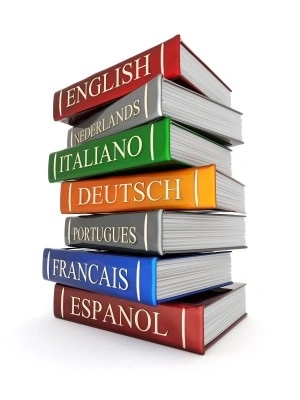
La langue française nous permet cette distinction essentielle : tragique n'est pas seulement une épithète associée à tragédie (Sophocle, auteur tragique) ; le mot recouvre une réalité plus vaste et plus profonde, si l'on pense que le phénomène du tragique constitue une structure fondamentale de l'univers. On objectera peut-être qu'il en va de même pour comique, qui ne qualifie pas uniquement un genre littéraire; il est vrai qu'il y a des spectacles comiques. indépendamment de toute représentation théâtrale. Mais lorsque à propos de quelque incident, on dit: C'est comique, on ne désigne qu'un aspect extérieur d'un événement ou d'une situation dont la nature essentielle demeure hors de cause.
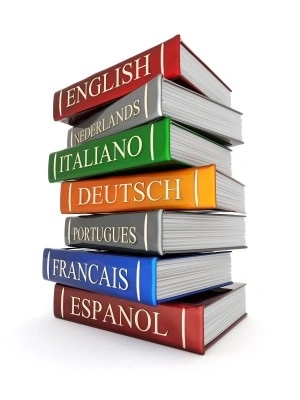
«
ne devait pas mourir, et pourtant quelque chose nous disait
qu'il était exposé à cette mort, précisément à cause de toute cette puissance et ce bonheur, presque surhumains, qui le distin
guaient, le désignaient à la vengeance.
C'est tragique parce que
le
sang appelle le sang, et que le meurtrier devait avoir cette
mort hors de la justice légale dont le mécanisme semblait bien
au-dessous de son crime.
Causalités absurdes et pourtant
immédiatement admises par le public pour qui ces meurtres ne
sont
pas la conséquence d'une volonté ou d'un hasard, d'une
politique
ou d'une imprudence, mais relèvent d'une nécessité
supérieure
à la logique humaine.
L'événement était imprévisible
- quelle somme de coïncidences
il a exigée, la Commission
d'enquête l'a montré-! -et pourtant il était attendu.
Cet
attentat.
l'opinion, spontanément, le situait hors des cadres,
dans une zone exceptionnelle où il apparaissait presque normal.
Tous les faits divers
qu'on appelle tragiques ne ·représentent
pas la même intensité que l'assassinat du Président Kennedy,
mais
on y retrouve plus ou moins le même mécanisme et.
chez
le spectateur, le
même mélange de surprise et de secrète attente,
d'indignation et de consentement.
-conscience fruste du
tragique.
qui s'accompagne souvent
d'un assez vil ressentiment,
d'une satisfaction légèrement sadique,
car il est agréable aux petits que les grands, les riches et les heureux soient frappés au cœur de leur réussite.
comme si, à travers l'injustice qu'on déplore, s'exécutait le décret mystérieux d'une autre justice,
celle qui, de toute éternité, asservit les hommes au travail, à la
maladie et à la mort pour les punir de quelques instants de
bonheur.
Ambigu est le comportement commun
à l'égard du tragique.
On dit:« Qu'avait-il donc fait pour mériter ça?»; on
dit : « Si ce n'est pas une misère ! Il était si jeune.
elle était si
belle, ils étaient si heureux ...
>> On parle ainsi, mais on sait eu
fond de soi que ce paradoxe scandaleux recele la raison du
malheur ; on pressent que le destin qui se monnaye si gentiment
en horoscopes hebdomadaires a des réserves de férocité
naturelle comme ces fauves du zoo qui.
aprés avoir ronronné
sous les caresses, dévorent soudain le bras et l'enfant.
(( Tout homme heureux est coupable », écrivait Péguy
méditant
sur Œdipe-Roi.
L'opinion en est spontanément
convaincue.
Mais cette conviction, si agréable
à partager
lorsque.
dans les temps de misère.
elle réconfortait les humbles,
commence
à peser lourd sur une société qui fait du bonheur son
culte et installe les masses
dans la sécurité matérielle.
Certes, des
épisodes éminents continuent de solliciter la complicité indi
gnée ; le lendemain de la nuit où Marylin Monroe se tua, des
millions de gens ont oublié leur frustration.
leur laideur.
en.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Faut-il utiliser le « iel » dans la langue française ?
- Défense et Illustration de la LANGUE FRANÇAISE
- Discours sur l'universalité de LA LANGUE FRANÇAISE, de Rivarol
- DÉFENSE ET ILLUSTRATION DE LA LANGUE FRANÇAISE (résumé & analyse)
- DISCOURS SUR L’UNIVERSALITÉ DE LA LANGUE FRANÇAISE. (résumé et analyse)