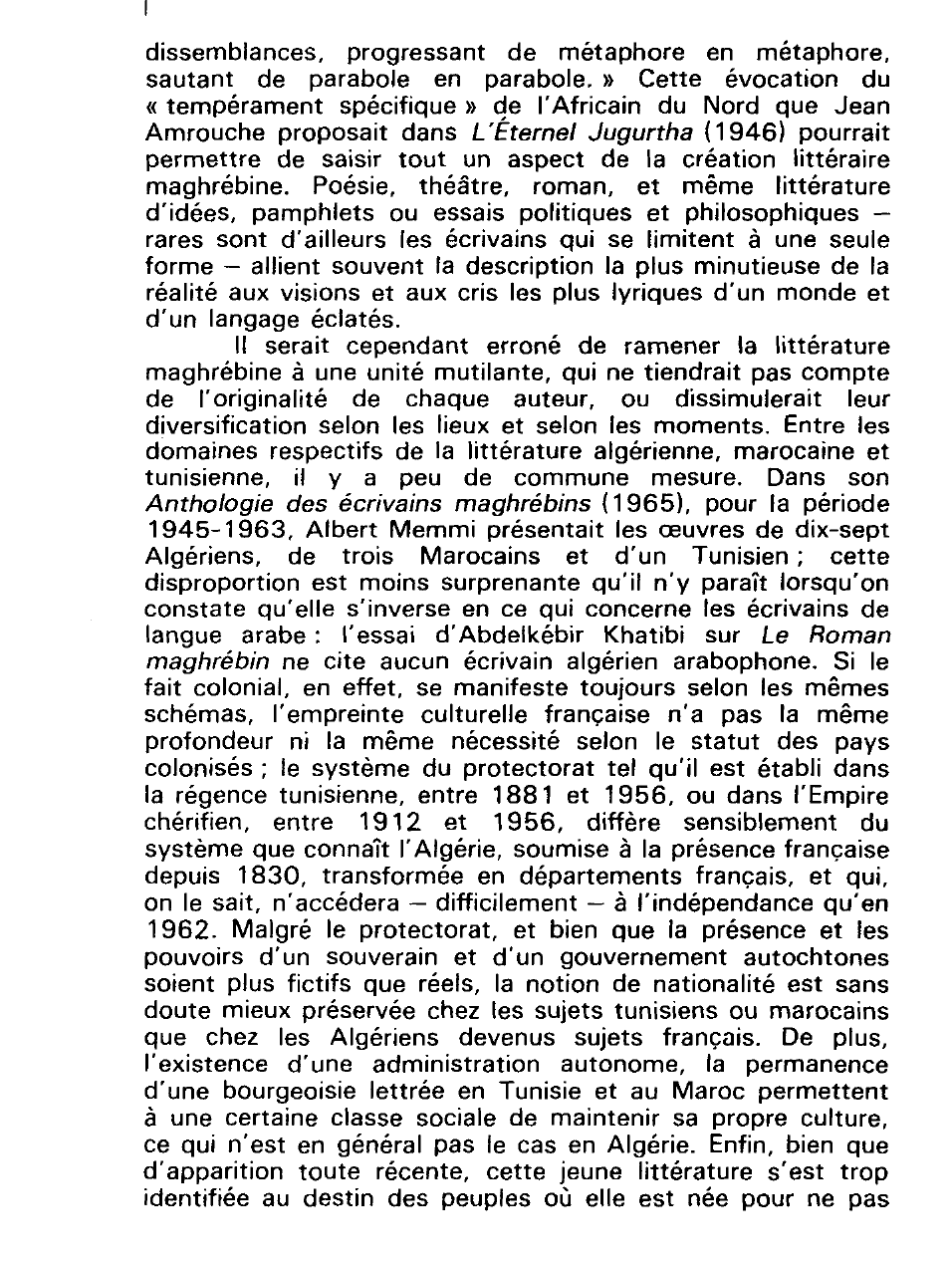LA LITTÉRATURE MAGHRÉBINE D'EXPRESSION FRANÇAISE
Publié le 30/03/2012

Extrait du document
C'est aussi la Kabylie qui est au coeur de l'oeuvre de Moulaud Mammeri, lui apportant à la fois la beauté et la rigueur de ses paysages, et toute une pesanteur sociologique. La Colline oubliée ( 1952). fresque à plusieurs personnages, peint avec gravité et nostalgie la fin de l'adolescence, rompue par la guerre, les rivalités, la tradition exigeante d'une société menacée, la misère qu'accentue le pouvoir colonial. Le Sommeil du juste ( 1955) est, plus encore, le roman de la désillusion et de l'échec; l'itinéraire d'Areski, combattant de la Seconde Guerre mondiale, qui s'est libéré de la tradition kabyle et voit ses rêves d'intégration et sa confiance dans la culture occidentale brutalement détruits, est déjà celui de l'exil que connaîtront tant de personnages à venir ; ...
«
802 HISTOIRE LITTÉRAIRE DE LA FRANCE
dissemblances, progressant de métaphore en métaphore, sautant de parabole en parabole.
» Cette évocation du « tempérament spécifique » de l'Africain du Nord que Jean Amrouche proposait dans L'Éternel Jugurtha ( 1946) pourrait permettre de saisir tout un aspect de la création littéraire maghrébine.
Poésie, théâtre, roman, et même littérature d'idées, pamphlets ou essais politiques et philosophiques -
rares sont d'ailleurs les écrivains qui se limitent à une seule forme - allient souvent la description la plus minutieuse de la réalité aux visions et aux cris les plus lyriques d'un monde et d'un langage éclatés.
Il serait cependant erroné de ramener la littérature maghrébine à une unité mutilante, qui ne tiendrait pas compte de l'originalité de chaque auteur, ou dissimulerait leur
diversification selon les lieux et selon les moments.
Entre les domaines respectifs de la littérature algérienne, marocaine et tunisienne, il y a peu de commune mesure.
Dans son Anthologie des écrivains maghrébins ( 1965).
pour la période 1945-1963, Albert Memmi présentait les œuvres de dix-sept Algériens, de trois Marocains et d'un Tunisien ; cette disproportion est moins surprenante qu'il n'y paraît lorsqu'on constate qu'elle s'inverse en ce qui concerne les écrivains de langue arabe : l'essai d' Abdelkébir Khatibi sur Le Roman maghrébin ne cite aucun écrivain algérien arabophone.
Si le fait colonial, en effet, se manifeste toujours selon les mêmes schémas, l'empreinte culturelle française n'a pas la même profondeur ni la même nécessité selon le statut des pays colonisés ; le système du protectorat tel qu'il est établi dans la régence tunisienne, entre 1881 et 1956, ou dans l'Empire chérifien, entre 1912 et 1956, diffère sensiblement du système que connaît l'Algérie, soumise à la présence française
depuis 1830, transformée en départements français, et qui, on le sait, n'accédera- difficilement- à l'indépendance qu'en 1962.
Malgré le protectorat, et bien que la présence et les pouvoirs d'un souverain et d'un gouvernement autochtones soient plus fictifs que réels, la notion de nationalité est sans doute mieux préservée chez les sujets tunisiens ou marocains
que chez les Algériens devenus sujets franç.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- ÉGYPTE. Littérature égyptienne d'expression française
- MAGHREB. Littérature d'expression française
- NÉGRO-AFRICAINE (littérature d'expression française)
- CARAÏBES et GUYANE. Littérature d’expression française.
- BELGIQUE. Littérature d'expression française. L'influence de la Belgique sur la littérature française