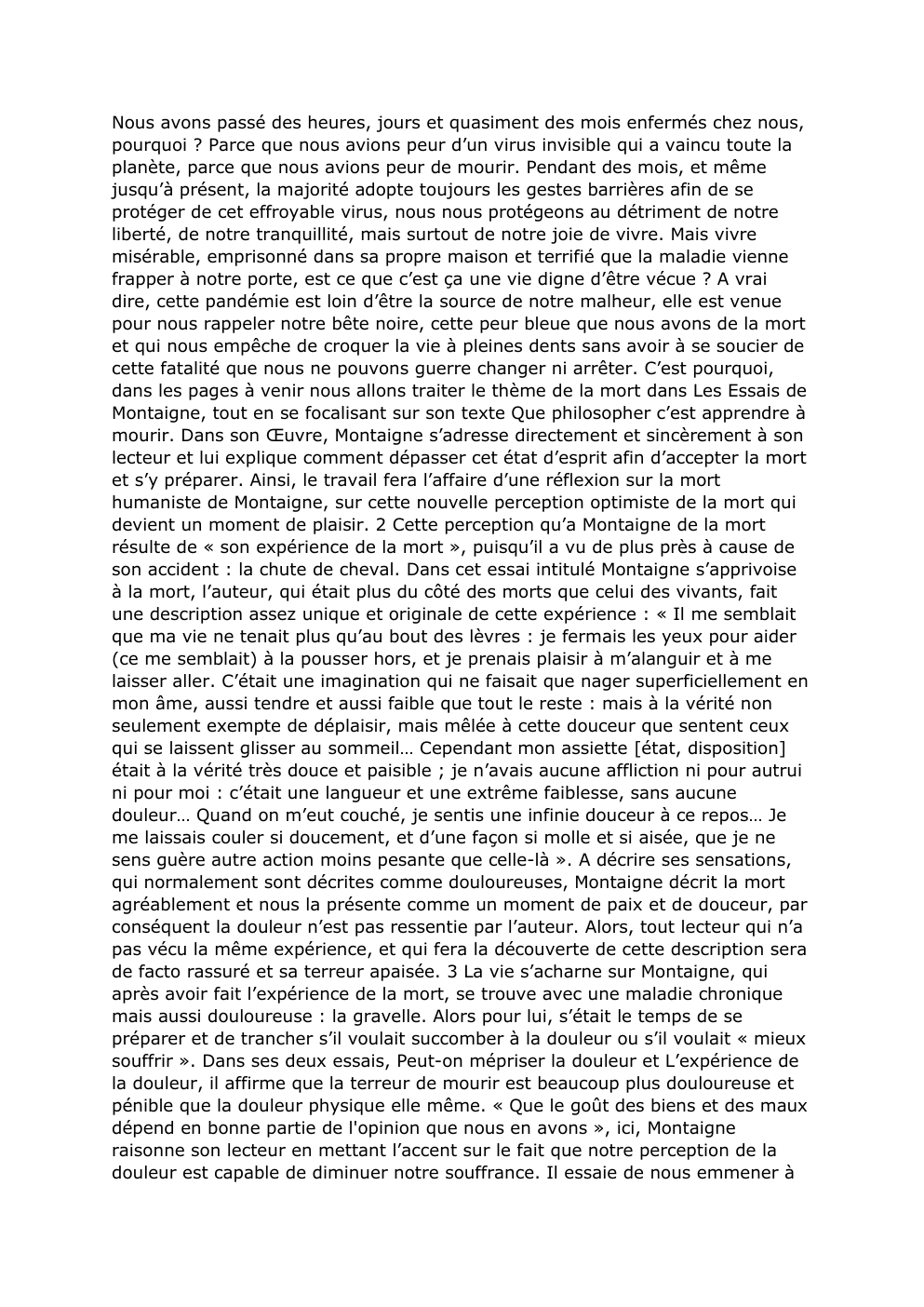La mort humaniste - Michel de Montaigne.
Publié le 17/01/2023
Extrait du document
«
Nous avons passé des heures, jours et quasiment des mois enfermés chez nous,
pourquoi ? Parce que nous avions peur d’un virus invisible qui a vaincu toute la
planète, parce que nous avions peur de mourir.
Pendant des mois, et même
jusqu’à présent, la majorité adopte toujours les gestes barrières afin de se
protéger de cet effroyable virus, nous nous protégeons au détriment de notre
liberté, de notre tranquillité, mais surtout de notre joie de vivre.
Mais vivre
misérable, emprisonné dans sa propre maison et terrifié que la maladie vienne
frapper à notre porte, est ce que c’est ça une vie digne d’être vécue ? A vrai
dire, cette pandémie est loin d’être la source de notre malheur, elle est venue
pour nous rappeler notre bête noire, cette peur bleue que nous avons de la mort
et qui nous empêche de croquer la vie à pleines dents sans avoir à se soucier de
cette fatalité que nous ne pouvons guerre changer ni arrêter.
C’est pourquoi,
dans les pages à venir nous allons traiter le thème de la mort dans Les Essais de
Montaigne, tout en se focalisant sur son texte Que philosopher c’est apprendre à
mourir.
Dans son Œuvre, Montaigne s’adresse directement et sincèrement à son
lecteur et lui explique comment dépasser cet état d’esprit afin d’accepter la mort
et s’y préparer.
Ainsi, le travail fera l’affaire d’une réflexion sur la mort
humaniste de Montaigne, sur cette nouvelle perception optimiste de la mort qui
devient un moment de plaisir.
2 Cette perception qu’a Montaigne de la mort
résulte de « son expérience de la mort », puisqu’il a vu de plus près à cause de
son accident : la chute de cheval.
Dans cet essai intitulé Montaigne s’apprivoise
à la mort, l’auteur, qui était plus du côté des morts que celui des vivants, fait
une description assez unique et originale de cette expérience : « Il me semblait
que ma vie ne tenait plus qu’au bout des lèvres : je fermais les yeux pour aider
(ce me semblait) à la pousser hors, et je prenais plaisir à m’alanguir et à me
laisser aller.
C’était une imagination qui ne faisait que nager superficiellement en
mon âme, aussi tendre et aussi faible que tout le reste : mais à la vérité non
seulement exempte de déplaisir, mais mêlée à cette douceur que sentent ceux
qui se laissent glisser au sommeil… Cependant mon assiette [état, disposition]
était à la vérité très douce et paisible ; je n’avais aucune affliction ni pour autrui
ni pour moi : c’était une langueur et une extrême faiblesse, sans aucune
douleur… Quand on m’eut couché, je sentis une infinie douceur à ce repos… Je
me laissais couler si doucement, et d’une façon si molle et si aisée, que je ne
sens guère autre action moins pesante que celle-là ».
A décrire ses sensations,
qui normalement sont décrites comme douloureuses, Montaigne décrit la mort
agréablement et nous la présente comme un moment de paix et de douceur, par
conséquent la douleur n’est pas ressentie par l’auteur.
Alors, tout lecteur qui n’a
pas vécu la même expérience, et qui fera la découverte de cette description sera
de facto rassuré et sa terreur apaisée.
3 La vie s’acharne sur Montaigne, qui
après avoir fait l’expérience de la mort, se trouve avec une maladie chronique
mais aussi douloureuse : la gravelle.
Alors pour lui, s’était le temps de se
préparer et de trancher s’il voulait succomber à la douleur ou s’il voulait « mieux
souffrir ».
Dans ses deux essais, Peut-on mépriser la douleur et L’expérience de
la douleur, il affirme que la terreur de mourir est beaucoup plus douloureuse et
pénible que la douleur physique elle même.
« Que le goût des biens et des maux
dépend en bonne partie de l'opinion que nous en avons », ici, Montaigne
raisonne son lecteur en mettant l’accent sur le fait que notre perception de la
douleur est capable de diminuer notre souffrance.
Il essaie de nous emmener à
l’accepter et à la supporter afin de la surmonter.
Certes, la douleur physique est
difficile (pour ne pas dire impossible) à séparer de celle de l’esprit, or Montaigne
nous invite à faire l’effort de nous dépasser pour mieux vivre.
Donc, la douleur
du corps est supportable si l’esprit est tranquille est en paix pourtant nous ne
pouvons affirmer le contraire comme le soulève Planton qui rejoint Montaigne
dans cette citation : « les maux du corps sont les mots de l'âme, ainsi on ne doit
pas chercher à guérir le corps sans chercher à guérir l'âme.
».
Par conséquent la
clé à cette paix intérieure est l’acceptation : l’acceptation de la mort.
A y
réfléchir, les maux et les douleurs que nous ressentons sont des rappels qui
nous enlèvent à notre « amnésie » ou même à notre illusion, ils nous rappellent
que nous sommes tous voués à une fin inévitable qui est la mort.
C’est pourquoi
Montaigne nous invite à accepter que nous somme nés pour mourir, ce qui fait
qu’accepter la vie c’est accepter sa sœur jumelle qui est la mort : ils vont de
paire.
Par ailleurs, il ne faut pas négliger que la mort de Montaigne est loin
d’être chrétienne puisqu’il n’évoque jamais l’au delà, c’est une mort raisonnable....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- (La mort) ne vous concerne ni mort ni vif: vif, parce que vous êtes; mort, parce que vous n'êtes plus. Essais, I, 20 Montaigne, Michel Eyquem de. Commentez cette citation.
- ... à la vérité, pour s'apprivoiser à la mort, je trouve qu'il n'y a que de s'en avoisiner. Essais, II, 6 Montaigne, Michel Eyquem de. Commentez cette citation.
- ... quelquefois la fuite de la mort fait que nous y courons. Essais, II, 3 Montaigne, Michel Eyquem de. Commentez cette citation.
- Ce n'est pas la mort que je crains, c'est de mourir. Montaigne, Michel Eyquem de. Commentez cette citation.
- Cicéron dit que philosopher ce n'est autre chose que s'apprêter à la mort. Essais, I, 20 Montaigne, Michel Eyquem de. Commentez cette citation.