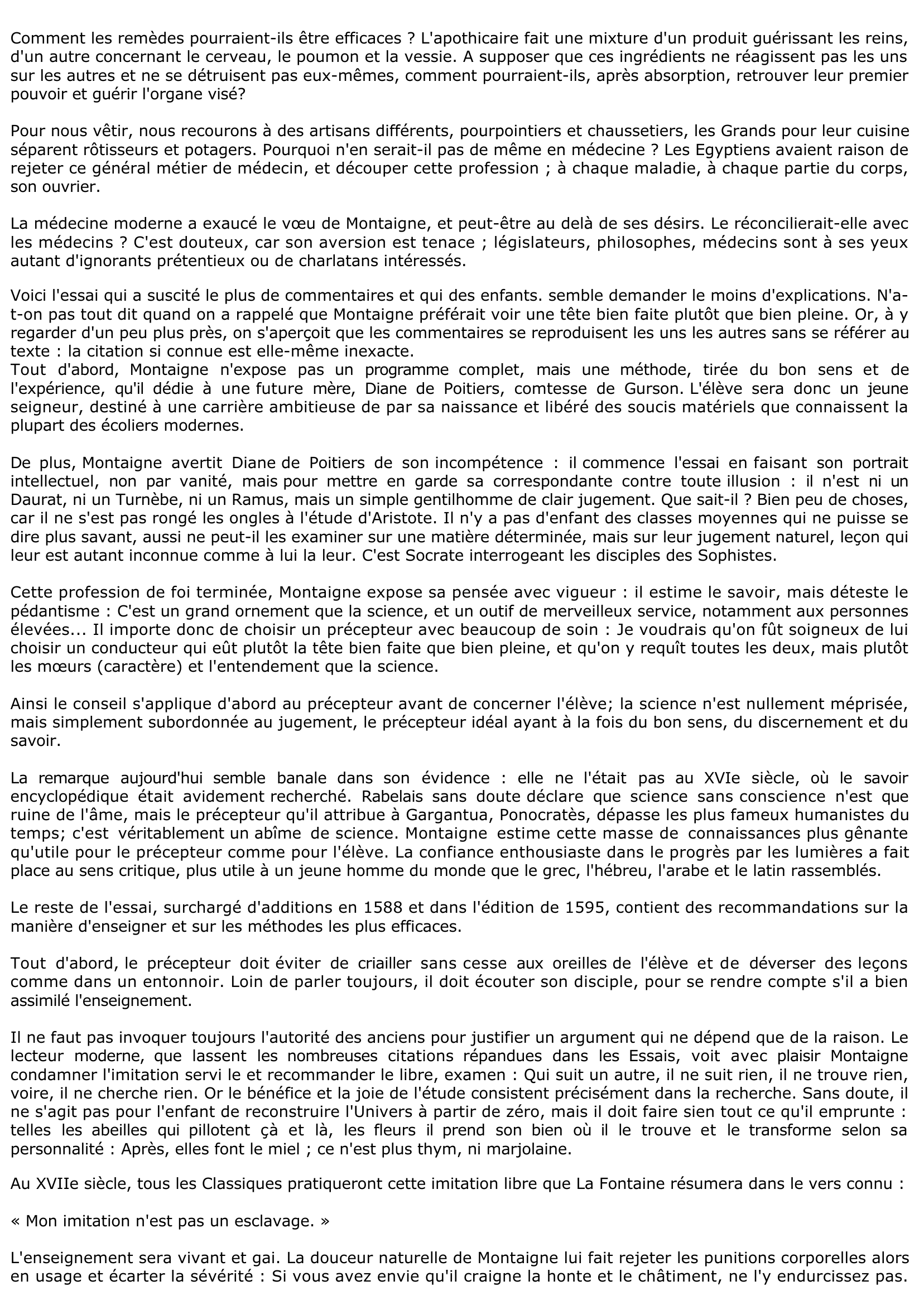LA PEINTURE DU MOI DANS LES ESSAIS DE MONTAIGNE
Publié le 02/04/2011
Extrait du document

Montaigne prend de plus en plus plaisir à se regarder vivre et à s'interroger. Le scepticisme l'écarté de la connaissance des objets extérieurs et l'attache à l'étude de son « moi «. La maladie accentue encore cette transformation et développe le goût pour les confidences. De là provient la Préface de 1580 : C'est un livre de bonne foi, lecteur... Je l'ai voué à la commodité particulière de mes parents et amis, à ce que, m'ayant perdu... ils y puissent retrouver quelques traits de mes conditions et humeurs... Je veux qu'on m'y voie en ma façon simple, naturelle et ordinaire, sans étude et sans artifice, car c'est moi que je peins ; je suis moi-même la matière de mon livre.
L'essai nous fait pénétrer dans l'intimité de Montaigne; nous apprenons comment .il écrit, comment il se porte, comment il pense. Fils d'un père dispos, il est, dans tous les exercices du corps, médiocre et lourd.

«
Comment les remèdes pourraient-ils être efficaces ? L'apothicaire fait une mixture d'un produit guérissant les reins,d'un autre concernant le cerveau, le poumon et la vessie.
A supposer que ces ingrédients ne réagissent pas les unssur les autres et ne se détruisent pas eux-mêmes, comment pourraient-ils, après absorption, retrouver leur premierpouvoir et guérir l'organe visé?
Pour nous vêtir, nous recourons à des artisans différents, pourpointiers et chaussetiers, les Grands pour leur cuisineséparent rôtisseurs et potagers.
Pourquoi n'en serait-il pas de même en médecine ? Les Egyptiens avaient raison derejeter ce général métier de médecin, et découper cette profession ; à chaque maladie, à chaque partie du corps,son ouvrier.
La médecine moderne a exaucé le vœu de Montaigne, et peut-être au delà de ses désirs.
Le réconcilierait-elle avecles médecins ? C'est douteux, car son aversion est tenace ; législateurs, philosophes, médecins sont à ses yeuxautant d'ignorants prétentieux ou de charlatans intéressés.
Voici l'essai qui a suscité le plus de commentaires et qui des enfants.
semble demander le moins d'explications.
N'a-t-on pas tout dit quand on a rappelé que Montaigne préférait voir une tête bien faite plutôt que bien pleine.
Or, à yregarder d'un peu plus près, on s'aperçoit que les commentaires se reproduisent les uns les autres sans se référer autexte : la citation si connue est elle-même inexacte.Tout d'abord, Montaigne n'expose pas un programme complet, mais une méthode, tirée du bon sens et del'expérience, qu'il dédie à une future mère, Diane de Poitiers, comtesse de Gurson.
L'élève sera donc un jeuneseigneur, destiné à une carrière ambitieuse de par sa naissance et libéré des soucis matériels que connaissent laplupart des écoliers modernes.
De plus, Montaigne avertit Diane de Poitiers de son incompétence : il commence l'essai en faisant son portraitintellectuel, non par vanité, mais pour mettre en garde sa correspondante contre toute illusion : il n'est ni unDaurat, ni un Turnèbe, ni un Ramus, mais un simple gentilhomme de clair jugement.
Que sait-il ? Bien peu de choses,car il ne s'est pas rongé les ongles à l'étude d'Aristote.
Il n'y a pas d'enfant des classes moyennes qui ne puisse sedire plus savant, aussi ne peut-il les examiner sur une matière déterminée, mais sur leur jugement naturel, leçon quileur est autant inconnue comme à lui la leur.
C'est Socrate interrogeant les disciples des Sophistes.
Cette profession de foi terminée, Montaigne expose sa pensée avec vigueur : il estime le savoir, mais déteste lepédantisme : C'est un grand ornement que la science, et un outif de merveilleux service, notamment aux personnesélevées...
Il importe donc de choisir un précepteur avec beaucoup de soin : Je voudrais qu'on fût soigneux de luichoisir un conducteur qui eût plutôt la tête bien faite que bien pleine, et qu'on y requît toutes les deux, mais plutôtles mœurs (caractère) et l'entendement que la science.
Ainsi le conseil s'applique d'abord au précepteur avant de concerner l'élève; la science n'est nullement méprisée,mais simplement subordonnée au jugement, le précepteur idéal ayant à la fois du bon sens, du discernement et dusavoir.
La remarque aujourd'hui semble banale dans son évidence : elle ne l'était pas au XVIe siècle, où le savoirencyclopédique était avidement recherché.
Rabelais sans doute déclare que science sans conscience n'est queruine de l'âme, mais le précepteur qu'il attribue à Gargantua, Ponocratès, dépasse les plus fameux humanistes dutemps; c'est véritablement un abîme de science.
Montaigne estime cette masse de connaissances plus gênantequ'utile pour le précepteur comme pour l'élève.
La confiance enthousiaste dans le progrès par les lumières a faitplace au sens critique, plus utile à un jeune homme du monde que le grec, l'hébreu, l'arabe et le latin rassemblés.
Le reste de l'essai, surchargé d'additions en 1588 et dans l'édition de 1595, contient des recommandations sur lamanière d'enseigner et sur les méthodes les plus efficaces.
Tout d'abord, le précepteur doit éviter de criailler sans cesse aux oreilles de l'élève et de déverser des leçonscomme dans un entonnoir.
Loin de parler toujours, il doit écouter son disciple, pour se rendre compte s'il a bienassimilé l'enseignement.
Il ne faut pas invoquer toujours l'autorité des anciens pour justifier un argument qui ne dépend que de la raison.
Lelecteur moderne, que lassent les nombreuses citations répandues dans les Essais, voit avec plaisir Montaignecondamner l'imitation servi le et recommander le libre, examen : Qui suit un autre, il ne suit rien, il ne trouve rien,voire, il ne cherche rien.
Or le bénéfice et la joie de l'étude consistent précisément dans la recherche.
Sans doute, ilne s'agit pas pour l'enfant de reconstruire l'Univers à partir de zéro, mais il doit faire sien tout ce qu'il emprunte :telles les abeilles qui pillotent çà et là, les fleurs il prend son bien où il le trouve et le transforme selon sapersonnalité : Après, elles font le miel ; ce n'est plus thym, ni marjolaine.
Au XVIIe siècle, tous les Classiques pratiqueront cette imitation libre que La Fontaine résumera dans le vers connu :
« Mon imitation n'est pas un esclavage.
»
L'enseignement sera vivant et gai.
La douceur naturelle de Montaigne lui fait rejeter les punitions corporelles alorsen usage et écarter la sévérité : Si vous avez envie qu'il craigne la honte et le châtiment, ne l'y endurcissez pas..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- De vrai, toute belle peinture s'efface aisément par le lustre d'une vérité simple et naïve. Essais, I, 26 Montaigne, Michel Eyquem de. Commentez cette citation.
- Que philosopher, c'est apprendre à mourir Essais de Montaigne
- Les essais de Montaigne: dans quelle mesure Montaigne met-il en relation les européens et les Amérindiens dans cet extrait ?
- ESSAIS, Montaigne (Michel Eyquem de)
- ESSAIS (Les) de Montaigne. (résumé)