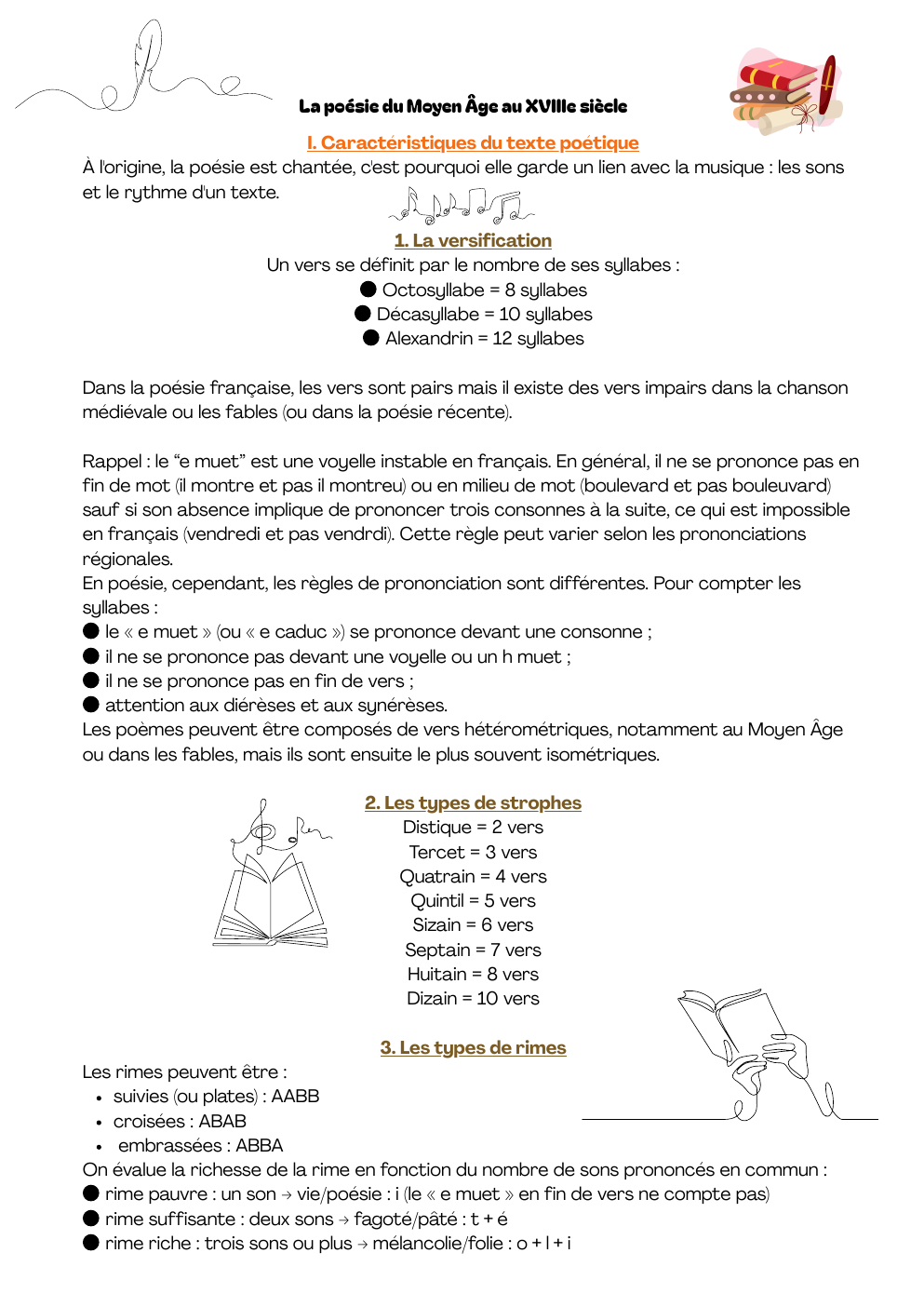La poésie du Moyen Âge au XVIIIe siècle
Publié le 29/06/2025
Extrait du document
«
La poésie du Moyen Âge au XVIIIe siècle
I.
Caractéristiques du texte poétique
À l'origine, la poésie est chantée, c'est pourquoi elle garde un lien avec la musique : les sons
et le rythme d'un texte.
1.
La versification
Un vers se définit par le nombre de ses syllabes :
Octosyllabe = 8 syllabes
Décasyllabe = 10 syllabes
Alexandrin = 12 syllabes
●
●
●
Dans la poésie française, les vers sont pairs mais il existe des vers impairs dans la chanson
médiévale ou les fables (ou dans la poésie récente).
Rappel : le “e muet” est une voyelle instable en français.
En général, il ne se prononce pas en
fin de mot (il montre et pas il montreu) ou en milieu de mot (boulevard et pas bouleuvard)
sauf si son absence implique de prononcer trois consonnes à la suite, ce qui est impossible
en français (vendredi et pas vendrdi).
Cette règle peut varier selon les prononciations
régionales.
En poésie, cependant, les règles de prononciation sont différentes.
Pour compter les
syllabes :
le « e muet » (ou « e caduc ») se prononce devant une consonne ;
il ne se prononce pas devant une voyelle ou un h muet ;
il ne se prononce pas en fin de vers ;
attention aux diérèses et aux synérèses.
Les poèmes peuvent être composés de vers hétérométriques, notamment au Moyen Âge
ou dans les fables, mais ils sont ensuite le plus souvent isométriques.
●
●
●
●
2.
Les types de strophes
Distique = 2 vers
Tercet = 3 vers
Quatrain = 4 vers
Quintil = 5 vers
Sizain = 6 vers
Septain = 7 vers
Huitain = 8 vers
Dizain = 10 vers
3.
Les types de rimes
Les rimes peuvent être :
suivies (ou plates) : AABB
croisées : ABAB
embrassées : ABBA
On évalue la richesse de la rime en fonction du nombre de sons prononcés en commun :
rime pauvre : un son → vie/poésie : i (le « e muet » en fin de vers ne compte pas)
rime suffisante : deux sons → fagoté/pâté : t + é
rime riche : trois sons ou plus → mélancolie/folie : o + l + i
●
●
●
4.
Les tonalités
Une tonalité est un ensemble de procédés qui provoquent un certain effet chez le
lecteur.
Un texte lyrique exprime des sentiments personnels (souvent l’amour) :
première personne du singulier
ponctuation expressive : points d’exclamation, d’interrogation
figures de style : hyperbole, répétition
apostrophes
●
●
●
●
Un texte élégiaque est un texte lyrique dont le sentiment dominant est la tristesse
: le thème peut être la nostalgie, la mort, la fuite du temps, le deuil ou la rupture
amoureuse.
Un texte pathétique vise à éveiller la pitié du lecteur :
un personnage évoqué à la troisième personne, dont on narre les malheurs
figures de style : hyperbole, répétition → rendre l’intensité de la souffrance
●
●
Un texte épique vise à provoquer l'admiration du lecteur en narrant les exploits
d’un héros :
verbes d’action
lexique des armes et de la bravoure
figures de style : hyperbole
noms et pronoms pluriels → le héros appartient à une collectivité
antithèses et parallélismes → le héros s’oppose à un ennemi
présent de narration → le combat semble se dérouler sous nos yeux
●
●
●
●
●
●
Un texte satirique vise à critiquer par le rire :
l’ironie
figure de style : hyperbole
complicité avec le lecteur : tutoiement
effets de surprise et de chute
●
●
●
●
Un texte didactique enseigne une leçon :
présent de vérité générale
tournures générales
phrases injonctives à l’impératif
●
●
●
5.
Le rythme
S’il y a des pauses voulues par la ponctuation à l’intérieur d’un vers :
on appelle « césure » une pause que l’on fait au milieu d’un vers pair (la moitié
d’un vers s’appelle « hémistiche ») : c’est une pause régulière ;
on appelle « coupes » toutes les autres pauses : ce sont des pauses irrégulières.
Si le sens demande que l’on ne s’arrête pas à la fin d’un vers mais que l’on continue
au vers suivant, on fait un « enjambement ».
●
●
II.
Histoire des mouvements poétiques
1.
La fin’amor
Époque : Moyen Âge.
Transposition du modèle féodal dans le....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Vous expliquerez et apprécierez ce parallèle entre le XVIIe siècle classique et le moyen âge : «Le XVIIe siècle - en ce qu'il a de classique - bien plus que l'introduction à la pensée scientifique, moderne et athée du XVIIIe siècle, est l'épanouissement de la pensée du moyen âge, dont il donne, sous des habits empruntés et dans une langue magnifique, une nouvelle et somptueuse image. Un homme prévenu, qui oublierait tant de poncifs et de jugements consacrés, comment ne serait-il pas fr
- Plus qu'aucune autre période de l'histoire peut-être, le Moyen Âge a été redécouvert au XXe siècle à travers les acquis de l'école des Annales et de la « nouvelle histoire ».
- La littérature du Moyen-Orient au XXe siècle par Alan Chatham de Bolivar Le roman est un genre littéraire relativement récent dans la littérature arabe plus marquée par le conte ou la poésie, qui induisent une rupture par rapport aux formes classiques.
- La médecine arabe et la médecine du moyen age par Jean Terracol Professeur à la Faculté de médecine, Montpellier Durant la première période du moyen âge, dont les historiens ont fixé les limites entre le Ve et le IXe siècle, l'Occident vit dans l'ignorance.
- Albrecht Dürer par Joseph Cibulka Professeur à l'Université Charles-IV, Prague Au début du XVe siècle, deux événements ont conduit les manifestations du moyen âge dans une nouvelle voie ; ce furent la naissance du réalisme dans les Pays-Bas et l'avènement de la Renaissance en Italie.