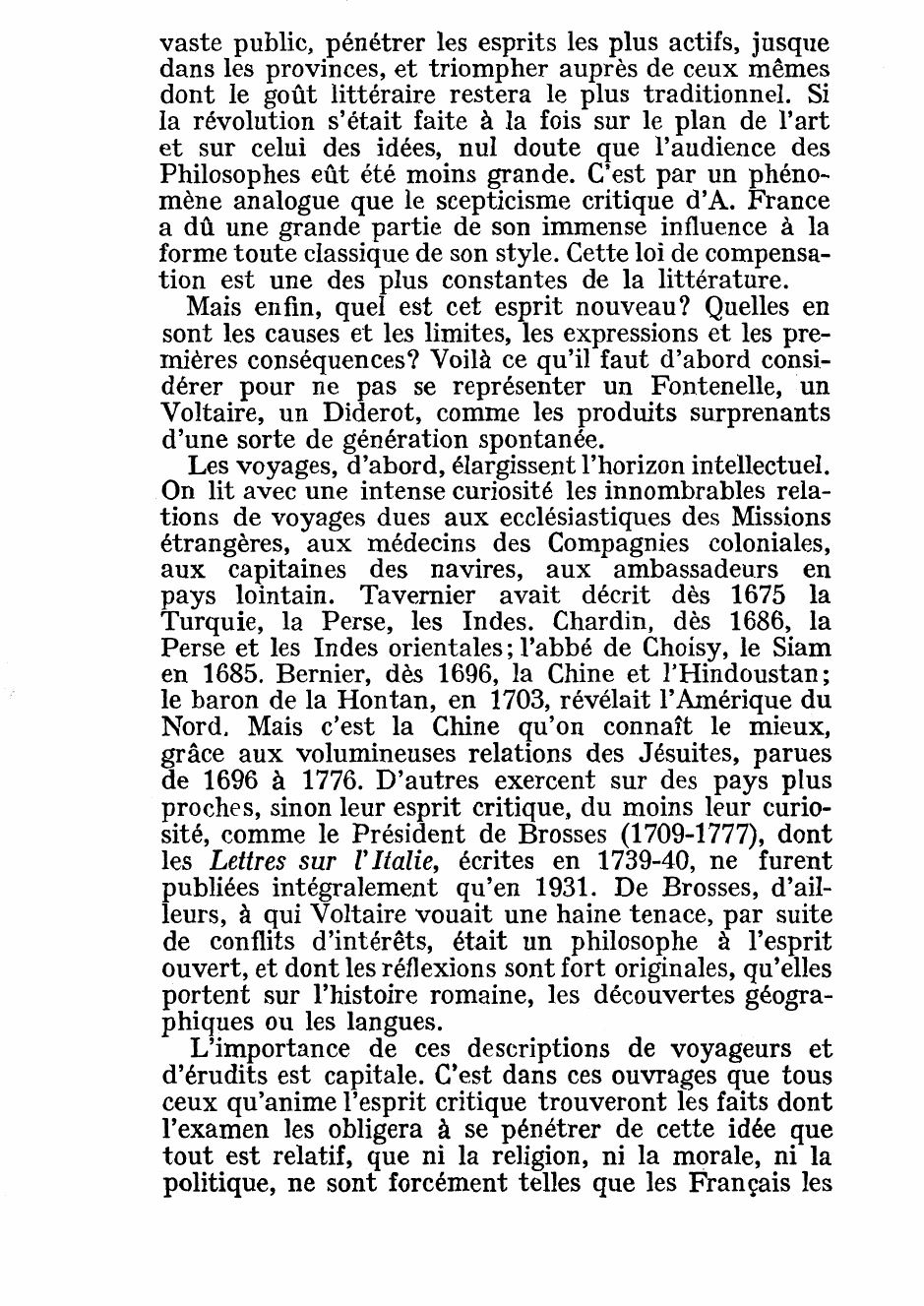L'AGE DES LUMIÈRES : LA PHILOSOPHIE, LE ROMAN, LA POÉSIE, LE THÉÂTRE
Publié le 27/06/2012

Extrait du document

L'esprit nouveau.
Contre l'orthodoxie littéraire, morale, religieuse, qui cherchait à s'imposer depuis 1660, la révolte, nous l'avons vu, grondait. Quand la question religieuse est en jeu, les révoltés doivent se taire ou parler de loin. Mais, installés aux portes de la France, en Hollande, comme Bayle, comme Jean Le Clerc (1657-1736), en Angleterre, comme Saint-Évremond, ils peuvent se faire entendre dans leur patrie, où leurs ouvrages se vendent, en somme, fort librement. Quand la révolte se joue sur le plan littéraire, elle peut se développer, nous l'avons vu, en pleine Académie. C'est ce mouvement de révolte ou de critique plus ou moins souterrain d'abord, et qui, avant 1715, n'a pas donné de chef-d'oeuvre littéraire, qui va, pendant les cinquante années suivantes, inspirer notre littérature, non seulement dans ce qu'elle a de plus vivant, de plus neuf, de plus combatif, mais dans ce qu'elle a de plus parfait, de mieux écrit. Tandis que la masse des écrivains continuera à utiliser les formes traditionnelles léguées par nos grands classiques, certains, que leur génie élèvera au-dessus de cette masse, seront amenés à créer une forme nouvelle au service d'un état d'esprit nouveau. Encore faut-il distinguer entre la prose et la poésie. Tandis que la prose, plus libre, moins gênée par l'exemple des grands modèles, évoluera très rapidement jusqu'à Rousseau dans un sens, et Beaumarchais dans l'autre, la poésie, même entre les mains d'écrivains de pensée audacieuse, comme Voltaire, restera dévotement fidèle, jusqu'à Chénier, à un idéal tout traditionnel. L'esprit nouveau, cantonné d'abord dans des oeuvres érudites, peu accessibles à d'autres qu'aux érudits, va, peu à peu, se répandre au grand jour, conquérir un vaste public, pénétrer les esprits les plus actifs, jusque dans les provinces, et triompher auprès de ceux mêmes dont le goût littéraire restera le plus traditionnel. Si la révolution s'était faite à la fois sur le plan de l'art et sur celui des idées, nul doute que l'audience des Philosophes eût été moins grande. C'est par un phénomène analogue que le scepticisme critique d'A. France a dû une grande partie de son immense influence à la forme toute classique de son style. Cette loi de compensation est une des plus constantes de la littérature. Mais enfin, quel est cet esprit nouveau? Quelles en sont les causes et les limites, les expressions et les premières conséquences? Voilà ce qu'il faut d'abord considérer pour ne pas se représenter un Fontenelle, un Voltaire, un Diderot, comme les produits surprenants d'une sorte de génération spontanée. Les voyages, d'abord, élargissent l'horizon intellectuel. On lit avec une intense curiosité les innombrables relations de voyages dues aux ecclésiastiques des Missions étrangères, aux médecins des Compagnies coloniales, aux capitaines des navires, aux ambassadeurs en pays lointain. Tavernier avait décrit dès 1675 la Turquie, la Perse, les Indes. Chardin, dès 1686, la Perse et les Indes orientales; l'abbé de Choisy, le Siam en 1685. Bernier, dès 1696, la Chine et l'Hindoustan; le baron de la Hon tan, en 1703, révélait l'Amérique du Nord. Mais c'est la Chine qu'on connaît le mieux, grâce aux volumineuses relations des Jésuites, parues de 1696 à 1776. D'autres exercent sur des pays plus proches, sinon leur esprit critique, du moins leur curiosité, comme le Président de Brosses (1709-1777), dont les Lettres sur l'Italie, écrites en 1739-40, ne furent publiées intégralement qu'en 1931. De Brosses, d'ailleurs, à qui Voltaire vouait une haine tenace, par suite de conflits d'intérêts, était un philosophe à l'esprit ouvert, et dont les réflexions sont fort originales, qu'elles portent sur l'histoire romaine, les découvertes géographiques ou les langues.

«
220 HISTOIRE DE LA LITTÉRATURE
vaste public, pénétrer les esprits les plus actifs, jusque
dans les provinces, et triompher auprès de ceux mêmes
dont le goût littéraire restera le plus traditionnel.
Si la révolution s'était faite à la fois sur le plan de l'art et sur celui des idées, nul doute que l'audience des
Philosophes eût été moins grande.
C'est par un phéno
mène analogue que le scepticisme critique d'A.
France
a
dû une grande partie de son immense influence à la
forme toute classique de son style.
Cette loi de compensa
tion est une des plus constantes de la littérature.
Mais enfin, quel est cet esprit nouveau? Quelles en
sont les causes
et les limites, les expressions et les pre
mières conséquences? Voilà ce qu'il faut d'abord consi
dérer pour ne pas se représenter un Fontenelle, un
Voltaire, un Diderot, comme les produits surprenants
d'une sorte de génération spontanée.
Les voyages, d'abord, élargissent l'horizon intellectuel.
On lit avec une intense curiosité les innombrables rela
tions de voyages dues aux ecclésiastiques des Missions
étrangères, aux médecins des Compagnies coloniales, aux capitaines des navires, aux ambassadeurs en
pays lointain.
Tavernier avait décrit dès 1675 la
Turquie, la Perse, les Indes.
Chardin, dès 1686,
la Perse et les Indes orientales; l'abbé de Choisy, le Siam
en 1685.
Bernier, dès 1696, la Chine et l'Hindoustan;
le baron de la Hon tan, en 1703, révélait l'Amérique du Nord.
Mais c'est la Chine qu'on connaît le mieux,
grâce aux volumineuses relations des Jésuites, parues
de 1696 à 1776.
D'autres exercent sur des pays plus
proches, sinon leur esprit critique, du moins leur curio
sité, comme le Président de Brosses (1709-1777),
dont les Lettres sur l'Italie, écrites en 1739-40, ne furent
publiées intégralement qu'en 1931.
De Brosses, d'ail
leurs, à qui Voltaire vouait une haine tenace,
par suite
de conflits d'intérêts, était un philosophe à l'esprit
ouvert, et dont les réflexions sont fort originales, qu'elles portent sur l'histoire romaine, les découvertes géogra
phiques ou les langues.
L'importance de ces descriptions de voyageurs
et d'érudits est capitale.
C'est dans ces ouvrages que tous
ceux qu'anime l'esprit critique trouveront les faits dont
l'examen les obligera à se pénétrer de cette idée que tout est relatif, que ni la religion, ni la morale, ni la
politique, ne sont forcément telles que les Français les.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Jacques Audiberti 1899-1965 La poésie et le roman sont les deux chemins qui, plus ou moins conjugués, ont conduit Jacques Audiberti vers le théâtre.
- Dans quelle mesure les premières pages d'un livre (roman, poésie, théâtre, essai, etc.) peuvent-elles orienter la lecture de l'oeuvre tout entière et susciter l'envie de la pousuivre ?
- Que ce soit dans le domaine du roman, de l'autobiographie, du théâtre ou de la poésie, la littérature fait souvent de larges emprunts à l'Histoire : Corneille fait revivre dans ses pièces des héros romains, Mme de La Fayette nous dépeint dans La Princesse de Clèves une fresque de la Cour d'Henri II, Ronsard, d'Aubigné, Hugo, et bien d'autres rehaussent parfois leur lyrisme de souvenirs ou de témoignages historiques ; en vous appuyant sur des exemples précis tirés de vos lectures, vous
- LORRAIN, Paul Duval, dit Jean (1855-1906) Poésie théâtre ou roman, son oeuvre " fin de siècle " est assez vénéneuse : Modernités (1885), Très russe, les Griseries, M.
- LORRAIN, Paul Duval, dit Jean (1855-1906) Poésie théâtre ou roman, son ?