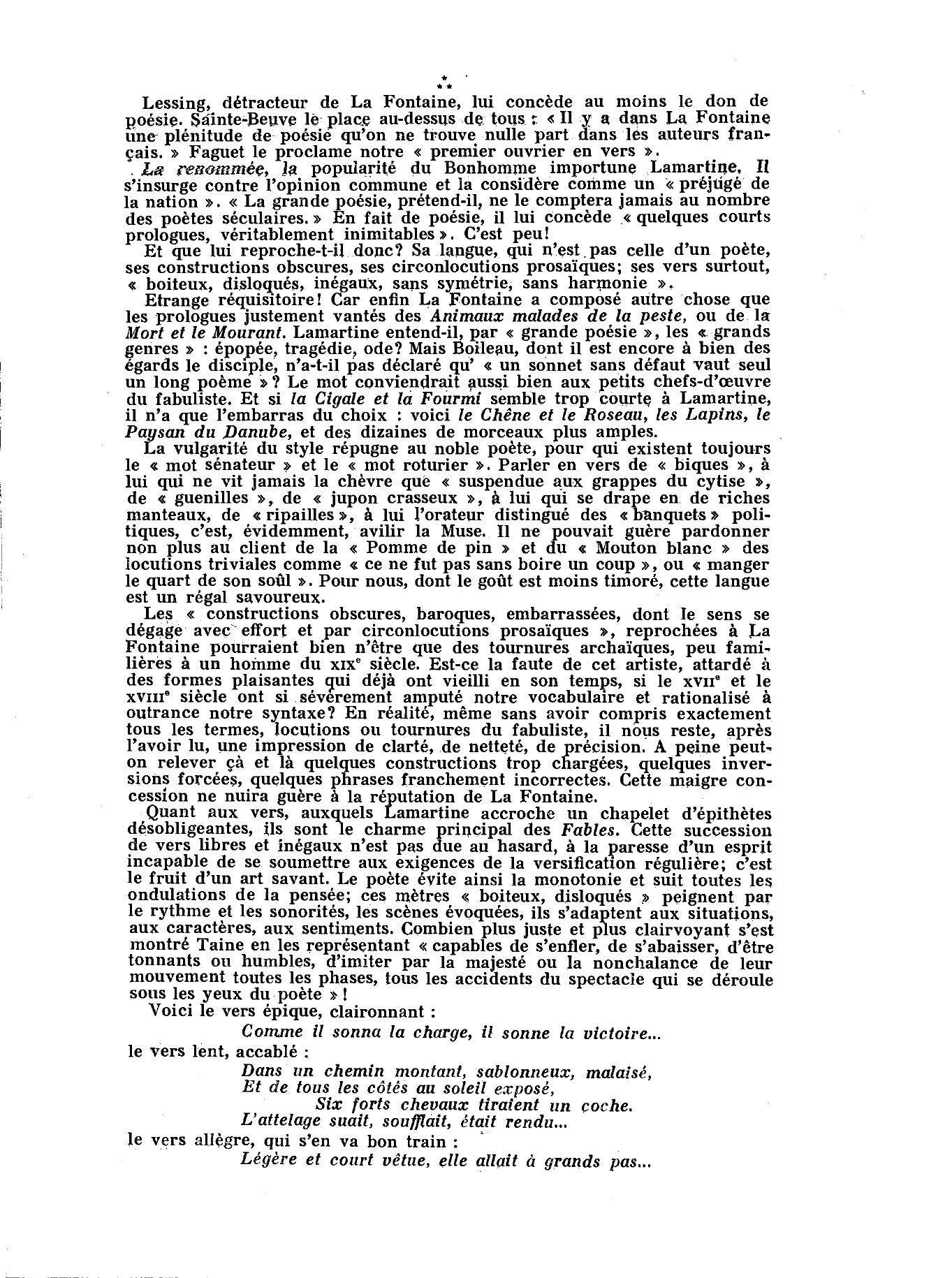Lamartine contre La Fontaine
Publié le 16/02/2012

Extrait du document
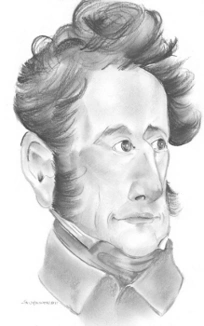
«La Fontaine«, déclare Lamartine, «est un préjugé de la nation «. Jamais la grande poésie ne le comptera au nombre des poètes séculaires.,.
Ses vers sont boiteux, disloqués, inégaux, sans symétrie dans l'oreille ni sur la page... Ni vers, ni prose, ce sont «les limbes de la pensée«...
Ses fables immorales, fausses, cruelles, sont la philosophie dure, froide, égoïste du vieillard, plutôt que la philosophie aimante, généreuse, naïve et bonne de l'enfant.
Enfin, si le livre n'est pas bon, c'est que l'homme ne l'était pas : c'est par dérision, semble-t-il, qu'on lui a donné le nom de bon La Fontaine.
Répondez à cet acte d'accusation.
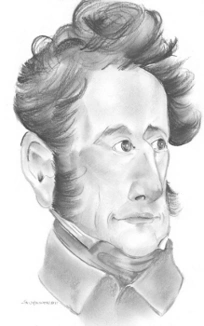
«
Lessing, detracteur de La Fontaine, lui concede au moins le don de
poesie.
Sainte-Beuve le place au-dessus de.
tous.
« Il y a dans La Fontaine
une plenitude de poesie qu on ne trouve nulle part dans les auteurs Iran- cais.
» Faguet le proclame notre « premier ouvrier en vers ».
La re, ammee, la popularite du Bonhomme importune Lamartine, Ii
s'insurge contre l'opinion commune et la considere comme un « prejtige de
la nation ».
« La grande poesie, pretend-il, ne le comptera jamais au nombre
des pokes seculaires.
» En fait de poesie, it lui concede « quelques courts
prologues, veritablement inimitables ».
C'est peu! Et que lui reproche-t-il done? Sa langue, qui n'est pas celle d'un poke,
ses constructions obscures, ses circonlocutions prosalques; ses vers surtout, boiteux, disloques, inegaux, sans synaetrie, sans harmonie ».
Etrange requisitoire Car enfin La Fontaine a compose autre chose que
les prologues justement vantes des Animaux malades de la peste, ou de In
Mort et le Mourant.
Lamartine entend-il, par « grande poesie », les a.
grands
genres » : epopee, tragedie, ode? Mais Boileau, dont it est encore a bien des
egards le disciple, n'a-t-il pas declare qu' « un sonnet sans Maid vaut seul
un long poeme » ? Le mot conviendrait aussi bien aux petits chefs-d'ceuvre du fabuliste.
Et si la Cigale et la Fourmi semble trop courte a Lamartine,
it n'a que l'embarras du choix : voici le Chene et le Roseau, les Lapins, le
Paysan du Danube, et des dizaines de morceaux plus amples.
La vulgarite du style repugne au noble poke, pour qui existent toujours
le « mot senateur » et le « mot roturier ».
Parler en vers de « biques »,
lui qui ne vit jamais la chevre que « suspendue aux grappes du cytise de a guenilles >, de « jupon crasseux », a lui qui se drape en de riches
manteaux, de a ripailles », a lui l'orateur distingue des e hanquets » poli-
tiques, c'est, evidemment, avilir la Muse.
H ne pouvait guere pardonner
non plus an client de la « Pomme de pin » et du a Mouton blanc » des
locutions triviales comme < ce ne fut pas sans boire un coup », ou « manger
le quart de son soul ».
Pour nous, dont le goilt est moins timore, cette langue
est un regal savoureux.
Les « constructions obscures, baroques, embarrassees, dont le sens se
degage avec effort et par circonlocutions prosalques reprochees a La
Fontaine pourraient bien n'etre que des tournures archalques, peu fami-
lieres a un homme du xixe siecle.
Est-ce la faute de cet artiste, attarde
des formes plaisantes qui deja ont vieilli en son temps, si le xviie et le
xviir siècle ont si severement ampute notre vocabulaire et rationalise a
outrance notre syntaxe? En realite, meme sans avoir compris exactement
tous les termes, locutions on tournures du fabuliste, it nous reste, apres
l'avoir in, une impression de dart& de nettete, de precision.
A peine pent-
on relever ca et la quelques constructions trop chargees, quelques inver-
sions forcees, quelques phrases franchement incorrectes.
Cette maigre con-
cession ne nuira guere a la reputation de La Fontaine.
Quant aux vers, auxquels Lamartine accroche un chapelet d'epithetes
desobligeantes, Us sont le charme principal des Fables.
Cette succession
de vers libres et inegaux n'est pas due an hasard, a la paresse d'un esprit
incapable de se soumettre aux exigences de la versification reguliere; c'est
le fruit d'un art savant.
Le poke evite ainsi la monotonie et suit toutes les
ondulations de la pensee; ces metres « boiteux, disloques » peignent par
le rythme et les sonorites, les scenes evoquees, ils s'adaptent aux situations,
aux caracteres, aux sentiments.
Combien plus juste et plus clairvoyant s'est
montre Taine en les representant « capables de s'enfler, de s'abaisser, d'etre
tonnants ou humbles, d'imiter par la majeste ou la nonchalance de leur
mouvement toutes les phases, tons les accidents du spectacle qui se deroule sous les yeux du poke » !
Voici le vers epique, claironnant :
Comme it sonna la charge, it sonne la victoire...
le vers lent, seeable ;
Dans an chemin montant, sablonneux, malaise,Et de tous les cotes au soleil expose,
Six forts chevaux tiraient un coche.
L'attelage suait, soufflait, etait rendu...
le vers allegre, qui s'en va bon train : Legere et court vetue, elle allait a grands pas...
Lessing, détracteur de La Fontaine, lui concède au moins le don de poésie. Sainte-Beuve lê place au-dessus de tous t «Il y a dans La Fontaine
line plénitude de poésie qu'on ne trouve nulle part dans lés auteurs fran çais. » Faguet le proclame notre « premier ouvrier en vers ».
, Léê renommée, la popularité du Bonhomme importune Lamartine, H
s'insurge contre l'opinion commune et la considère comme un « préjugé de la nation ».
« La grande poésie, prétend-il, ne le comptera jamais au nombre
des poètes séculaires. » En fait de poésie, il lui concède « quelques courts
prologues, véritablement inimitables». C'est peu! Et que lui reproehe-t-ü donc? Sa langue, qui n'est.pas celle d'un poète, ses constructions obscures, ses circonlocutions prosaïques; ses vers surtout, « boiteux, disloqués, inégaux, sans symétrie, sans harmonie ».
Etrange réquisitoire! Car enfin La Fontaine a composé autre chose que
les prologues justement vantés des Animaux malades de la peste, ou de la Mort et le Mourant. Lamartine entend-il, çar « grande poésie », les « grands
genres » : épopée, tragédie, ode? Mais Boileau, dont il est encore à bien des égards le disciple, n'a-t-il pas déclaré qu' « un sonnet sans défaut vaut seul un long poème » ? Le mot conviendrait aussi bien aux petits chefs-d'œuvre
du fabuliste.
Et si la Cigale et la Fourmi semble trop çourtç à Lamartine, il n'a que l'embarras du choix : voici le Chêne et le Roseau, les Lapins, le
Paysan du Danube, et des dizaines de morceaux plus amples.
La vulgarité du style répugne au noble poète, pour qui existent toujours
le « mot sénateur » et le « mot roturier ». Parler en vers de « biques », à lui qui ne vit jamais la chèvre que « suspendue aux grappes du cytise »,
de « guenilles », de « jupon crasseux », à lui qui se drape en de riches
manteaux, de
«ripailles», à lui l'orateur distingué des «banquets» poli
tiques, c'est, évidemment, avilir la Muse.
Il ne pouvait guère pardonner
non plus au client de la « Pomme de pin » et du « Mouton blanc » des
locutions triviales comme « ce ne fut pas sans boire un coup », ou « manger
le quart de son
soûl ».
Pour nous, dont le goût est moins timoré, cette langue
est un régal savoureux.
Les « constructions obscures, baroques, embarrassées, dont le sens se dégage aveç effort et par circonlocutions prosaïques », reprochées à La Fontáine pourraient bien n'être que des tournures archaïques, peu fami lières à un homme du xix e siècle. Est-ce la faute de cet artiste, attardé à
des formes plaisantes crai déjà ont vieilli en son temps, si le xvn e et le XVIII6 siècle ont si sévèrement amputé notre vocabulaire et rationalisé à
outrance notre syntaxe? En réalité, même sans avoir compris exactement tous les termes, locutions ou tournures du fabuliste, il nous reste, après l'avoir lu, une impression de clarté, de netteté, de précision. A peine peut^
on relever çà et là quelques constructions trop chargées, quelques inver
sions forcées, quelques phrases franchement incorrectes.
Cette maigre con
cession ne nuira guère à la réputation de La Fontaine.
Quant aux vers, auxquels Lamartine accroche un chapelet d'épithètes
désobligeantes, ils sont le charme principal des Fables.
Cette succession
de vers libres et inégaux n'est pas due au hasard, à la paresse d'un esprit incapable de se soumettre aux exigences de la versification régulière; c'est le fruit d'un art savant.
Le poète évite ainsi la monotonie et suit toutes les
ondulations de la pensée; ces mètres « boiteux, disloqués » peignent par
le rythme et les sonorités, les scènes évoquées, ils s'adaptent aux situations,
aux caractères, aux sentiments.
Combien plus juste et plus clairvoyant s'est montré Taine en les représentant « capables de s'enfler, de s'abaisser, d'être tonnants ou humbles, d'imiter par la majesté ou la nonchalance de leur
mouvement toutes les phases, tous les accidents du spectacle qui se déroule sous les yeux du poète » ! Voici le vers épique, claironnant :
Comme il sonna la charge, il sonne la victoire...
le vers lent,
accablé :
Dans un chemin
montant, sablonneux, malaisé, Et de tous les côtés au soleil exposé,
Six forts chevaux tiraient un coche.
L'attelage suait, soufflait, était rendu...
le vers allègre, qui s'en va bon train :
Légère et court vêtue, elle allait à grands pas....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- « Les Fables de La Fontaine sont plutôt la philosophie dure, froide et égoïste du vieillard, que la philosophie aimante, généreuse, naïve et bonne d'un enfant », écrit, en 1849, Lamartine dans la préface à la réédition de ses Premières méditations. Vous commenterez ce jugement en vous appuyant sur les fables que vous avez étudiées. ?
- Lamartine reprochait aux fables de La Fontaine d'être « immorales, fausses et cruelles » ? Que pensez-vous de cette appréciation ?
- Lamartine écrit dans la Préface de ses Méditations (1849) : « Les fables de La Fontaine sont plutôt la philosophie dure, froide et égoïste d'un vieillard, que la philosophie aimante, généreuse, naïve et bonne d'un enfant : c'est du fiel, ce n'est pas du lait pour les lèvres et pour les coeurs de cet âge. »
- Analyse du poème "La Charité" des Méditations Poétiques de Lamartine
- Le pragmatisme dans les fables de La Fontaine