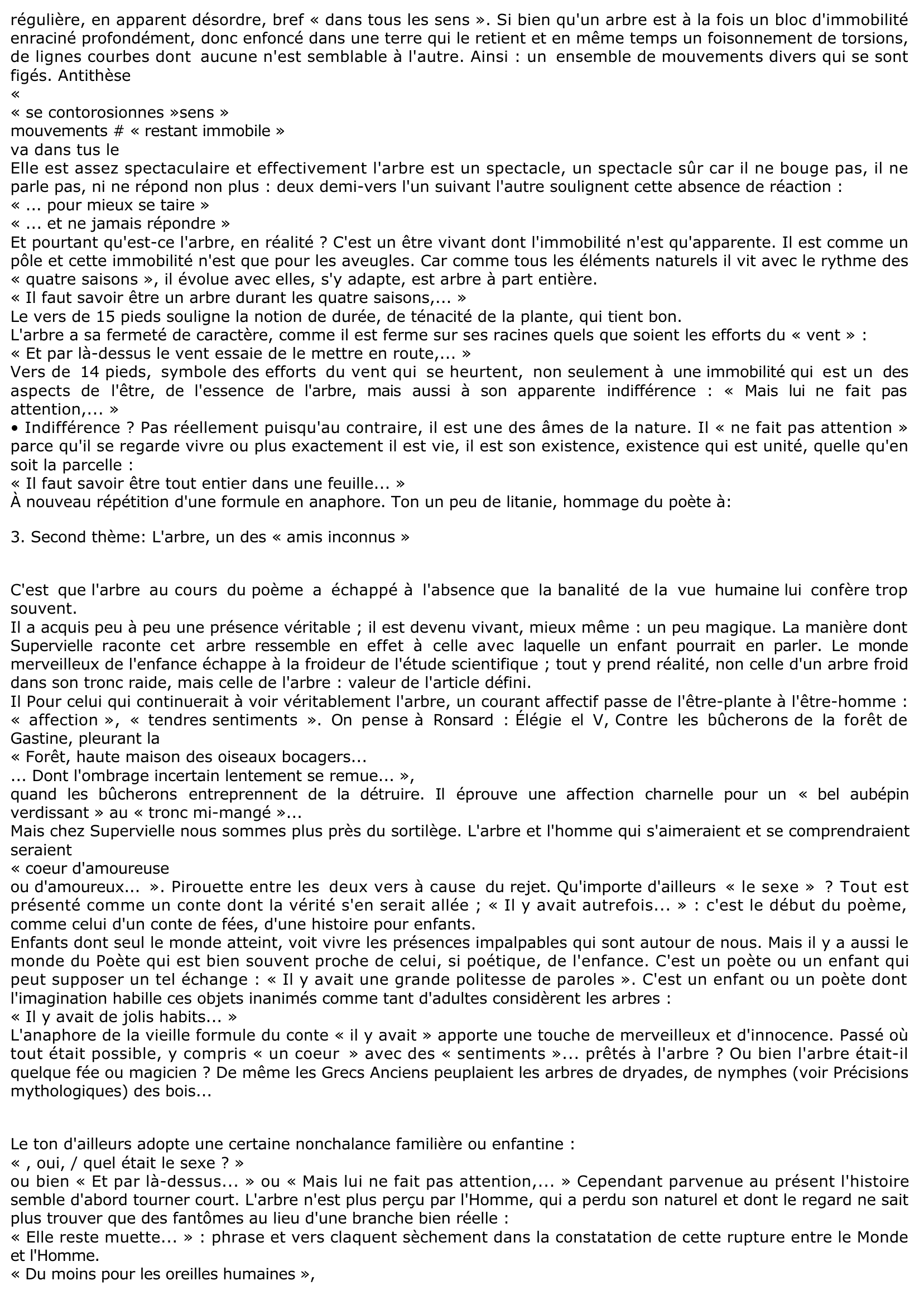L'ARBRE DE J. SUPERVIELLE (Commentaire)
Publié le 28/02/2011

Extrait du document
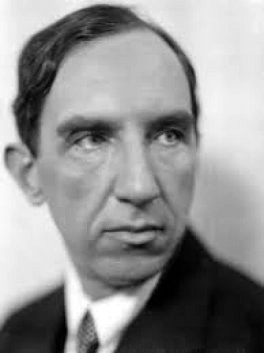
Il y avait autrefois de l'affection, de tendres sentiments, C'est devenu du bois. Il y avait une grande politesse de paroles, C'est du bois maintenant, des ramilles, du feuillage. Il y avait de jolis habits autour d'un coeur d'amoureuse Ou d'amoureux, oui, quel était le sexe ? C'est devenu du bois sans intentions apparentes Et si l'on coupe une branche et qu'on regarde la fibre Elle reste muette Du moins pour les oreilles humaines, Pas un seul mot n'en sort mais un silence sans nuances Vient des fibrilles de toute sorte où passe une petite fourmi. Comme il se contorsionne l'arbre, comme il va dans tous les sens, Tout en restant immobile ! Et par là-dessus le vent essaie de le mettre en route, Il voudrait en faire une espèce d'oiseau bien plus grand que nature Parmi les autres oiseaux Mais lui ne fait pas attention, Il faut savoir être un arbre durant les quatre saisons, Et regarder, pour mieux se taire, Écouter les paroles des hommes et ne jamais répondre, Il faut savoir être tout entier dans une feuille Et la voir qui s'envole.
J. SUPERVIELLE, Les Amis inconnus, 1934. Éd. Gallimard. Vous écrirez un commentaire composé de ce poème pour dire la lecture que vous en avez faite. Vous pourriez, par exemple, vous interroger sur l'originalité d'une telle évocation de l'arbre et sur sa signification.
• Supervielle (1884-1960) : Né à Montevideo (Uruguay) d'un père béarnais et d'une mère basque qui y avaient fondé une banque. Orphelin à 8 mois lors de son premier voyage en France, ses parents étant morts empoisonnés par l'eau chargée de vert-de-gris d'un vieux robinet. Enfance très heureuse avec son oncle et sa tante à Montevideo et dans la pampa sud-américaine. Études de 1894 à 1902 au Lycée Janson-deSailly à Paris. Après son baccalauréat, nombreux voyages en Amérique. Licence d'espagnol. Mariage avec une Uruguayenne. Six enfants. Sa vie se confond presque tout le temps avec son oeuvre poétique. Citons spécialement L'Homme de la Pampa, Gravitations, Débarcadère, L'enfant de la Haute Mer. Il fut toute sa vie de santé très délicate (cardiaque). Poète des « laborieuses énigmes du langage «, donc assez difficile souvent, qui est toujours resté indépendant des courants et des modes.
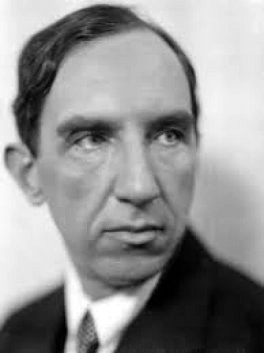
«
régulière, en apparent désordre, bref « dans tous les sens ».
Si bien qu'un arbre est à la fois un bloc d'immobilitéenraciné profondément, donc enfoncé dans une terre qui le retient et en même temps un foisonnement de torsions,de lignes courbes dont aucune n'est semblable à l'autre.
Ainsi : un ensemble de mouvements divers qui se sontfigés.
Antithèse«« se contorosionnes »sens »mouvements # « restant immobile »va dans tus leElle est assez spectaculaire et effectivement l'arbre est un spectacle, un spectacle sûr car il ne bouge pas, il neparle pas, ni ne répond non plus : deux demi-vers l'un suivant l'autre soulignent cette absence de réaction :« ...
pour mieux se taire »« ...
et ne jamais répondre »Et pourtant qu'est-ce l'arbre, en réalité ? C'est un être vivant dont l'immobilité n'est qu'apparente.
Il est comme unpôle et cette immobilité n'est que pour les aveugles.
Car comme tous les éléments naturels il vit avec le rythme des« quatre saisons », il évolue avec elles, s'y adapte, est arbre à part entière.« Il faut savoir être un arbre durant les quatre saisons,...
»Le vers de 15 pieds souligne la notion de durée, de ténacité de la plante, qui tient bon.L'arbre a sa fermeté de caractère, comme il est ferme sur ses racines quels que soient les efforts du « vent » :« Et par là-dessus le vent essaie de le mettre en route,...
»Vers de 14 pieds, symbole des efforts du vent qui se heurtent, non seulement à une immobilité qui est un desaspects de l'être, de l'essence de l'arbre, mais aussi à son apparente indifférence : « Mais lui ne fait pasattention,...
»• Indifférence ? Pas réellement puisqu'au contraire, il est une des âmes de la nature.
Il « ne fait pas attention »parce qu'il se regarde vivre ou plus exactement il est vie, il est son existence, existence qui est unité, quelle qu'ensoit la parcelle :« Il faut savoir être tout entier dans une feuille...
»À nouveau répétition d'une formule en anaphore.
Ton un peu de litanie, hommage du poète à:
3.
Second thème: L'arbre, un des « amis inconnus »
C'est que l'arbre au cours du poème a échappé à l'absence que la banalité de la vue humaine lui confère tropsouvent.Il a acquis peu à peu une présence véritable ; il est devenu vivant, mieux même : un peu magique.
La manière dontSupervielle raconte cet arbre ressemble en effet à celle avec laquelle un enfant pourrait en parler.
Le mondemerveilleux de l'enfance échappe à la froideur de l'étude scientifique ; tout y prend réalité, non celle d'un arbre froiddans son tronc raide, mais celle de l'arbre : valeur de l'article défini.Il Pour celui qui continuerait à voir véritablement l'arbre, un courant affectif passe de l'être-plante à l'être-homme :« affection », « tendres sentiments ».
On pense à Ronsard : Élégie el V, Contre les bûcherons de la forêt deGastine, pleurant la« Forêt, haute maison des oiseaux bocagers......
Dont l'ombrage incertain lentement se remue...
»,quand les bûcherons entreprennent de la détruire.
Il éprouve une affection charnelle pour un « bel aubépinverdissant » au « tronc mi-mangé »...Mais chez Supervielle nous sommes plus près du sortilège.
L'arbre et l'homme qui s'aimeraient et se comprendraientseraient« coeur d'amoureuseou d'amoureux...
».
Pirouette entre les deux vers à cause du rejet.
Qu'importe d'ailleurs « le sexe » ? Tout estprésenté comme un conte dont la vérité s'en serait allée ; « Il y avait autrefois...
» : c'est le début du poème,comme celui d'un conte de fées, d'une histoire pour enfants.Enfants dont seul le monde atteint, voit vivre les présences impalpables qui sont autour de nous.
Mais il y a aussi lemonde du Poète qui est bien souvent proche de celui, si poétique, de l'enfance.
C'est un poète ou un enfant quipeut supposer un tel échange : « Il y avait une grande politesse de paroles ».
C'est un enfant ou un poète dontl'imagination habille ces objets inanimés comme tant d'adultes considèrent les arbres :« Il y avait de jolis habits...
»L'anaphore de la vieille formule du conte « il y avait » apporte une touche de merveilleux et d'innocence.
Passé oùtout était possible, y compris « un coeur » avec des « sentiments »...
prêtés à l'arbre ? Ou bien l'arbre était-ilquelque fée ou magicien ? De même les Grecs Anciens peuplaient les arbres de dryades, de nymphes (voir Précisionsmythologiques) des bois...
Le ton d'ailleurs adopte une certaine nonchalance familière ou enfantine :« , oui, / quel était le sexe ? »ou bien « Et par là-dessus...
» ou « Mais lui ne fait pas attention,...
» Cependant parvenue au présent l'histoiresemble d'abord tourner court.
L'arbre n'est plus perçu par l'Homme, qui a perdu son naturel et dont le regard ne saitplus trouver que des fantômes au lieu d'une branche bien réelle :« Elle reste muette...
» : phrase et vers claquent sèchement dans la constatation de cette rupture entre le Mondeet l'Homme.« Du moins pour les oreilles humaines »,.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Commentaire Supervielle
- Commentaire "Marseille" Jules Supervielle, Débarcadères, 1927
- Commentaire du poème "l'arbre-rose" dans Les Mains Libres Eluard/Man Ray
- PLEIN CIEL de Supervielle, Poèmes, 1939 1945. Commentaire
- Supervielle, Poèmes: commentaire composé