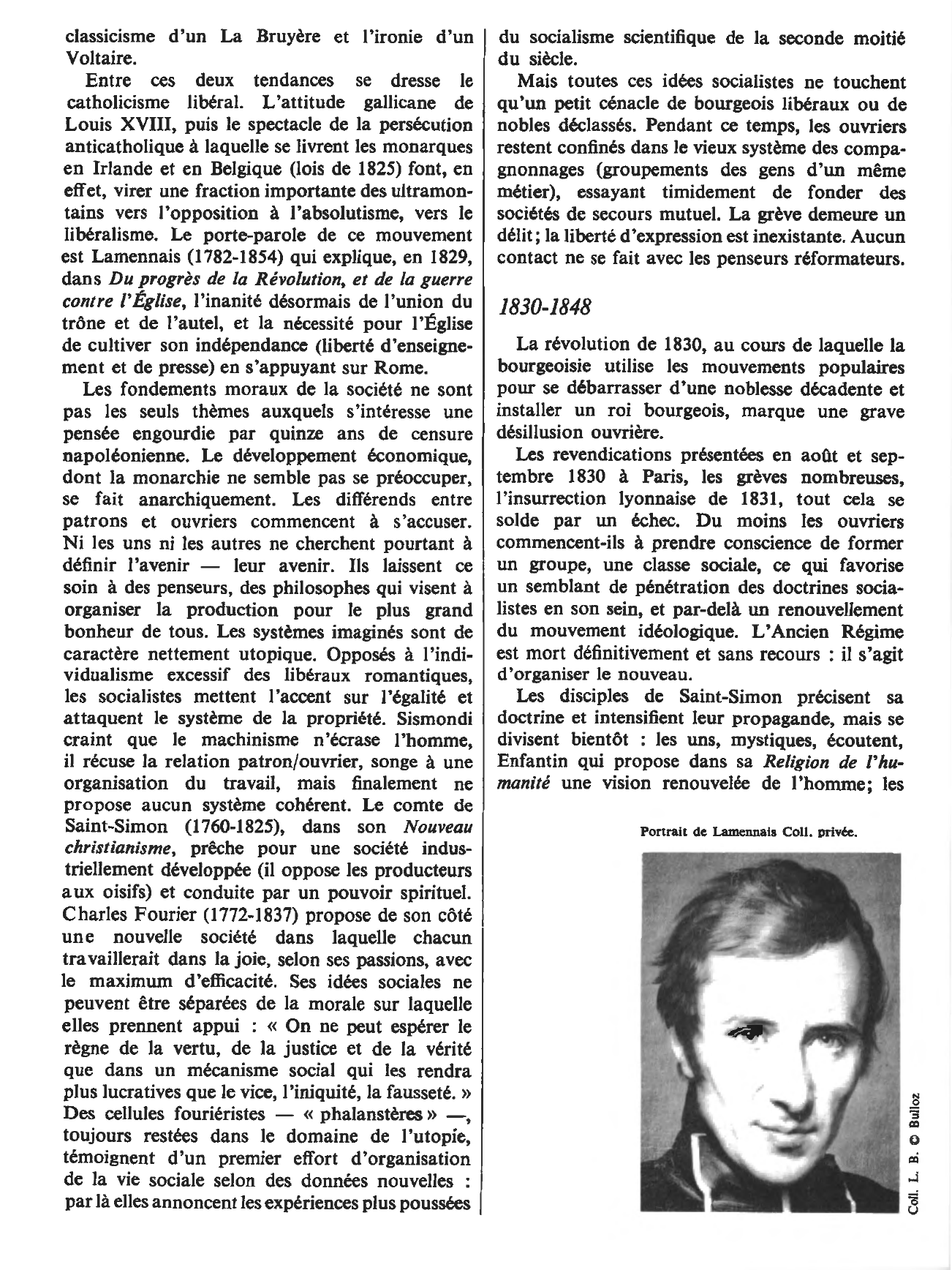LE MOUVEMENT DES IDÉES DANS LA PREMIÈRE MOITIÉ DU XIXe SIÈCLE
Publié le 04/04/2012

Extrait du document
Le courant anarchiste ne se distinguera des précédents que plus avant dans le siècle. Tandis qu 'une petite élite bourgeoise s'occupe de réformer le monde, la majorité s'installe dans une libre pensée peu virulente; la francmaçonnerie n 'est plus une antireligion, les éditions de Voltaire se vendent moins, et l'on admet que la religion apprend fort utilement au peuple la résignation. Le représentant du mode de pensée le plus répandu est Victor Cousin, dont l'éclectisme mêle savamment philosophie et croyance. On se détache de la religion, on ne la combat plus...
«
classicisme d'un La Bruyère et l'ironie d'un
Voltaire.
Entre ces deux tendances se dresse le
catholicisme libéral.
L'attitude gallicane de
Louis XVIII, puis le spectacle de la persécution
anticatholique à laquelle se livrent les monarques
en Irlande et en Belgique (lois de 1825) font, en
effet, virer une fraction importante des ultramon
tains vers l'opposition à l'absolutisme, vers le
libéralisme.
Le porte-parole de ce mouvement
est Lamennais (1782-1854) qui explique, en 1829,
dans Du progrès de la Révolution, et de la guerre
contre l'Église,
l'inanité désormais de l'union du
trône et de 1 'autel, et la nécessité pour 1 'Église
de cultiver son indépendance (liberté d'enseigne
ment et de presse) en s'appuyant sur Rome.
Les fondements
moraux de la société ne sont
pas les seuls thèmes auxquels s'intéresse une
pensée engourdie
par quinze ans de censure
napoléonienne.
Le développement économique,
dont la monarchie ne semble pas se préoccuper,
se fait anarchiquement.
Les différends entre
patrons et ouvriers commencent à s'accuser.
Ni les uns ni les autres ne cherchent pourtant à
définir l'avenir -leur avenir.
Ils laissent ce
soin à des penseurs, des philosophes qui visent à
organiser
la production pour le plus grand
bonheur de tous.
Les systèmes imaginés sont de
caractère nettement utopique.
Opposés à l'indi
vidualisme excessif des libéraux romantiques,
les socialistes mettent l'accent
sur l'égalité et
attaquent le système de la propriété.
Sismondi
craint que le machinisme n'écrase 1 'homme,
il récuse la relation patron/ouvrier, songe à une
organisation du travail, mais finalement ne
propose aucun système cohérent.
Le comte de
Saint-Simon (1760-1825), dans son
Nouveau
christianisme,
prêche pour une société indus
triellement développée
(il oppose les producteurs
aux oisifs) et conduite par un pouvoir spirituel.
Charles Fourier (1772-1837) propose de son côté
une nouvelle société dans laquelle chacun
travaillerait dans la joie, selon ses passions, avec
le
maximum d'efficacité.
Ses idées sociales ne
peuvent être séparées de la morale sur laquelle
elles prennent appui :
« On ne peut espérer le
règne de la vertu, de
la justice et de la vérité
que dans un mécanisme social qui les rendra
plus lucratives que le vice, 1 'iniquité, la fausseté.
»
Des cellules fouriéristes - « phalanstères» -,
toujours restées dans le domaine de l'utopie,
témoignent
d'un premier effort d'organisation
de la vie sociale selon des données nouvelles :
par là elles annoncent les expériences plus poussées
du socialisme scientifique de la seconde moitié
du siècle.
Mais toutes ces idées socialistes ne touchent
qu'un petit cénacle de bourgeois libéraux ou de
nobles déclassés.
Pendant ce temps, les ouvriers
restent confinés dans le vieux système des
compa
gnonnages (groupements des gens d'un même
métier), essayant timidement
de fonder des
sociétés de secours mutuel.
La grève demeure un
délit; la liberté d'expression est inexistante.
Aucun
contact ne se fait avec les penseurs réformateurs.
1830-1848
La révolution de 1830, au cours de laquelle la
bourgeoisie utilise les mouvements populaires
pour se débarrasser d'une noblesse décadente et
installer un roi bourgeois, marque une grave
désillusion ouvrière.
Les revendications présentées
en aoüt et sep
tembre
1830 à Paris, les grèves nombreuses,
l'insurrection lyonnaise de 1831,
tout cela se
solde
par un échec.
Du moins les ouvriers
commencent-ils à
prendre conscience de former
un groupe, une classe sociale, ce qui favorise
un semblant de pénétration des doctrines socia
listes en son sein,
et par-delà un renouvellement
du mouvement idéologique.
L'Ancien Régime
est
mort définitivement et sans recours : il s'agit
d'organiser le nouveau.
Les disciples de Saint-Simon précisent
sa
doctrine et intensifient leur propagande, mais se
divisent bientôt : les uns, mystiques, écoutent,
Enfantin qui propose dans
sa Religion de l'hu
manité
une vision renouvelée de l'homme; les
Portrait de Lamennais Coll.
privée..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- « Toutes les nouveautés durables de la première moitié du XIXe siècle, en poésie, en histoire, en critique, ont reçu de Chateaubriand ou la première inspiration ou l'impulsion définitive» (Nisard). Commentez et discutez. On ne saurait suspecter Nisard de tendresse pour tout ce qui touchait au mouvement romantique. Classique plein de prévention, il jugeait avec sévérité toutes les nouveautés de son temps. On n'en est que plus étonné de la clairvoyance du jugement qu'il porte sur l'influ
- Le réalisme, s'il a traversé l'art de toutes les époques comme démarche s'attachant à reproduire la réalité, n'est devenu un véritable mouvement qu'au XIXe siècle.
- Ramakrishna Ramakrishna (1834-1886), brahmane bengali, l'un des principaux acteurs du renouveau indien au XIXe siècle avec Vivekananda, son disciple, et Dayananda Saravasti, fondateur du mouvement réformiste hindou Arya Samaj.
- expressionnisme (musique) expressionnisme (musique), courant musical participant d'un vaste mouvement de la première moitié du XXe siècle, fondé sur l'expression d'une subjectivité douloureuse, et recourant à de nouvelles formes tonales.
- médiévale, musique 1 PRÉSENTATION médiévale, musique, terme générique qui désigne la musique européenne entre environ 900 et 1400 et qui se rapporte également à un mouvement moderne s'intéressant aux pratiques d'interprétation de la musique antérieure au XIXe siècle.