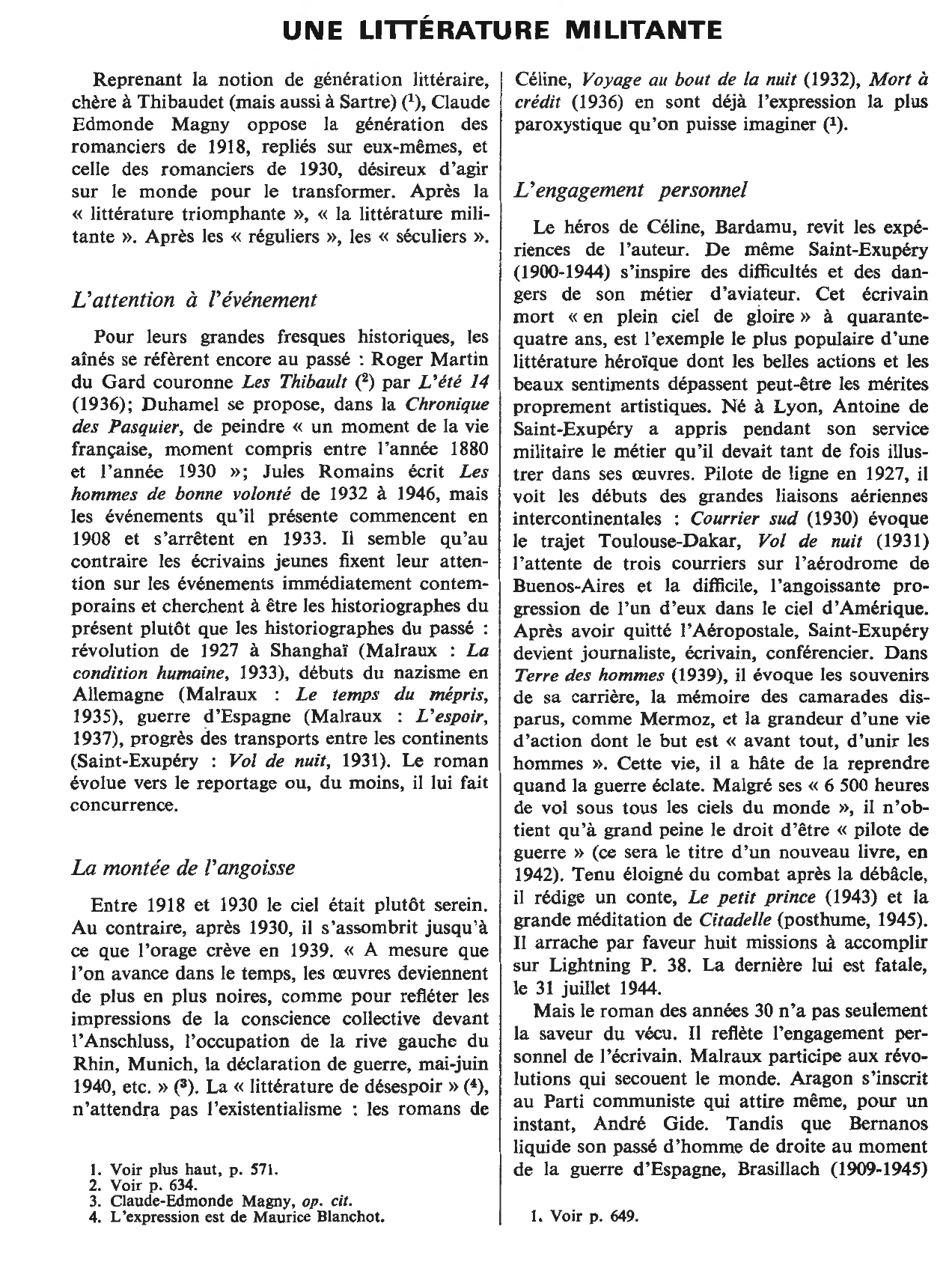LE ROMAN DES «ANNÉES TRENTE»
Publié le 04/04/2012

Extrait du document
Un homme avait consacré son existence à la communauté, même s'il l'avait fait dans les limites peu étendues de son intelligence et de son coeur; mais, au moment de mourir, il n'y avait plus que lui : c'était l'individu qui avait le dernier mot. Celestino disait un jour à Pineda [sa fille] : "l'avènement du socialisme est plus important que la conquête de la lune". A présent il aurait pu ajouter : ...
«
UNE LITTÉRATURE MILITANTE
Reprenant la notion de génération littéraire,
chère à Thibaudet (mais aussi à Sartre) (1), Claude
Edmonde Magny oppose la génération des
romanciers de 1918, repliés sur eux-mêmes, et
celle des romanciers de 1930, désireux d
'ag ir
sur le monde pour le transformer.
Après la
« littérature triomphante », « la littérature mili
tante ».
Après les « réguliers », les « séculiers ».
L'attention à l'événement
Pour leurs grandes fresques historiques, les
aînés se réfèrent encore
au passé : Roger Martin
du Gard couronne Les Thibault (2) par L'été 14
(1936);
Duhamel se propose, dans la Chronique
des Pasquier, de
peindre « un moment de la vie
française,
moment compris entre l'année 1880
et 1 'année 1930 »; Jules Romains écrit Les
hommes de bonne volonté de 1932 à 1946, mais
les événements
qu'il présente commencent en
1908 et s'arrêtent en 1933.
Il semble qu'au
contraire les écrivains jeunes fixent leur atten
tion sur les événements immédiatement contem
porains et cherchent à être les historiographes du
présent plutôt que les historiographes du passé :
révolution de 1927 à
Shanghaï (Malraux : La
condition humaine, 1933), débuts du nazisme en
Allemagne (Malraux : Le temps du mépris,
1935), guerre
d'Espagne (Malraux : L'espoir,
1937), progrès des
transports entre les continents
(Saint-Exupéry : Vol de nuit, 1931).
Le
roman
évolue vers le reportage ou, du moins, il lui fait
concurrence.
La montée de l'angoisse
Entre 1918 et 1930 le ciel était plutôt serein.
Au contraire, après 1930,
il s'assombrit jusqu'à
ce que l'orage crève en 1939.
« A mesure que
l'on avance dans le temps, les œuvres deviennent
de plus en plus noires,
comme pour refléter les
impressions de la conscience collective
devant
l'Anschluss, l'occupation de la rive gauche du
Rhin, Munich, la déclaration de guerre, mai-juin
1940, etc.
» (3).
La « littérature de désespoir » (4),
n'attendra pas 1 'existentialisme : les romans de
!.
Voir plus haut, p.
571.
2.
Voir p.
634.
3.
Claude-Edmonde Magny, op.
cit.
4.
L'expression est de Maurice Blanchot.
Céline, Voyage au bout de la nuit (1932), Mort à
crédit (1936) en sont déjà l'expression la plus
paroxystique
qu'on puisse imaginer ( 1).
L'engagement personnel
Le héros de Céline, Bardamu, revit les expé
riences de l'auteur.
De même Saint-Exupéry
(1900-1944) s'inspire des difficultés
et des dan
gers de son métier d'aviateur.
Cet écrivain
mort « en plein ciel de gioire » à quarante
quatre ans, est l'exemple le plus populaire d'une
littérature héroïque dont les belles actions et les
beaux sentiments dépassent peut-être les mérites
proprement artistiques.
Né à Lyon, Antoine de
Saint-Exupéry a
appris pendant son service
militaire le métier
qu 'il devait tant de fois illus
trer dans ses œuvres.
Pilote de ligne en 1927, il
voit les débuts des grandes liaisons aériennes
intercontinentales : Courrier sud (1930) évoque
le trajet
Toulouse-Dakar, Vol de nuit (1931)
1
'attente de trois courriers sur 1 'aérodrome de
Buenos-Aires et la difficile, 1 'angoissante
pro
gression de l'un d'eux dans le ciel d'Amérique.
Après avoir quitté l'Aéropostale, Saint-Exupéry
devient journaliste, écrivain, conférencier.
Dans
Terre des hommes (1939), il évoque les souvenirs
de
sa carrière, la mémoire des camarades dis
parus , comme Mermoz, et la grandeur d'une vie
d'action dont le but est « avant tout, d'unir les
hommes
».
Cette vie, il a hâte de la reprendre
quand la guerre éclate.
Malgré ses « 6 500 heures
de vol sous tous les ciels
du monde », il n'ob
tient qu'à grand peine le droit d'être « pilote de
guerre
» (ce sera le titre d'un nouveau livre, en
1942).
Tenu éloigné du combat après la débâcle,
il rédige un conte, Le petit prince (1943) et la
grande méditation de Citadelle (posthume, 1945).
Il
arrache par faveur huit missions à accomplir
sur Lightning P.
38.
La dernière lui est fatale,
le
31 juillet 1944.
Mais le
roman des années 30 n'a pas seulement
la saveur du vécu.
Il reflète l'engagement per
sonnel de l'écrivain.
Malraux participe aux révo
lutions qui secouent le monde.
Aragon s'inscrit
au
Parti communiste qui attire même, pour un
instant, André Gide.
Tandis que Bernanos
liquide son passé d'homme de droite au moment
de la guerre d'Espagne, Brasillach (1909-1945)
1.
Voir p.
649..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Mata Hari par Nino Frank Née en 1876, moins de trente ans plus tard elle commence à fabriquer son roman : encore dix autres années, et voilà que ce roman la dépasse, pour former le mythe de l'espionne fatale.
- Le Roman américain de 1945 à 1965 par Michel Mohrt Dessiner le profil littéraire des vingt années d'après-guerre, aux États-Unis, n'est pas facile : il manque le recul.
- Dans ce passage de son autobiographie, Enfance, Nathalie Sarraute raconte comment, âgée d'une douzaine d'années, elle dévorait un roman d'aventures de Ponson du Terrail, Rocambole, malgré les sarcasmes de son père : « C'est de la camelote, ce n'est pas un écrivain. »
- Dans ses notes rédigées au cours des années 1942-1972 et intitulées Le territoire de l'Homme, Elias Canetti écrit : « Tout ce qu'on prend en note, tout ce qu'on met par écrit contient encore un petit grain d'espoir, quand bien même il ne serait venu que du seul désespoir ». A l'aide d'exemples et d'analyses précis, puisés dans le roman, la poésie, le théâtre, vous expliquerez et commenterez cette phrase, en vous demandant comment l'écriture peut à la fois rendre compte du désespoir et
- LE ROMAN DES « ANNÉES VINGT »