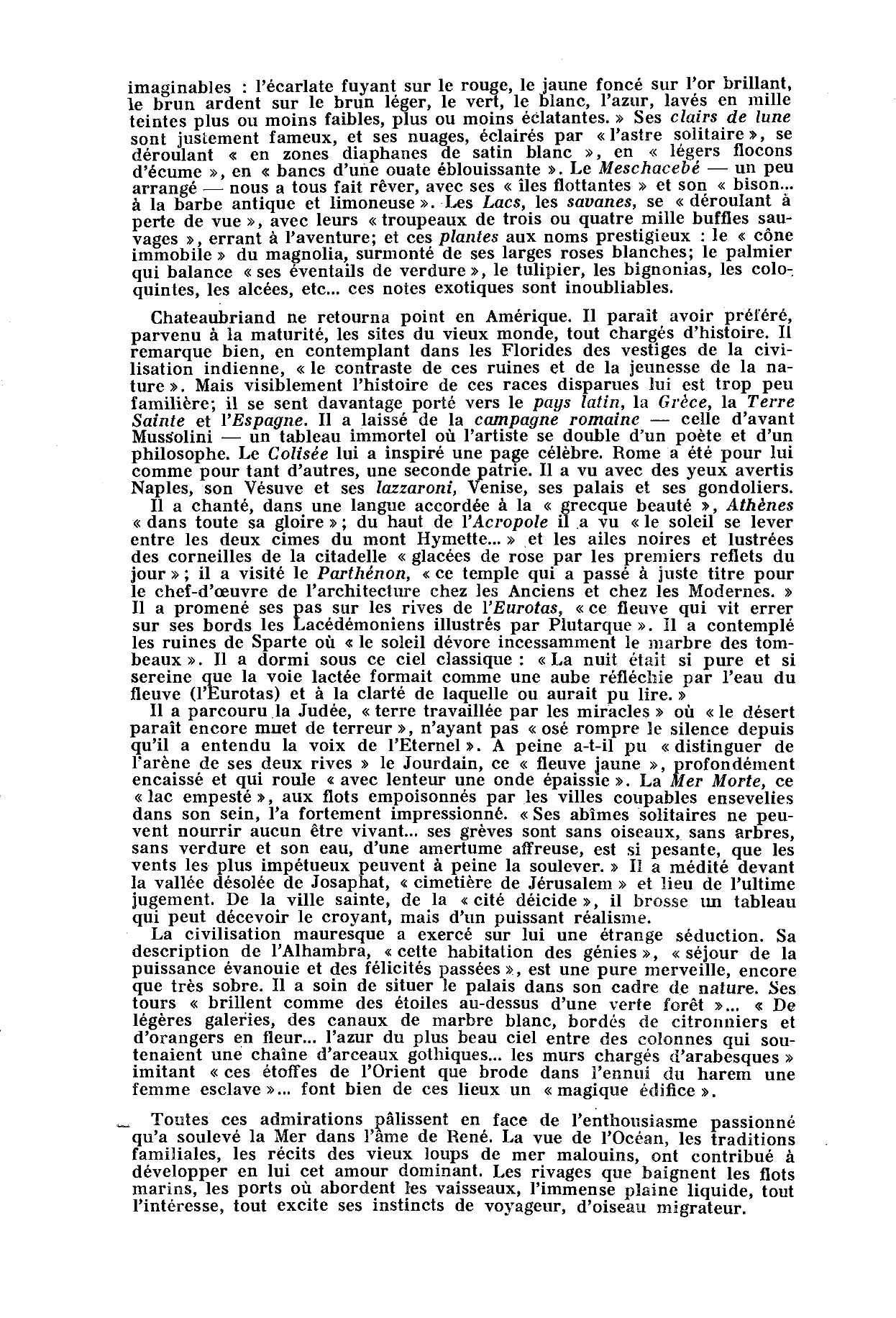Le Sentiment de la Nature chez Chateaubriand
Publié le 17/02/2012

Extrait du document

Semblable étude doit presque nécessairement commencer par le mot de Gautier : « Il a rouvert la grande nature fermée. « C'est là un des mérites que la postérité a le moins contestés à Chateaubriand. Mais avant de souscrire au jugement d'un disciple reconnaissant, peut-être est-il bon de rappeler que, cinquante ans plus tôt, Rousseau avait « mis du vert « dans la littérature française et que Chateaubriand tient de lui son enthousiasme pour la nature. N'est-ce pas Jean-Jacques qui parle par sa bouche lorsque, pénétrant pour la première fois dans les déserts de l'Amérique, il s'écrie : «Liberté primitive, je te retrouve enfin!... Me voilà tel que le Tout-Puissant m'a créé, souverain de la nature... Est-ce sur le front de l'homme de la société ou sur le mien qu'est gravé le sceau immortel de notre origine ?...

«
imaginables
: l'ecarlate fuyant sur le rouge, le jaune f once sur l'or brillant,
le aun ardent sur le brun leger, le vert, le blanc, l'azur, laves en mille
teintes plus ou moins faibles, plus ou moins eclatantes.
» Ses clairs de lunesont jusiement fameux, et ses nuages, eclaires par 1 l'astre solitaire », se
deroulant « en zones diaphanes de satin blanc », en «
legers flocons
d'ecume », en « bancs d'une ouate eblouissante ».
Le Meschacebe - un peu
arrange - nous a tour fait rover, avec ses « files flottantes » et son « bison...
a la barbe antique et limoneuse ».
Les Lacs, les sauanes, se « derouIant
perte de vue », avec leurs « troupeaux de trois ou quatre mille buffles sau-
vages », errant a l'aventure; et ces plantes aux noms prestigieux le « cone
immobile » du magnolia, surmonte de ses larges roses blanches; le palmier
qui balance « ses eventails de verdure », le tulipier, les bignonias, les colo-
quintes, les alcees, etc...
ces notes exotiques sont inoubliables.
Chateaubriand ne retourna point en Amerique.
Il parait avoir prefers,
parvenu a la maturite, les sites du vieux monde, tout charges d'histoire.
Il
remarque bien, en contemplant dans les Florides des vestiges de la civi-
lisation indienne, « le contraste de ces ruines et de la jeunesse de la na-
ture ».
Mais visiblement l'histoire de ces races disparues lui est trop pen
familiere; it se sent davantage porte vers le pays latin, la Grece, la Terre
Sainte et l'Espagne.
Il a laisse de la campagne romaine - celle d'avant
Mussolini - un tableau immortel on l'artiste se double d'un poste et d'un
philosophe.
Le Co/isee lui a inspire une page celebre.
Rome a ete pour lui
comme pour tant d'autres, une seconde patrie.
II a vu avec des yeux avertis
Naples, son Vesuve et ses lazzaroni, Venise, ses palais et ses gondoliers.
Il a chants, dans une langue accordee a la « grecque beaute », Athenes
« dans toute sa gloire »; du haut de l'Acropole it .a vu « le soleil se lever
entre les deux times du mont Hymette...
» et les ailes noires et lustrees
des corneilles de la citadelle « glacees de rose par les premiers reflets du
jour »; it a visite le Parthenon, « ce temple qui a passe a juste titre pour
le chef-d'oeuvre de l'architecture chez les Anciens et chez les Modernes.
II a promene ses pas sur les rives de l'Eurotas, «ce fleuve qui vit errer
sur ses bords les Lacedemoniens illustres par Plutarque ».
11 a contemple
les ruines de Sparte ou « le soleil &yore incessamment le marbre des tom-
beaux ».
II a dormi sous ce ciel classique : « La nuit etait si pure et si
sereine que la voie lactee formait comme une aube reflechie par l'eau du
fleuve (l'Eurotas) et a la dart& de laquelle ou aurait pu lire.
»
Il a parcouru la Judee, « terre travaillee par les miracles » on « le desert
parait encore meet de terreur », n'ayant pas « ose rompre le silence depuis
qu'il a entendu la voix de l'Eternel ».
A peine a-t-il pu « distinguer de
l'arene de ses deux rives » le Jourdain, ce « fleuve jaune », profondement
encaisse et qui mule « avec lenteur une onde epaissie ».
La Mer Morte, ce « lac empeste », aux flots empoisonnes par les villes coupables ensevelies
dans son sein, l'a fortement impressionne.
« Ses abimes solitaires ne peu-
vent nourrir aucun etre vivant...
ses groves sont sans oiseaux, sans arbres,
sans verdure et son eau, d'une amertume aifreuse, est si pesante, que les
vents les plus impetueux peuvent a peine la soulever.
» II a medite devant
la vallee desolee de Josaphat, « cimetiere de Jerusalem » et lieu de l'ultime
jugement.
De la ville sainte, de in « cite &icicle », it brosse un tableau
qui peut decevoir le croyant, mais d'un puissant realisme.
La civilisation mauresque a exerts sur lui une strange seduction.
Sa
description de l'Alhambra, « cette habitation des genies », « sejour de la
puissance evanouie et des felicites passees est une pure merveille, encore
que tres sobre.
Il a soin de situer le palais dans son cadre de nature.
Ses
tours « brillent comme des etoiles au-dessus d'une verte fork »...
« De
legeres gaieties, des canaux de marbre blanc, hordes de citronniers et
d'orangers en fleur...
l'azur du plus beau ciel entre des colonnes qui sou-
tenaient une chaine d'arceaux gothiques...
les mars charges d'arabesques »
imitant « ces etoffes de l'Orient que brode dans l'ennui du harem une
femme esclave »...
font bien de ces lieux un « magique edifice ».
Tontes ces admirations palissent en face de l'enthousiasme passionne
qu'a souleve la Mer dans Fame de Rene.
La vue de l'Ocean, les traditions
familiales, les recits des vieux loups de mer malouins, ont contribue
developper en lui cet amour dominant.
Les rivages que baignent les flots
marins, les ports oil abordent les vaisseaux, l'immense plaine liquide, tout
l'interesse, tout excite ses instincts de voyageur, d'oiseau migrateur.
imaginables : l'écarlate fuyant sur le rouge, le jaune foncé sur For brillant, le brun ardent sur le brun léger, le vert, le blanc, l'azur, lavés en mille
teintes plus ou moins faibles, plus ou moins éclatantes.
» Ses clairs de lune sont justement fameux, et ses nuages, éclairés par «l'astre solitaire», se
déroulant « en zones diaphanes de satin blanc », en « légers flocons d'écume », en « bancs d'une ouate éblouissante ».
Le Meschacebé — un peu
arrangé — nous a tous fait rêver, avec ses « îles flottantes » et son « bison...
à la barbe antique et limoneuse ».
Les Lacs, les savanes, se «déroulant â perte de vue », avec leurs « troupeaux de trois ou quatre mille buffles sau vages », errant à l'aventure; et ces plantes aux noms prestigieux : le « cône immobile » du magnolia, surmonté de ses larges roses blanches; le palmier qui balance « ses éventails de verdure », le tulipier, les bignonias, les colo quintes, les alcées, etc..
ces notes exotiques sont inoubliables.
Chateaubriand ne retourna point en Amérique.
Il paraît avoir préféré, parvenu à la maturité, les sites du vieux monde, tout chargés d'histoire. Il remarque bien, en contemplant dans les Florides des vestiges de la civi lisation indienne, « le contraste de ces ruines et de la jeunesse de la na ture». Mais visiblement l'histoire de ces races disparues lui est trop peu
familière; il se sent davantage porté vers le pays latin, la Grèce, la Terre Sainte et Y Es pagne. Il a laissé de la campagne romaine — celle d'avant Mussolini — un tableau immortel où l'artiste se double d'un poète et d'un philosophe. Le Cotisée lui a inspiré une page célèbre.
Rome a été pour lui comme pour tant d'autres, une seconde patrie. Il a vu avec des yeux avertis
Naples, son Vésuve et ses lazzaroni, Venise, ses palais et ses gondoliers.
Il a chanté, dans une langue accordée à la « grecque beauté », Athènes
« dans toute sa gloire »; du haut de Y Acropole il a vu « le soleil se lever entre les deux cimes du mont Hymette... » et les ailes noires et lustrées des corneilles de la citadelle « glacées de rose par les premiers reflets du jour » ; il a visité le Parthénon, « ce temple qui a passé à juste titre pour
le chef-d'œuvre de l'architecture chez les Anciens et chez les Modernes. » Il a promené ses pas sur les rives de YEurotas, « ce fleuve qui vit errer sur ses bords les Lacédémoniens illustrés par Plutarque ».
Il a contemplé les ruines de Sparte où « le soleil dévore incessamment le marbre des tom
beaux ».
Il a dormi sous ce ciel classique : « La nuit était si pure et si sereine que la voie lactée formait comme une aube réfléchie par l'eau du fleuve (l'Eurotas) et à la clarté de laquelle ou aurait pu lire. » Il a parcouru la Judée, « terre travaillée par les miracles » où « le désert
paraît encore muet de terreur », n'ayant pas « osé rompre le silence depuis qu'il a entendu la voix de l'Eternel ».
A peine a-t-il pu « distinguer de
l'arène de ses deux rives » le Jourdain, ce « fleuve jaune », profondément
encaissé et qui roule « avec lenteur une onde épaissie ».
La Mer Morte, ce
«lac empesté», aux flots empoisonnés par les villes coupables ensevelies dans son sein, l'a fortement impressionné.
« Ses abîmes solitaires ne peu
vent nourrir aucun être vivant... ses grèves sont sans oiseaux, sans arbres,
sans verdure et son eau, d'une amertume affreuse, est si pesante, que les vents les plus impétueux peuvent à peine la soulever. » Il a médité devant la vallée désolée de Josaphat, « cimetière de Jérusalem » et lieu de l'ultime
jugement. De la ville sainte, de la « cité déicide », il brosse un tableau qui peut décevoir le croyant, mais d'un puissant réalisme.
La civilisation mauresque a exercé sur lui une étrange séduction.
Sa description de l'Alhambra, « cette habitation des génies », « séjour de la puissance évanouie et des félicités passées », est une pure merveille, encore que très sobre. Il a soin de situer le palais dans son cadre de nature. Ses tours « brillent comme des étoiles au-dessus d'une verte forêt »...
« De
légères galeries, des canaux de marbre blanc, bordés de citronniers et d'orangers en fleur...
l'azur du plus beau ciel entre des colonnes qui sou tenaient une chaîne d'arceaux gothiques... les murs chargés d'arabesques » imitant « ces étoffes de l'Orient que brode dans l'ennui du harem une femme esclave»... font bien de ces lieux un «magique édifice».
.
Toutes ces admirations pâlissent en face de l'enthousiasme passionné qu'a soulevé la Mer dans l'âme de René.
La vue de l'Océan, les traditions familiales, les récits des vieux loups de mer malouins, ont contribué à
développer en lui cet amour dominant. Les rivages que baignent les flots marins, les ports où abordent les vaisseaux, l'immense plaine liquide, tout l'intéresse, tout excite ses instincts de voyageur, d'oiseau migrateur..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- LE SENTIMENT DE LA NATURE CHEZ CHATEAUBRIAND
- D'après cette description de George Sand (au début de Valentine), vous direz quels sont certains des caractères essentiels de ses romans champêtres. Si vous ne connaissez pas ces romans. vous pourrez comparer le sentiment de la nature qui s'y exprime avec ce que vous connaissez du sentiment de la nature chez Rousseau, Chateaubriand, Lamartine, Victor Hugo ( en choisissant un ou plusieurs d'entre eux)
- Que pensez-vous de cette opinion d'un critique américain (Rice) : « Dans l'expression du sentiment de la nature, Rousseau n'est pas artiste, Chateaubriand le sera » ?
- LE SENTIMENT DE LA NATURE DANS CHATEAUBRIAND
- René (extrait) François-René de Chateaubriand La solitude absolue, le spectacle de la nature, me plongèrent bientôt dans un état presque impossible à décrire.