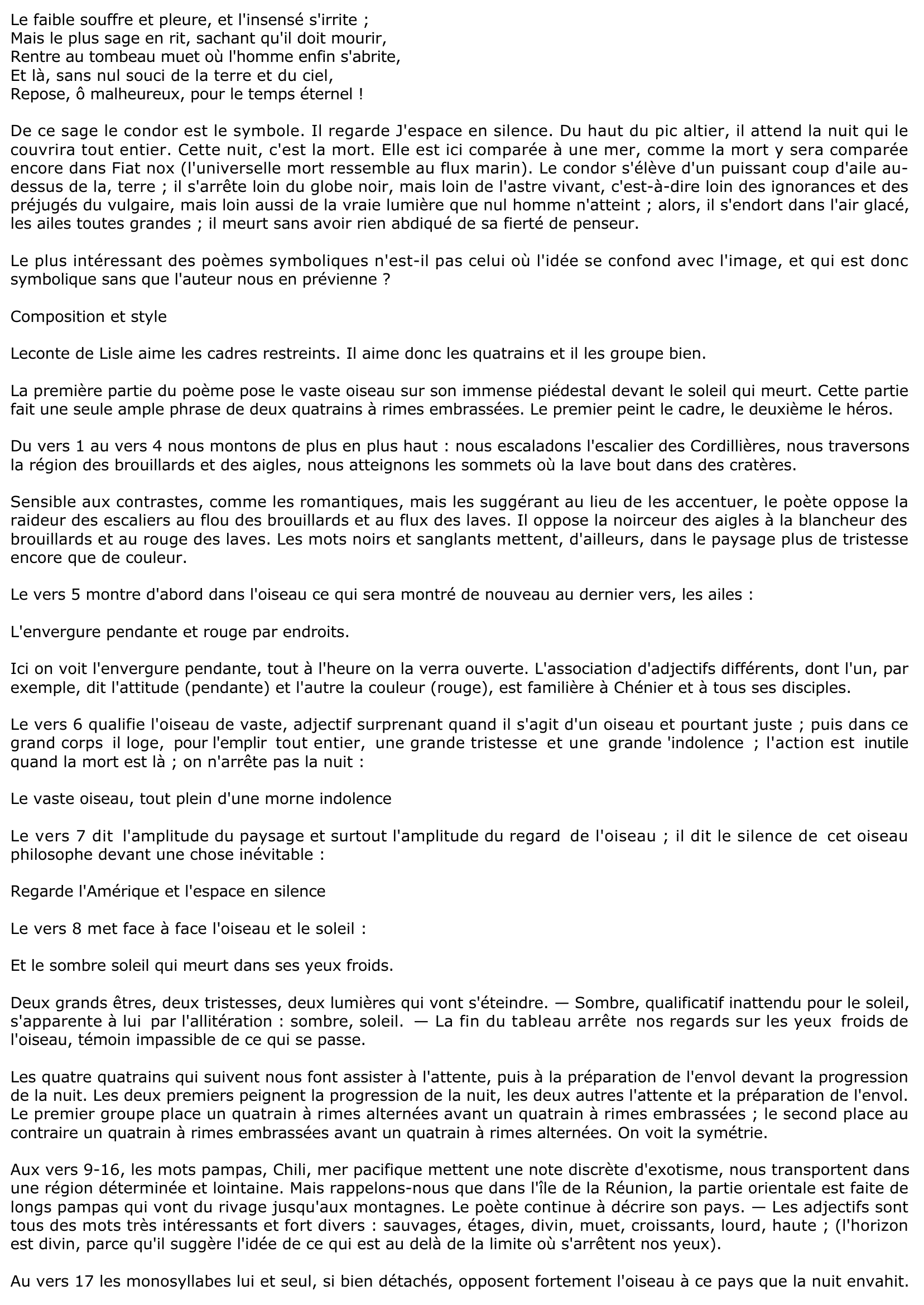LE SOMMEIL DU CONDOR de Leconte de Lisle
Publié le 04/03/2011

Extrait du document
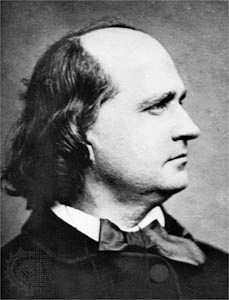
Date, Origine, Sens du poème Le Sommeil du Condor fut publié dans le recueil des Poésies nouvelles en 1858. Le même recueil contenait la Ravine Saint-Gilles et le Manchy, poèmes inspirés par les souvenirs de l'île natale. Et cette Coïncidence nous invite à chercher dans ces souvenirs une des origines de la pièce. Derrière la maison du poète s'élèvent des montagnes dont les sommets sont creusés en entonnoirs. Ce sont d'anciens volcans, qui parfois se réveillent. Ils dominent la cote occidentale de l'île. Le poète aimait à monter le soir sur l'un de ces monts.
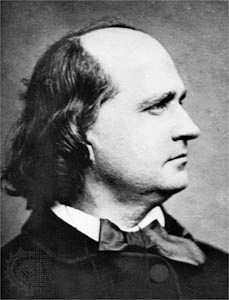
«
Le faible souffre et pleure, et l'insensé s'irrite ;Mais le plus sage en rit, sachant qu'il doit mourir,Rentre au tombeau muet où l'homme enfin s'abrite,Et là, sans nul souci de la terre et du ciel,Repose, ô malheureux, pour le temps éternel !
De ce sage le condor est le symbole.
Il regarde J'espace en silence.
Du haut du pic altier, il attend la nuit qui lecouvrira tout entier.
Cette nuit, c'est la mort.
Elle est ici comparée à une mer, comme la mort y sera comparéeencore dans Fiat nox (l'universelle mort ressemble au flux marin).
Le condor s'élève d'un puissant coup d'aile au-dessus de la, terre ; il s'arrête loin du globe noir, mais loin de l'astre vivant, c'est-à-dire loin des ignorances et despréjugés du vulgaire, mais loin aussi de la vraie lumière que nul homme n'atteint ; alors, il s'endort dans l'air glacé,les ailes toutes grandes ; il meurt sans avoir rien abdiqué de sa fierté de penseur.
Le plus intéressant des poèmes symboliques n'est-il pas celui où l'idée se confond avec l'image, et qui est doncsymbolique sans que l'auteur nous en prévienne ?
Composition et style
Leconte de Lisle aime les cadres restreints.
Il aime donc les quatrains et il les groupe bien.
La première partie du poème pose le vaste oiseau sur son immense piédestal devant le soleil qui meurt.
Cette partiefait une seule ample phrase de deux quatrains à rimes embrassées.
Le premier peint le cadre, le deuxième le héros.
Du vers 1 au vers 4 nous montons de plus en plus haut : nous escaladons l'escalier des Cordillières, nous traversonsla région des brouillards et des aigles, nous atteignons les sommets où la lave bout dans des cratères.
Sensible aux contrastes, comme les romantiques, mais les suggérant au lieu de les accentuer, le poète oppose laraideur des escaliers au flou des brouillards et au flux des laves.
Il oppose la noirceur des aigles à la blancheur desbrouillards et au rouge des laves.
Les mots noirs et sanglants mettent, d'ailleurs, dans le paysage plus de tristesseencore que de couleur.
Le vers 5 montre d'abord dans l'oiseau ce qui sera montré de nouveau au dernier vers, les ailes :
L'envergure pendante et rouge par endroits.
Ici on voit l'envergure pendante, tout à l'heure on la verra ouverte.
L'association d'adjectifs différents, dont l'un, parexemple, dit l'attitude (pendante) et l'autre la couleur (rouge), est familière à Chénier et à tous ses disciples.
Le vers 6 qualifie l'oiseau de vaste, adjectif surprenant quand il s'agit d'un oiseau et pourtant juste ; puis dans cegrand corps il loge, pour l'emplir tout entier, une grande tristesse et une grande 'indolence ; l'action est inutilequand la mort est là ; on n'arrête pas la nuit :
Le vaste oiseau, tout plein d'une morne indolence
Le vers 7 dit l'amplitude du paysage et surtout l'amplitude du regard de l'oiseau ; il dit le silence de cet oiseauphilosophe devant une chose inévitable :
Regarde l'Amérique et l'espace en silence
Le vers 8 met face à face l'oiseau et le soleil :
Et le sombre soleil qui meurt dans ses yeux froids.
Deux grands êtres, deux tristesses, deux lumières qui vont s'éteindre.
— Sombre, qualificatif inattendu pour le soleil,s'apparente à lui par l'allitération : sombre, soleil.
— La fin du tableau arrête nos regards sur les yeux froids del'oiseau, témoin impassible de ce qui se passe.
Les quatre quatrains qui suivent nous font assister à l'attente, puis à la préparation de l'envol devant la progressionde la nuit.
Les deux premiers peignent la progression de la nuit, les deux autres l'attente et la préparation de l'envol.Le premier groupe place un quatrain à rimes alternées avant un quatrain à rimes embrassées ; le second place aucontraire un quatrain à rimes embrassées avant un quatrain à rimes alternées.
On voit la symétrie.
Aux vers 9-16, les mots pampas, Chili, mer pacifique mettent une note discrète d'exotisme, nous transportent dansune région déterminée et lointaine.
Mais rappelons-nous que dans l'île de la Réunion, la partie orientale est faite delongs pampas qui vont du rivage jusqu'aux montagnes.
Le poète continue à décrire son pays.
— Les adjectifs sonttous des mots très intéressants et fort divers : sauvages, étages, divin, muet, croissants, lourd, haute ; (l'horizonest divin, parce qu'il suggère l'idée de ce qui est au delà de la limite où s'arrêtent nos yeux).
Au vers 17 les monosyllabes lui et seul, si bien détachés, opposent fortement l'oiseau à ce pays que la nuit envahit..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Le sommeil du condor (Leconte de Lisle).
- DERNIERS POÈMES de Leconte de Lisle. (résumé & analyse)
- POÈMES BARBARES de Charles-Marie-René Leconte de Lisle (résumé)
- POÈMES ANTIQUES, recueil de Leconte de Lisle
- POÈMES BARBARES de Leconte de Lisle : Fiche de lecture