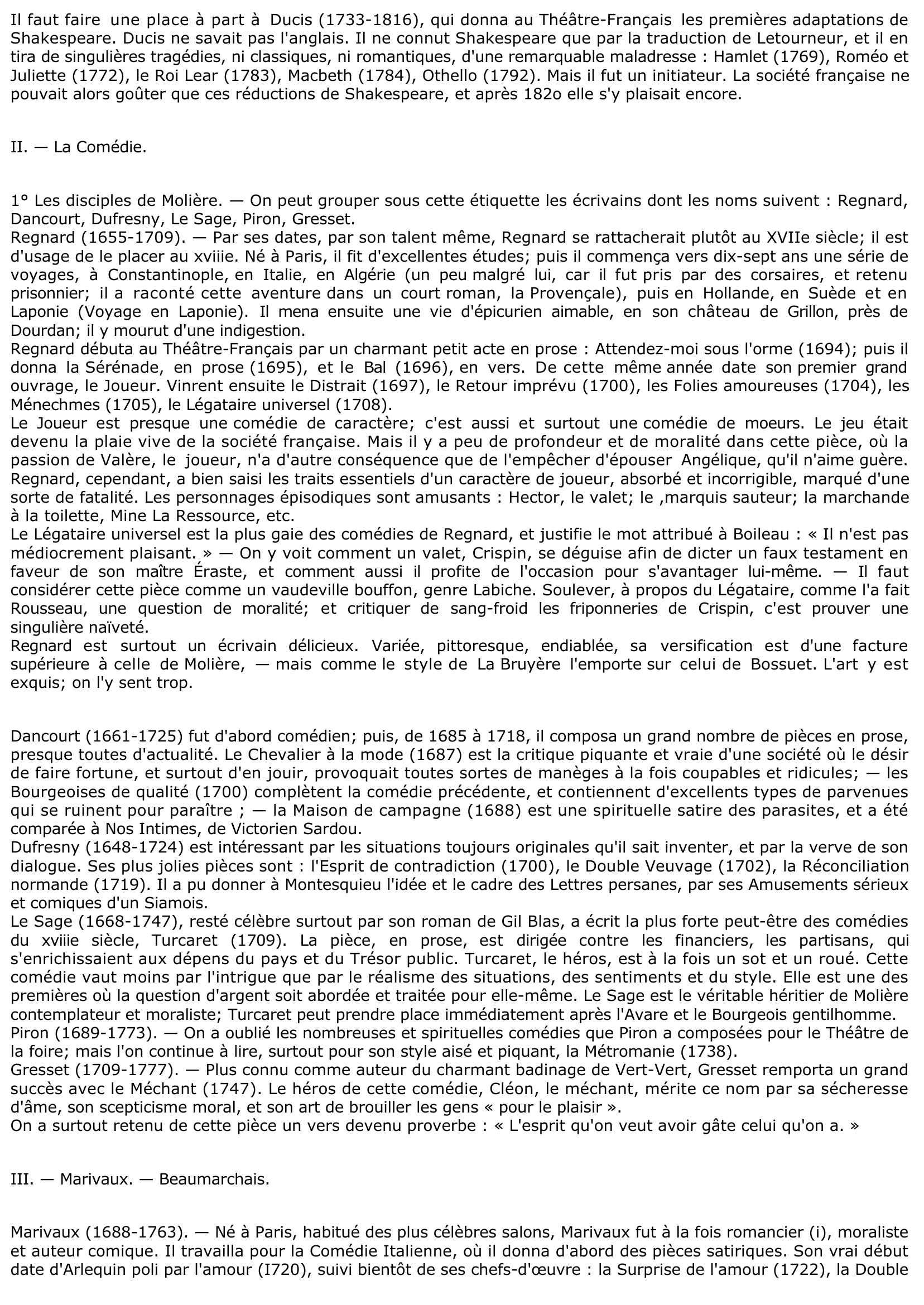LE THÉATRE AU DIX-HUITIÈME SIÈCLE. LA TRAGÉDIE. — LA COMÉDIE. — LE DRAME.
Publié le 20/05/2011

Extrait du document
I. — La Tragédie.
Crébillon (1675-176z). — On attribue à Crébillon ce mot : « Corneille a pris la terre; Racine, le ciel; il me reste l'enfer. « Son but est d'exciter non plus l'admiration ou la pitié, mais la terreur. Et son tort est de chercher à y parvenir au moyen d'artifices plus romanesques et plus mélodramatiques que vraiment tragiques. Ses principales pièces sont Atrée et Thyeste (1707), Électre (1708), Rhadamiste et Zénobie (1711), où l'on trouve une très belle scène de reconnaissance. Crébillon a vraiment le sens de l'horreur tragique. Les situations sont d'une grandeur farouche, qui rappelle le cinquième acte de Rodogune. Son style, souvent lourd et obscur, est remarquable par sa fermeté et par sa violence.
Voltaire. — De 1718 à 1778, Voltaire ne cesse, à travers les occupations et les vicissitudes d'une existence fiévreuse, de composer des tragédies et même des comédies. Son oeuvre dramatique, très considérable, l'a fait placer par ses contemporains tout à côté de Corneille et de Racine. Aujourd'hui, les tragédies de Voltaire sont trop sévèrement jugées, sinon par les critiques, du moins par le public, qui ne supporte plus guère que Zaïre.
«
Il faut faire une place à part à Ducis (1733-1816), qui donna au Théâtre-Français les premières adaptations deShakespeare.
Ducis ne savait pas l'anglais.
Il ne connut Shakespeare que par la traduction de Letourneur, et il entira de singulières tragédies, ni classiques, ni romantiques, d'une remarquable maladresse : Hamlet (1769), Roméo etJuliette (1772), le Roi Lear (1783), Macbeth (1784), Othello (1792).
Mais il fut un initiateur.
La société française nepouvait alors goûter que ces réductions de Shakespeare, et après 182o elle s'y plaisait encore.
II.
— La Comédie.
1° Les disciples de Molière.
— On peut grouper sous cette étiquette les écrivains dont les noms suivent : Regnard,Dancourt, Dufresny, Le Sage, Piron, Gresset.Regnard (1655-1709).
— Par ses dates, par son talent même, Regnard se rattacherait plutôt au XVIIe siècle; il estd'usage de le placer au xviiie.
Né à Paris, il fit d'excellentes études; puis il commença vers dix-sept ans une série devoyages, à Constantinople, en Italie, en Algérie (un peu malgré lui, car il fut pris par des corsaires, et retenuprisonnier; il a raconté cette aventure dans un court roman, la Provençale), puis en Hollande, en Suède et enLaponie (Voyage en Laponie).
Il mena ensuite une vie d'épicurien aimable, en son château de Grillon, près deDourdan; il y mourut d'une indigestion.Regnard débuta au Théâtre-Français par un charmant petit acte en prose : Attendez-moi sous l'orme (1694); puis ildonna la Sérénade, en prose (1695), et le Bal (1696), en vers.
De cette même année date son premier grandouvrage, le Joueur.
Vinrent ensuite le Distrait (1697), le Retour imprévu (1700), les Folies amoureuses (1704), lesMénechmes (1705), le Légataire universel (1708).Le Joueur est presque une comédie de caractère; c'est aussi et surtout une comédie de moeurs.
Le jeu étaitdevenu la plaie vive de la société française.
Mais il y a peu de profondeur et de moralité dans cette pièce, où lapassion de Valère, le joueur, n'a d'autre conséquence que de l'empêcher d'épouser Angélique, qu'il n'aime guère.Regnard, cependant, a bien saisi les traits essentiels d'un caractère de joueur, absorbé et incorrigible, marqué d'unesorte de fatalité.
Les personnages épisodiques sont amusants : Hector, le valet; le ,marquis sauteur; la marchandeà la toilette, Mine La Ressource, etc.Le Légataire universel est la plus gaie des comédies de Regnard, et justifie le mot attribué à Boileau : « Il n'est pasmédiocrement plaisant.
» — On y voit comment un valet, Crispin, se déguise afin de dicter un faux testament enfaveur de son maître Éraste, et comment aussi il profite de l'occasion pour s'avantager lui-même.
— Il fautconsidérer cette pièce comme un vaudeville bouffon, genre Labiche.
Soulever, à propos du Légataire, comme l'a faitRousseau, une question de moralité; et critiquer de sang-froid les friponneries de Crispin, c'est prouver unesingulière naïveté.Regnard est surtout un écrivain délicieux.
Variée, pittoresque, endiablée, sa versification est d'une facturesupérieure à celle de Molière, — mais comme le style de La Bruyère l'emporte sur celui de Bossuet.
L'art y estexquis; on l'y sent trop.
Dancourt (1661-1725) fut d'abord comédien; puis, de 1685 à 1718, il composa un grand nombre de pièces en prose,presque toutes d'actualité.
Le Chevalier à la mode (1687) est la critique piquante et vraie d'une société où le désirde faire fortune, et surtout d'en jouir, provoquait toutes sortes de manèges à la fois coupables et ridicules; — lesBourgeoises de qualité (1700) complètent la comédie précédente, et contiennent d'excellents types de parvenuesqui se ruinent pour paraître ; — la Maison de campagne (1688) est une spirituelle satire des parasites, et a étécomparée à Nos Intimes, de Victorien Sardou.Dufresny (1648-1724) est intéressant par les situations toujours originales qu'il sait inventer, et par la verve de sondialogue.
Ses plus jolies pièces sont : l'Esprit de contradiction (1700), le Double Veuvage (1702), la Réconciliationnormande (1719).
Il a pu donner à Montesquieu l'idée et le cadre des Lettres persanes, par ses Amusements sérieuxet comiques d'un Siamois.Le Sage (1668-1747), resté célèbre surtout par son roman de Gil Blas, a écrit la plus forte peut-être des comédiesdu xviiie siècle, Turcaret (1709).
La pièce, en prose, est dirigée contre les financiers, les partisans, quis'enrichissaient aux dépens du pays et du Trésor public.
Turcaret, le héros, est à la fois un sot et un roué.
Cettecomédie vaut moins par l'intrigue que par le réalisme des situations, des sentiments et du style.
Elle est une despremières où la question d'argent soit abordée et traitée pour elle-même.
Le Sage est le véritable héritier de Molièrecontemplateur et moraliste; Turcaret peut prendre place immédiatement après l'Avare et le Bourgeois gentilhomme.Piron (1689-1773).
— On a oublié les nombreuses et spirituelles comédies que Piron a composées pour le Théâtre dela foire; mais l'on continue à lire, surtout pour son style aisé et piquant, la Métromanie (1738).Gresset (1709-1777).
— Plus connu comme auteur du charmant badinage de Vert-Vert, Gresset remporta un grandsuccès avec le Méchant (1747).
Le héros de cette comédie, Cléon, le méchant, mérite ce nom par sa sécheressed'âme, son scepticisme moral, et son art de brouiller les gens « pour le plaisir ».On a surtout retenu de cette pièce un vers devenu proverbe : « L'esprit qu'on veut avoir gâte celui qu'on a.
»
III.
— Marivaux.
— Beaumarchais.
Marivaux (1688-1763).
— Né à Paris, habitué des plus célèbres salons, Marivaux fut à la fois romancier (i), moralisteet auteur comique.
Il travailla pour la Comédie Italienne, où il donna d'abord des pièces satiriques.
Son vrai débutdate d'Arlequin poli par l'amour (I720), suivi bientôt de ses chefs-d'œuvre : la Surprise de l'amour (1722), la Double.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Dissertation Introduction : La comédie et la tragédie connurent un grand succès au XVIIe siècle.
- L'auteur anglais Horace Walpole (XVIIIe siècle) a écrit: « Le monde est une comédie pour celui qui pense et une tragédie pour celui qui sent. » En prenant des exemples aussi bien dans votre expérience personnelle que chez les écrivains ou artistes que vous connaissez, vous expliquerez et illustrerez cette opposition entre raison et sensibilité, et vous donnerez votre opinion sur la question.
- COMÉDIE ET DRAME AU XVIIIe siècle
- LE THÉATRE AU XVIIIe SIÈCLE: La Tragédie: Crébillon, Voltaire
- Expliquer cette pensée de Beaumarchais (Préface du Barbier de Séville) : « Un vieillard amoureux prétend épouser demain sa pupille ; un jeune amant plus adroit le prévient, et ce jour même en fait sa femme à la barbe et dans la maison du tuteur. Voilà le fond, dont on eût pu faire9 avec un égal succès, une tragédie, une comédie, un drame, un opéra, etc. L'Avare de Molière est-il autre chose? Le grand Mithridate est-il autre chose? Le genre d'une pièce, comme celui de toute autre action