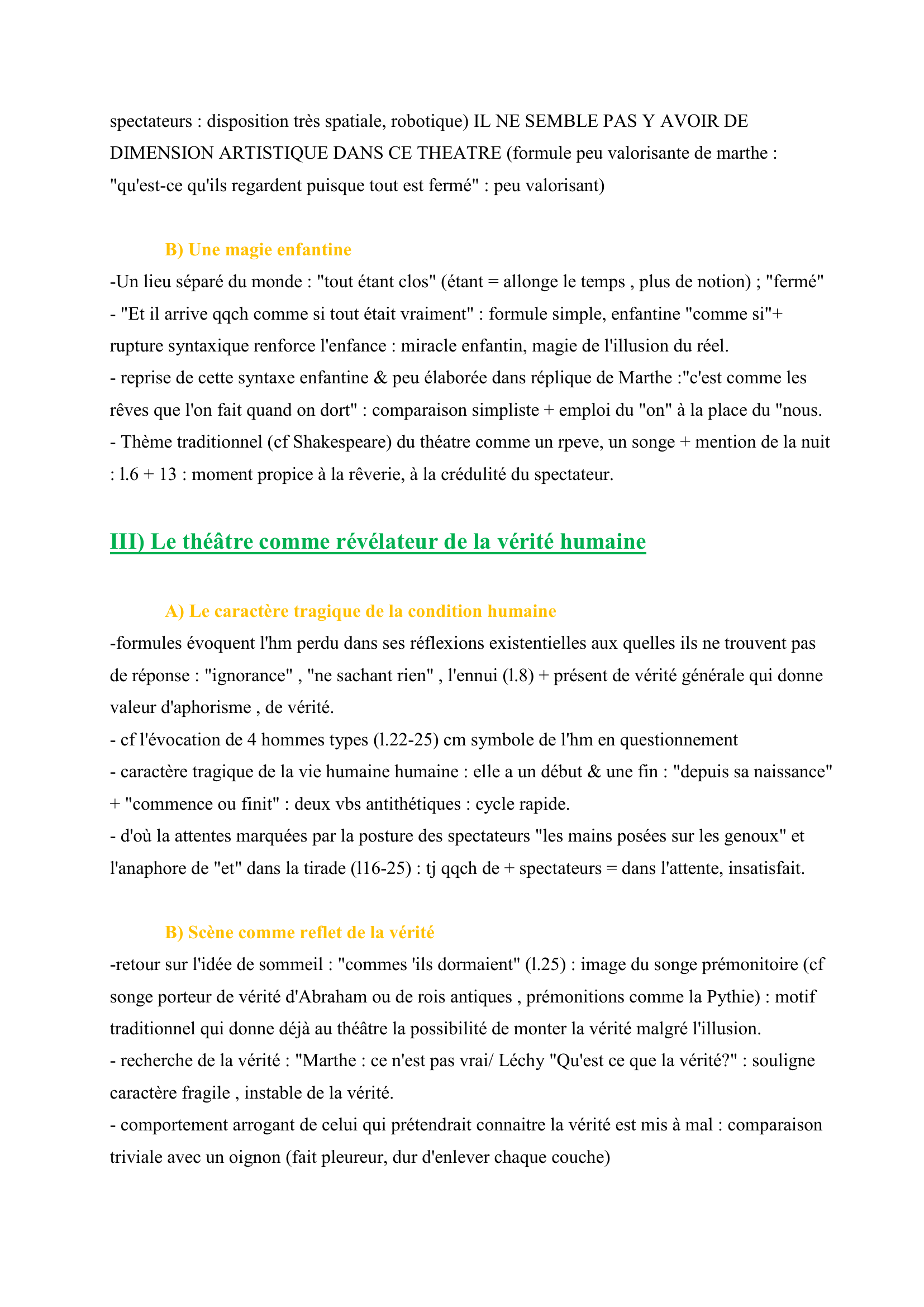L'ECHANGE , PAUL CLAUDEL
Publié le 24/06/2012

Extrait du document

I) Une actrice parle des spectateurs
A) Un mépris apparent
-déf. des spectateurs cm des moutons : "assis les uns derrière les autres par rangées"l.6 : docilité "sagesse"
-"ils regardent le rideau" (pas la scène) : pas de réflxion, leur regard est le même pour tous + "regardant" : pas de complément, construction absolue qui renforce , impersonnel
- tirade l.15 à 25 dépréciative & négative : vision de masse, foule, absence d'idées autonomes & d'intelligence "chair vivante et habillée" ; "des mouches" + restriction "la salle n'est que (dépreciatif)
B) Perso de l'actrice .. et une définition du métier d'acteur
-perso assez imbu d'elle-m "je connais le monde" + "je" très présent+ effet de son nom composé "lechy" : ladie , noblesse ?
- intéressant : réciprocité des regards entre scène & salle : "je les regarde"l.5 : perspective

«
spectateurs : disposition très spatiale, robotique) IL NE SEMBLE PAS Y AVOIR DE
DIMENSION ARTISTIQUE DANS CE THEATRE (formule peu valorisante de marthe :
"qu'est-ce qu'ils regardent puisque tout est fermé" : peu valorisant)
B) Une magie enfantine
-Un lieu séparé du monde : "tout é tant clos" (étant = allonge le temps , plus de notion) ; "fermé"
- "Et il arrive qqch comme si tout était vraiment" : formule simple, enfantine "comme si"+
rupture syntaxique renforce l'enfance : miracle enfantin, magie de l'illusion du réel.
- reprise de cette syntaxe enfantine & peu élaborée dans réplique de Marthe :"c'est comme les
rêves que l'on fait quand on dort" : comparaison simpliste + emploi du "on" à la place du "nous.
- Thème traditionnel (cf Shakespeare) du théatre comme un rpeve, un songe + me ntion de la nuit
: l.6 + 13 : moment propice à la rêverie, à la crédulité du spectateur.
III) Le théâtre comme révélateur de la vérité humaine
A) Le caractère tragique de la condition humaine
-formules évoquent l'hm perdu dans ses réflexions existentielles aux quelles ils ne trouvent pas
de réponse : "ignorance" , "ne sachant rien" , l'ennui (l.8) + présent de vérité générale qui donne
valeur d'aphorisme , de vérité.
- cf l'évocation de 4 homm es types (l.22-25) cm symbole de l'hm en questionnement
- caractère tragique de la vie humaine humaine : elle a un début & une fin : "depuis sa naissance"
+ "commence ou finit" : deux vbs antithétiques : cycle rapide.
- d'où la attentes marquées par la pos ture des spectateurs "les mains posées sur les genoux" et
l'anaphore de "et" dans la tirade (l16 -25) : tj qqch de + spectateurs = dans l'attente, insatisfait.
B) Scène comme reflet de la vérité
-retour sur l'idée de sommeil : "commes 'ils dormaient" (l.2 5) : image du songe prémonitoire (cf
songe porteur de vérité d'Abraham ou de rois antiques , prémonitions comme la Pythie) : motif
traditionnel qui donne déjà au théâtre la possibilité de monter la vérité malgré l'illusion.
- recherche de la vérité : "Mar the : ce n'est pas vrai/ Léchy "Qu'est ce que la vérité?" : souligne
caractère fragile , instable de la vérité.
- comportement arrogant de celui qui prétendrait connaitre la vérité est mis à mal : comparaison
triviale avec un oignon (fait pleureur, dur d'e nlever chaque couche).
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- L’Echange de Paul Claudel (analyse détaillée)
- L'Echange De Paul Claudel ( Commentaire Composé)
- ÉCHANGE (L’) de Paul Claudel (résumé & analyse)
- LA VILLE de Paul Claudel : Fiche de lecture
- TÊTE D'OR de Paul Claudel (résumé et analyse de l'oeuvre)