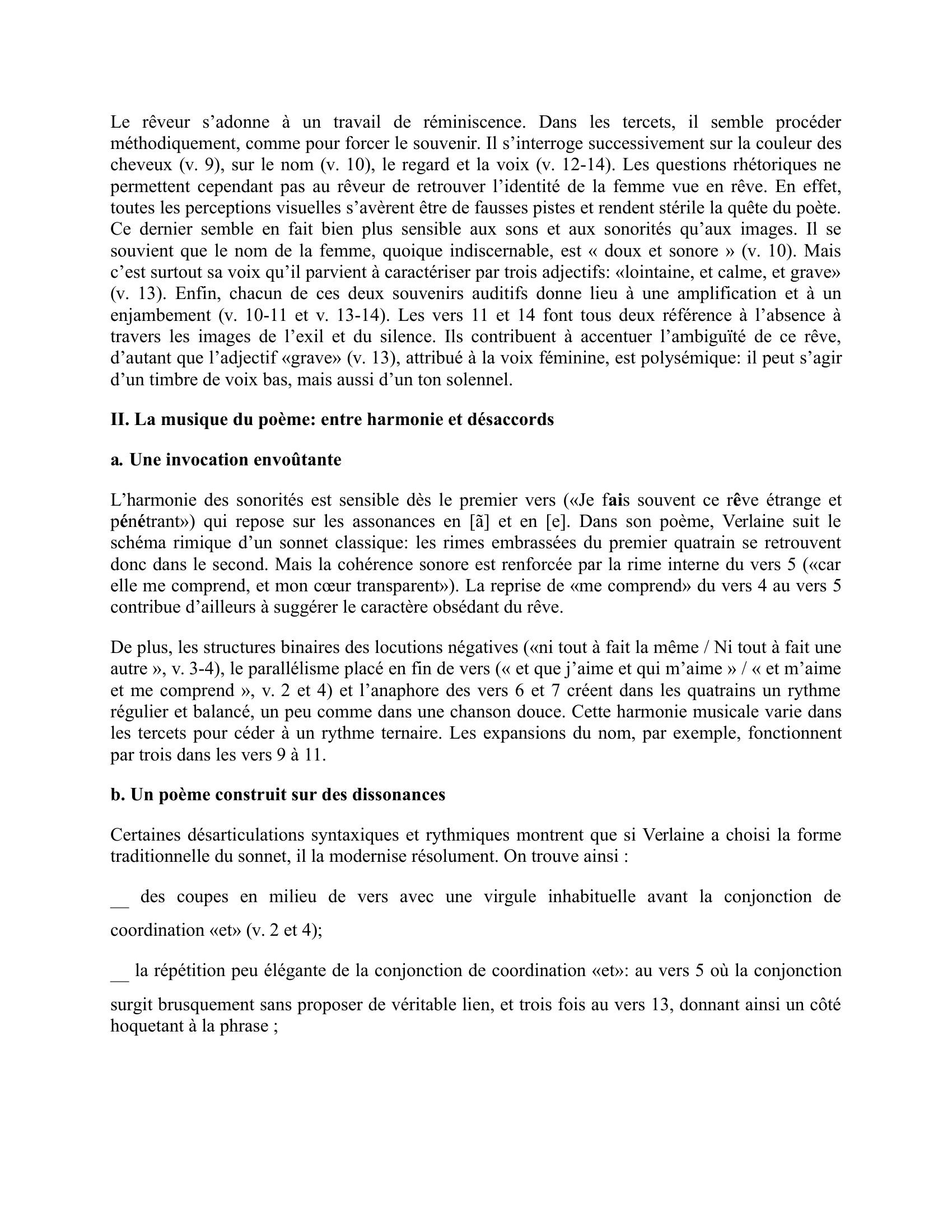lecture analytique
Publié le 16/05/2015

Extrait du document
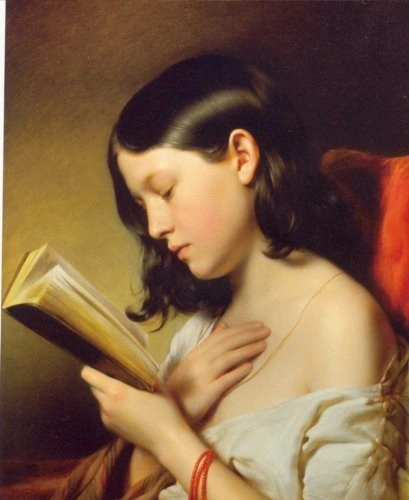
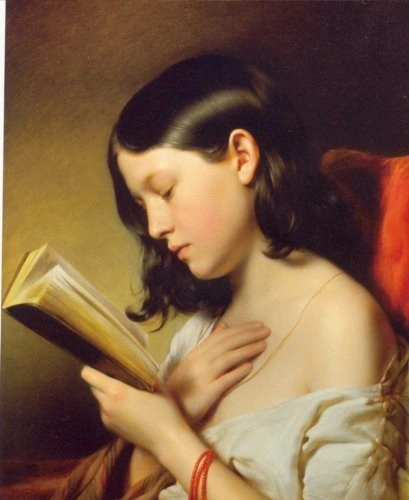
«
Le rêveur s’adonne à un travail de réminiscence.
Dans les tercets, il semble procéder
méthodiquement, comme pour forcer le souvenir.
Il s’interroge successivement sur la couleur des
cheveux (v.
9), sur le nom (v.
10), le regard et la voix (v.
12-14).
Les questions rhétoriques ne
permettent cependant pas au rêveur de retrouver l’identité de la femme vue en rêve.
En effet,
toutes les perceptions visuelles s’avèrent être de fausses pistes et rendent stérile la quête du poète.
Ce dernier semble en fait bien plus sensible aux sons et aux sonorités qu’aux images.
Il se
souvient que le nom de la femme, quoique indiscernable, est « doux et sonore » (v.
10).
Mais
c’est surtout sa voix qu’il parvient à caractériser par trois adjectifs: «lointaine, et calme, et grave»
(v.
13).
Enfin, chacun de ces deux souvenirs auditifs donne lieu à une amplification et à un
enjambement (v.
10-11 et v.
13-14).
Les vers 11 et 14 font tous deux référence à l’absence à
travers les images de l’exil et du silence.
Ils contribuent à accentuer l’ambiguïté de ce rêve,
d’autant que l’adjectif «grave» (v.
13), attribué à la voix féminine, est polysémique: il peut s’agir
d’un timbre de voix bas, mais aussi d’un ton solennel.
II.
La musique du poème: entre harmonie et désaccords
a .
Une invocation envoûtante
L’harmonie des sonorités est sensible dès le premier vers («Je f ai s souvent ce r ê ve étrange et
p é n é trant») qui repose sur les assonances en [ã] et en [e].
Dans son poème, Verlaine suit le
schéma rimique d’un sonnet classique: les rimes embrassées du premier quatrain se retrouvent
donc dans le second.
Mais la cohérence sonore est renforcée par la rime interne du vers 5 («car
elle me comprend, et mon cœur transparent»).
La reprise de «me comprend» du vers 4 au vers 5
contribue d’ailleurs à suggérer le caractère obsédant du rêve.
De plus, les structures binaires des locutions négatives («ni tout à fait la même / Ni tout à fait une
autre », v.
3-4), le parallélisme placé en fin de vers (« et que j’aime et qui m’aime » / « et m’aime
et me comprend », v.
2 et 4) et l’anaphore des vers 6 et 7 créent dans les quatrains un rythme
régulier et balancé, un peu comme dans une chanson douce.
Cette harmonie musicale varie dans
les tercets pour céder à un rythme ternaire.
Les expansions du nom, par exemple, fonctionnent
par trois dans les vers 9 à 11.
b.
Un poème construit sur des dissonances
Certaines désarticulations syntaxiques et rythmiques montrent que si Verlaine a choisi la forme
traditionnelle du sonnet, il la modernise résolument.
On trouve ainsi :
— des coupes en milieu de vers avec une virgule inhabituelle avant la conjonction de
coordination «et» (v.
2 et 4);
— la répétition peu élégante de la conjonction de coordination «et»: au vers 5 où la conjonction
surgit brusquement sans proposer de véritable lien, et trois fois au vers 13, donnant ainsi un côté
hoquetant à la phrase ;.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Lecture Analytique 2 : Vénus anadyomène : Arthur Rimbaud
- La Princesse de Clèves lecture analytique
- lecture analytique les fausses confidences
- "Le loup et l'agneau" de La Fontaine lecture analytique
- Lecture analytique