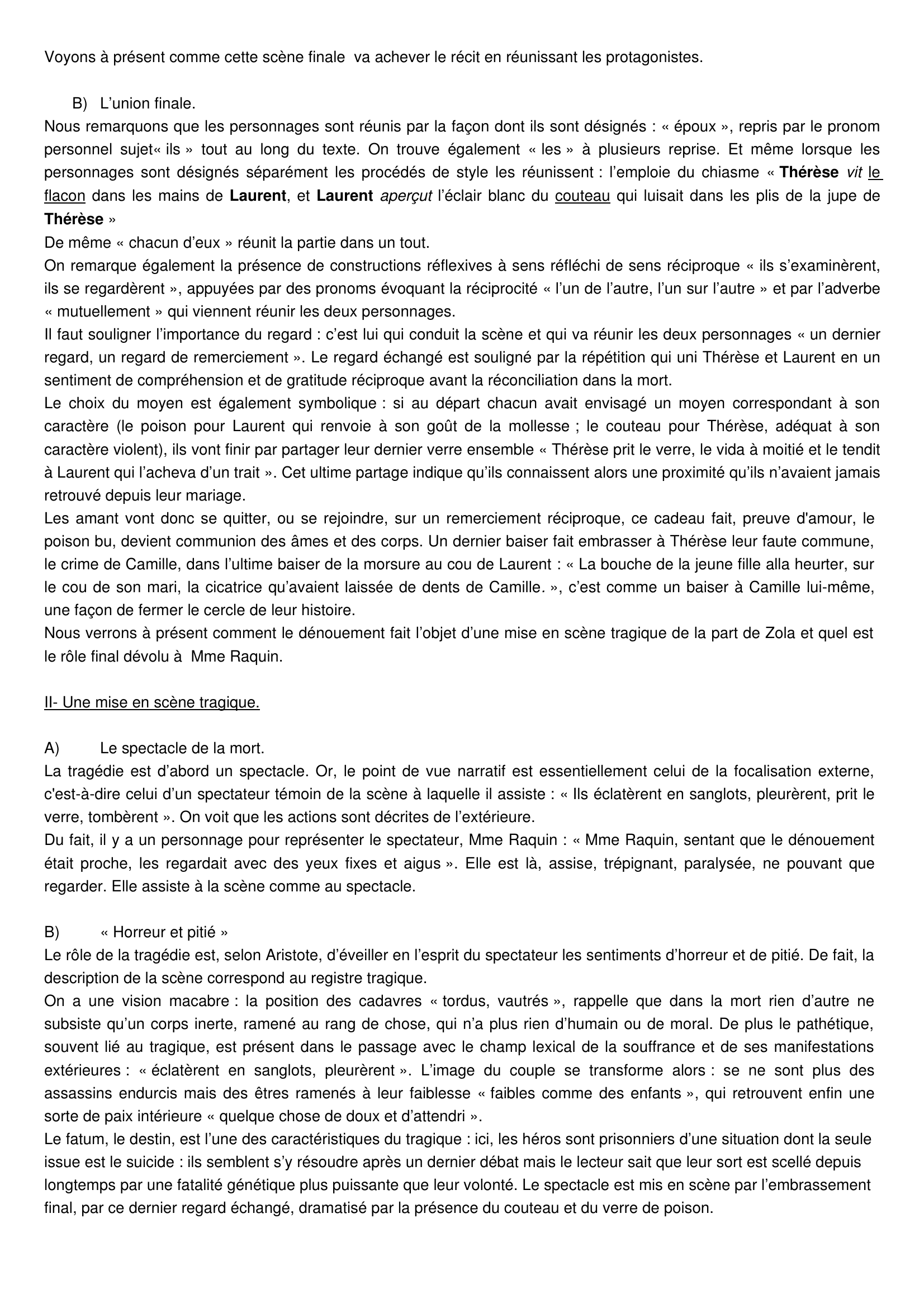Lecture analytique du dénouement de Thérèse Raquin
Publié le 05/06/2013

Extrait du document
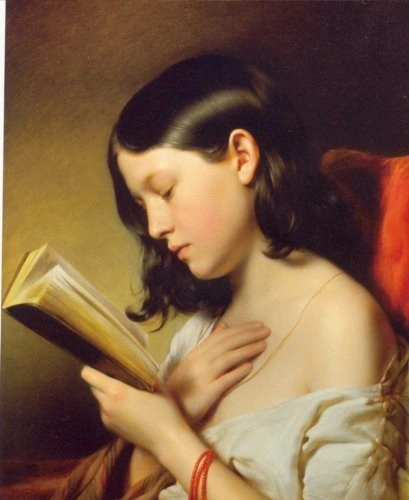
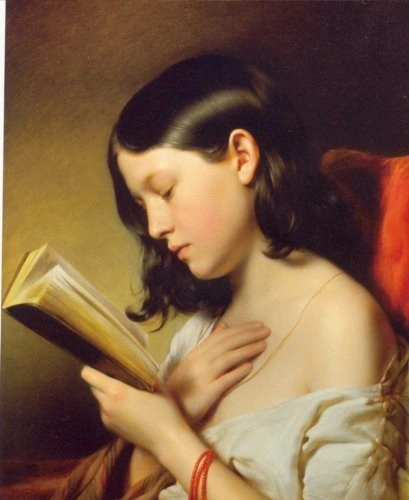
«
Voyons à pr ésent comme cette sc ène finale va achever le r écit en r éunissant les protagonistes.
B) L’union finale.
Nous remarquons que les personnages sont r
éunis par la fa çon dont ils sont d ésign és : « é poux », repris par le pronom
personnel sujet« ils » tout au long du texte.
On trouve
également « les » à plusieurs reprise.
Et m ême lorsque les
personnages sont d
ésign és s épar ément les proc édés de style les r éunissent : l’emploie du chiasme « Th érèse vit le
flacon dans les mains de Laurent , et Laurent aper
çut l’ éclair blanc du couteau qui luisait dans les plis de la jupe de
Th
érèse »
De m
ême « chacun d’eux » r éunit la partie dans un tout.
On remarque
également la pr ésence de constructions r éflexives à sens r éfléchi de sens r éciproque « ils s’examin èrent,
ils se regard
èrent », appuy ées par des pronoms évoquant la r éciprocit é « l’un de l’autre, l’un sur l’autre » et par l’adverbe
« mutuellement » qui viennent r
éunir les deux personnages.
Il faut souligner l’importance du regard : c’est lui qui conduit la sc
ène et qui va r éunir les deux personnages « un dernier
regard, un regard de remerciement ». Le regard
échang é est soulign é par la r épétition qui uni Th érèse et Laurent en un
sentiment de compr
éhension et de gratitude r éciproque avant la r éconciliation dans la mort.
Le choix du moyen est
également symbolique : si au d épart chacun avait envisag é un moyen correspondant à son
caract
ère (le poison pour Laurent qui renvoie à son go ût de la mollesse ; le couteau pour Th érèse, ad équat à son
caract
ère violent), ils vont finir par partager leur dernier verre ensemble « Th érèse prit le verre, le vida à moiti é et le tendit
à
Laurent qui l’acheva d’un trait ». Cet ultime partage indique qu’ils connaissent alors une proximit é qu’ils n’avaient jamais
retrouv
é depuis leur mariage.
Les amant vont donc se quitter, ou se rejoindre, sur un remerciement r
éciproque, ce cadeau fait, preuve d'amour, le
poison bu, devient communion des
âmes et des corps. Un dernier baiser fait embrasser à Th érèse leur faute commune,
le crime de Camille, dans l’ultime baiser de la morsure au cou de Laurent : « La bouche de la jeune fille alla heurter, sur
le cou de son mari, la cicatrice qu’avaient laiss
ée de dents de Camille .
», c’est comme un baiser à Camille luim ême,
une fa
çon de fermer le cercle de leur histoire.
Nous verrons
à pr ésent comment le d énouement fait l’objet d’une mise en sc ène tragique de la part de Zola et quel est
le r
ôle final d évolu à Mme Raquin.
II Une mise en sc
ène tragique.
A) Le spectacle de la mort.
La trag
édie est d’abord un spectacle.
Or, le point de vue narratif est essentiellement celui de la focalisation externe,
c'est
àdire celui d’un spectateur t émoin de la sc ène à laquelle il assiste : « Ils éclat èrent en sanglots, pleur èrent, prit le
verre, tomb
èrent ». On voit que les actions sont d écrites de l’ext érieure.
Du fait, il y a un personnage pour repr
ésenter le spectateur, Mme Raquin : « Mme Raquin, sentant que le d énouement
é
tait proche, les regardait avec des yeux fixes et aigus ».
Elle est l à, assise, tr épignant, paralys ée, ne pouvant que
regarder. Elle assiste
à la sc ène comme au spectacle.
B) « Horreur et piti
é »
Le r
ôle de la trag édie est, selon Aristote, d’ éveiller en l’esprit du spectateur les sentiments d’horreur et de piti é. De fait, la
description de la sc
ène correspond au registre tragique.
On a une vision macabre : la position des cadavres « tordus, vautr
és », rappelle que dans la mort rien d’autre ne
subsiste qu’un corps inerte, ramen
é au rang de chose, qui n’a plus rien d’humain ou de moral. De plus le path étique,
souvent li
é au tragique, est pr ésent dans le passage avec le champ lexical de la souffrance et de ses manifestations
ext
érieures : « é clat èrent en sanglots, pleur èrent ».
L’image du couple se transforme alors : se ne sont plus des
assassins endurcis mais des
êtres ramen és à leur faiblesse « faibles comme des enfants », qui retrouvent enfin une
sorte de paix int
érieure « quelque chose de doux et d’attendri ».
Le fatum, le destin, est l’une des caract
éristiques du tragique : ici, les h éros sont prisonniers d’une situation dont la seule
issue est le suicide : ils semblent s’y r
ésoudre apr ès un dernier d ébat mais le lecteur sait que leur sort est scell é depuis
longtemps par une fatalit
é génétique plus puissante que leur volont é. Le spectacle est mis en sc ène par l’embrassement
final, par ce dernier regard
échang é, dramatis é par la pr ésence du couteau et du verre de poison..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Fiche lecture: Thérèse Raquin Biographie Émile Zola (18401902) est un écrivain, critique littéraire et journaliste français, considéré comme le chef de file du naturalisme.
- Fiche de lecture - Thérèse Raquin de Zola
- Commentaire composé sur le dénouement de Thérèse Raquin
- Thérèse Raquin - Fiche de lecture
- Fiche de lecture : Thérèse Raquin, Émile Zola