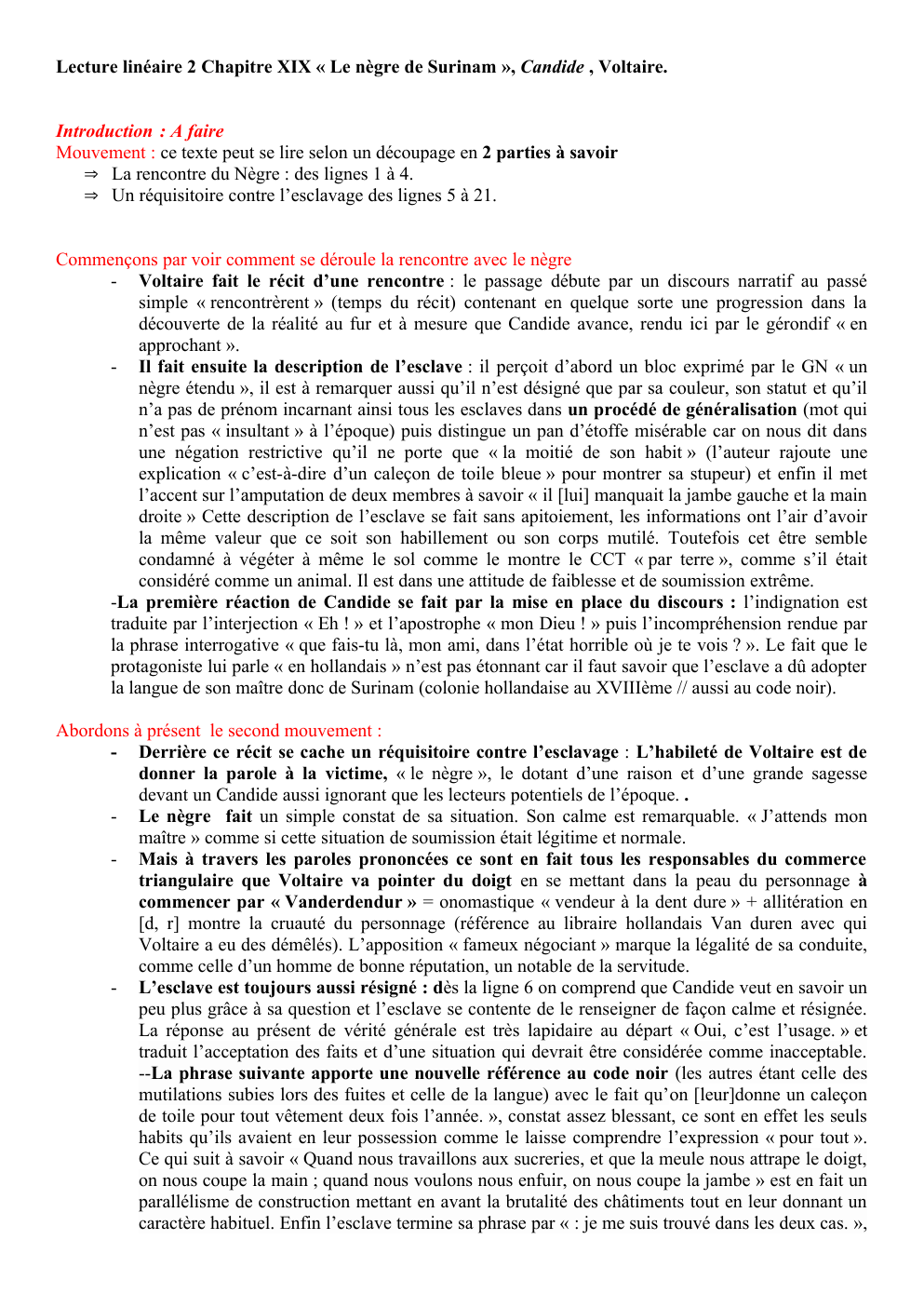Lecture linéaire 2 Chapitre XIX « Le nègre de Surinam », Candide , Voltaire.
Publié le 19/01/2023
Extrait du document
«
Lecture linéaire 2 Chapitre XIX « Le nègre de Surinam », Candide , Voltaire.
Introduction : A faire
Mouvement : ce texte peut se lire selon un découpage en 2 parties à savoir
La rencontre du Nègre : des lignes 1 à 4.
Un réquisitoire contre l’esclavage des lignes 5 à 21.
Commençons par voir comment se déroule la rencontre avec le nègre
- Voltaire fait le récit d’une rencontre : le passage débute par un discours narratif au passé
simple « rencontrèrent » (temps du récit) contenant en quelque sorte une progression dans la
découverte de la réalité au fur et à mesure que Candide avance, rendu ici par le gérondif « en
approchant ».
- Il fait ensuite la description de l’esclave : il perçoit d’abord un bloc exprimé par le GN « un
nègre étendu », il est à remarquer aussi qu’il n’est désigné que par sa couleur, son statut et qu’il
n’a pas de prénom incarnant ainsi tous les esclaves dans un procédé de généralisation (mot qui
n’est pas « insultant » à l’époque) puis distingue un pan d’étoffe misérable car on nous dit dans
une négation restrictive qu’il ne porte que « la moitié de son habit » (l’auteur rajoute une
explication « c’est-à-dire d’un caleçon de toile bleue » pour montrer sa stupeur) et enfin il met
l’accent sur l’amputation de deux membres à savoir « il [lui] manquait la jambe gauche et la main
droite » Cette description de l’esclave se fait sans apitoiement, les informations ont l’air d’avoir
la même valeur que ce soit son habillement ou son corps mutilé.
Toutefois cet être semble
condamné à végéter à même le sol comme le montre le CCT « par terre », comme s’il était
considéré comme un animal.
Il est dans une attitude de faiblesse et de soumission extrême.
-La première réaction de Candide se fait par la mise en place du discours : l’indignation est
traduite par l’interjection « Eh ! » et l’apostrophe « mon Dieu ! » puis l’incompréhension rendue par
la phrase interrogative « que fais-tu là, mon ami, dans l’état horrible où je te vois ? ».
Le fait que le
protagoniste lui parle « en hollandais » n’est pas étonnant car il faut savoir que l’esclave a dû adopter
la langue de son maître donc de Surinam (colonie hollandaise au XVIIIème // aussi au code noir).
Abordons à présent le second mouvement :
- Derrière ce récit se cache un réquisitoire contre l’esclavage : L’habileté de Voltaire est de
donner la parole à la victime, « le nègre », le dotant d’une raison et d’une grande sagesse
devant un Candide aussi ignorant que les lecteurs potentiels de l’époque.
.
- Le nègre fait un simple constat de sa situation.
Son calme est remarquable.
« J’attends mon
maître » comme si cette situation de soumission était légitime et normale.
- Mais à travers les paroles prononcées ce sont en fait tous les responsables du commerce
triangulaire que Voltaire va pointer du doigt en se mettant dans la peau du personnage à
commencer par « Vanderdendur » = onomastique « vendeur à la dent dure » + allitération en
[d, r] montre la cruauté du personnage (référence au libraire hollandais Van duren avec qui
Voltaire a eu des démêlés).
L’apposition « fameux négociant » marque la légalité de sa conduite,
comme celle d’un homme de bonne réputation, un notable de la servitude.
- L’esclave est toujours aussi résigné : dès la ligne 6 on comprend que Candide veut en savoir un
peu plus grâce à sa question et l’esclave se contente de le renseigner de façon calme et résignée.
La réponse au présent de vérité générale est très lapidaire au départ « Oui, c’est l’usage.
» et
traduit l’acceptation des faits et d’une situation qui devrait être considérée comme inacceptable.
--La phrase suivante apporte une nouvelle référence au code noir (les autres étant celle des
mutilations subies lors des fuites et celle de la langue) avec le fait qu’on [leur]donne un caleçon
de toile pour tout vêtement deux fois l’année.
», constat assez blessant, ce sont en effet les seuls
habits....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- [Le nègre de Surinam] CANDIDE DE VOLTAIRE (lecture analytique du chapitre XIX)
- Voltaire Candide ou de l’Optimisme : Chapitre XIX Le nègre de Surinam
- Lecture analytique du Chapitre 19 De Candide (Voltaire) : Le Nègre de Surinam
- « Le nègre de Surinam », Candide, chapitre XIX, Voltaire
- CANDIDE, VOLTAIRE – CHAPITRE 19 : LE NÈGRE DE SURINAM.