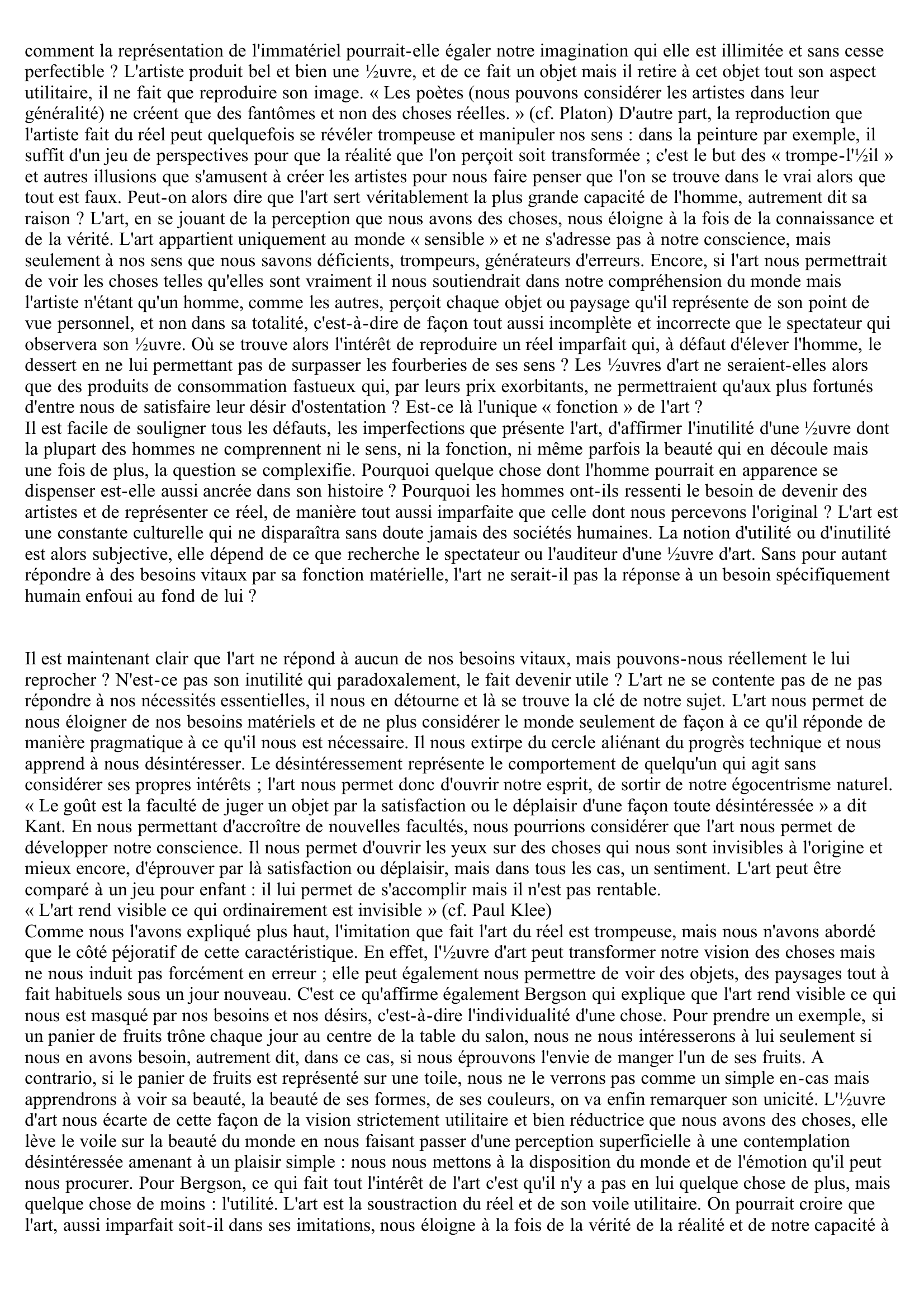L'enfance et éducation de Gargantua
Publié le 27/03/2013

Extrait du document

Jean Audeau, un simple agriculteur découvre par accident dans un énorme tumulus un petit livret qui contient la généalogie des géants d’autrefois. Grandgousier, le père de Gargantua adore manger. Il épouse Gargamelle, fille du roi des Papillons. De leur union naît Gargantua qu’elle porte pendant onze mois. Selon Rabelais, de la durée d’une grossesse dépend la perfection du nouveau-né : plus la grossesse dure longtemps, plus le nouveau-né sera un « chef d’oeuvre «. Gargamelle, enceinte de Gargantua, fait abattre des centaines de milliers de boeufs pour mardi-gras, et elle invite des amis pour ce repas trop imposant pour elle. Malgré son état et les remontrances de son mari, Gargamelle ne peut résister aux tripes et au vin. Ils dansent, chantent, commencent à se disputer. Ivres, ils tiennent des propos incohérents. Pendant la beuverie, Gargamelle ressent des contractions et met au monde de manière insolite Gargantua. Il sort de l’oreille de sa mère et réclame aussitôt à boire.

«
comment la représentation de l'immatériel pourrait-elle égaler notre imagination qui elle est illimitée et sans cesse
perfectible ? L'artiste produit bel et bien une ½uvre, et de ce fait un objet mais il retire à cet objet tout son aspect
utilitaire, il ne fait que reproduire son image.
« Les poètes (nous pouvons considérer les artistes dans leur
généralité) ne créent que des fantômes et non des choses réelles.
» (cf.
Platon) D'autre part, la reproduction que
l'artiste fait du réel peut quelquefois se révéler trompeuse et manipuler nos sens : dans la peinture par exemple, il
suffit d'un jeu de perspectives pour que la réalité que l'on perçoit soit transformée ; c'est le but des « trompe-l'½il »
et autres illusions que s'amusent à créer les artistes pour nous faire penser que l'on se trouve dans le vrai alors que
tout est faux.
Peut-on alors dire que l'art sert véritablement la plus grande capacité de l'homme, autrement dit sa
raison ? L'art, en se jouant de la perception que nous avons des choses, nous éloigne à la fois de la connaissance et
de la vérité.
L'art appartient uniquement au monde « sensible » et ne s'adresse pas à notre conscience, mais
seulement à nos sens que nous savons déficients, trompeurs, générateurs d'erreurs.
Encore, si l'art nous permettrait
de voir les choses telles qu'elles sont vraiment il nous soutiendrait dans notre compréhension du monde mais
l'artiste n'étant qu'un homme, comme les autres, perçoit chaque objet ou paysage qu'il représente de son point de
vue personnel, et non dans sa totalité, c'est-à -dire de façon tout aussi incomplète et incorrecte que le spectateur qui
observera son ½uvre.
Où se trouve alors l'intérêt de reproduire un réel imparfait qui, à défaut d'élever l'homme, le
dessert en ne lui permettant pas de surpasser les fourberies de ses sens ? Les ½uvres d'art ne seraient-elles alors
que des produits de consommation fastueux qui, par leurs prix exorbitants, ne permettraient qu'aux plus fortunés
d'entre nous de satisfaire leur désir d'ostentation ? Est-ce là l'unique « fonction » de l'art ?
Il est facile de souligner tous les défauts, les imperfections que présente l'art, d'affirmer l'inutilité d'une ½uvre dont
la plupart des hommes ne comprennent ni le sens, ni la fonction, ni même parfois la beauté qui en découle mais
une fois de plus, la question se complexifie.
Pourquoi quelque chose dont l'homme pourrait en apparence se
dispenser est-elle aussi ancrée dans son histoire ? Pourquoi les hommes ont-ils ressenti le besoin de devenir des
artistes et de représenter ce réel, de manière tout aussi imparfaite que celle dont nous percevons l'original ? L'art est
une constante culturelle qui ne disparaîtra sans doute jamais des sociétés humaines.
La notion d'utilité ou d'inutilité
est alors subjective, elle dépend de ce que recherche le spectateur ou l'auditeur d'une ½uvre d'art.
Sans pour autant
répondre à des besoins vitaux par sa fonction matérielle, l'art ne serait-il pas la réponse à un besoin spécifiquement
humain enfoui au fond de lui ?
Il est maintenant clair que l'art ne répond à aucun de nos besoins vitaux, mais pouvons-nous réellement le lui
reprocher ? N'est-ce pas son inutilité qui paradoxalement, le fait devenir utile ? L'art ne se contente pas de ne pas
répondre à nos nécessités essentielles, il nous en détourne et là se trouve la clé de notre sujet.
L'art nous permet de
nous éloigner de nos besoins matériels et de ne plus considérer le monde seulement de façon à ce qu'il réponde de
manière pragmatique à ce qu'il nous est nécessaire.
Il nous extirpe du cercle aliénant du progrès technique et nous
apprend à nous désintéresser.
Le désintéressement représente le comportement de quelqu'un qui agit sans
considérer ses propres intérêts ; l'art nous permet donc d'ouvrir notre esprit, de sortir de notre égocentrisme naturel.
« Le goût est la faculté de juger un objet par la satisfaction ou le déplaisir d'une façon toute désintéressée » a dit
Kant.
En nous permettant d'accroître de nouvelles facultés, nous pourrions considérer que l'art nous permet de
développer notre conscience.
Il nous permet d'ouvrir les yeux sur des choses qui nous sont invisibles à l'origine et
mieux encore, d'éprouver par là satisfaction ou déplaisir, mais dans tous les cas, un sentiment.
L'art peut être
comparé à un jeu pour enfant : il lui permet de s'accomplir mais il n'est pas rentable.
« L'art rend visible ce qui ordinairement est invisible » (cf.
Paul Klee)
Comme nous l'avons expliqué plus haut, l'imitation que fait l'art du réel est trompeuse, mais nous n'avons abordé
que le côté péjoratif de cette caractéristique.
En effet, l'½uvre d'art peut transformer notre vision des choses mais
ne nous induit pas forcément en erreur ; elle peut également nous permettre de voir des objets, des paysages tout à
fait habituels sous un jour nouveau.
C'est ce qu'affirme également Bergson qui explique que l'art rend visible ce qui
nous est masqué par nos besoins et nos désirs, c'est-à -dire l'individualité d'une chose.
Pour prendre un exemple, si
un panier de fruits trône chaque jour au centre de la table du salon, nous ne nous intéresserons à lui seulement si
nous en avons besoin, autrement dit, dans ce cas, si nous éprouvons l'envie de manger l'un de ses fruits.
A
contrario, si le panier de fruits est représenté sur une toile, nous ne le verrons pas comme un simple en -cas mais
apprendrons à voir sa beauté, la beauté de ses formes, de ses couleurs, on va enfin remarquer son unicité.
L'½uvre
d'art nous écarte de cette façon de la vision strictement utilitaire et bien réductrice que nous avons des choses, elle
lève le voile sur la beauté du monde en nous faisant passer d'une perception superficielle à une contemplation
désintéressée amenant à un plaisir simple : nous nous mettons à la disposition du monde et de l'émotion qu'il peut
nous procurer.
Pour Bergson, ce qui fait tout l'intérêt de l'art c'est qu'il n'y a pas en lui quelque chose de plus, mais
quelque chose de moins : l'utilité.
L'art est la soustraction du réel et de son voile utilitaire.
On pourrait croire que
l'art, aussi imparfait soit -il dans ses imitations, nous éloigne à la fois de la vérité de la réalité et de notre capacité à.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Gargantua de Rabelais: L'éducation
- GARGANTUA de RABELAIS: DEUXIÈME ÉPISODE : L’ÉDUCATION - CHAPITRES XIV À XXIV
- RABELAIS: L'éducation de Gargantua. — L'abbaye de Thélème (Gargantua : chapitres XIV, XV, XXI, XXII, XXIII, XXIV, LII, LIII, LIV, LV, LNI, LVII).
- Rabelais fait donner par Gargantua à Pantagruel une éducation encyclopédique : « J'y veux un abîme de science », tandis que Montaigne préfère « une tête bien faite à une tête bien pleine » Vous apprécierez brièvement ces deux systèmes opposés et vous direz ensuite quel vous paraît être l'idéal d'une bonne éducation. ?
- Une éducation ambiguë de Gargantua. L'analyse des chapitres choisis du Gargantua de François Rabelais.