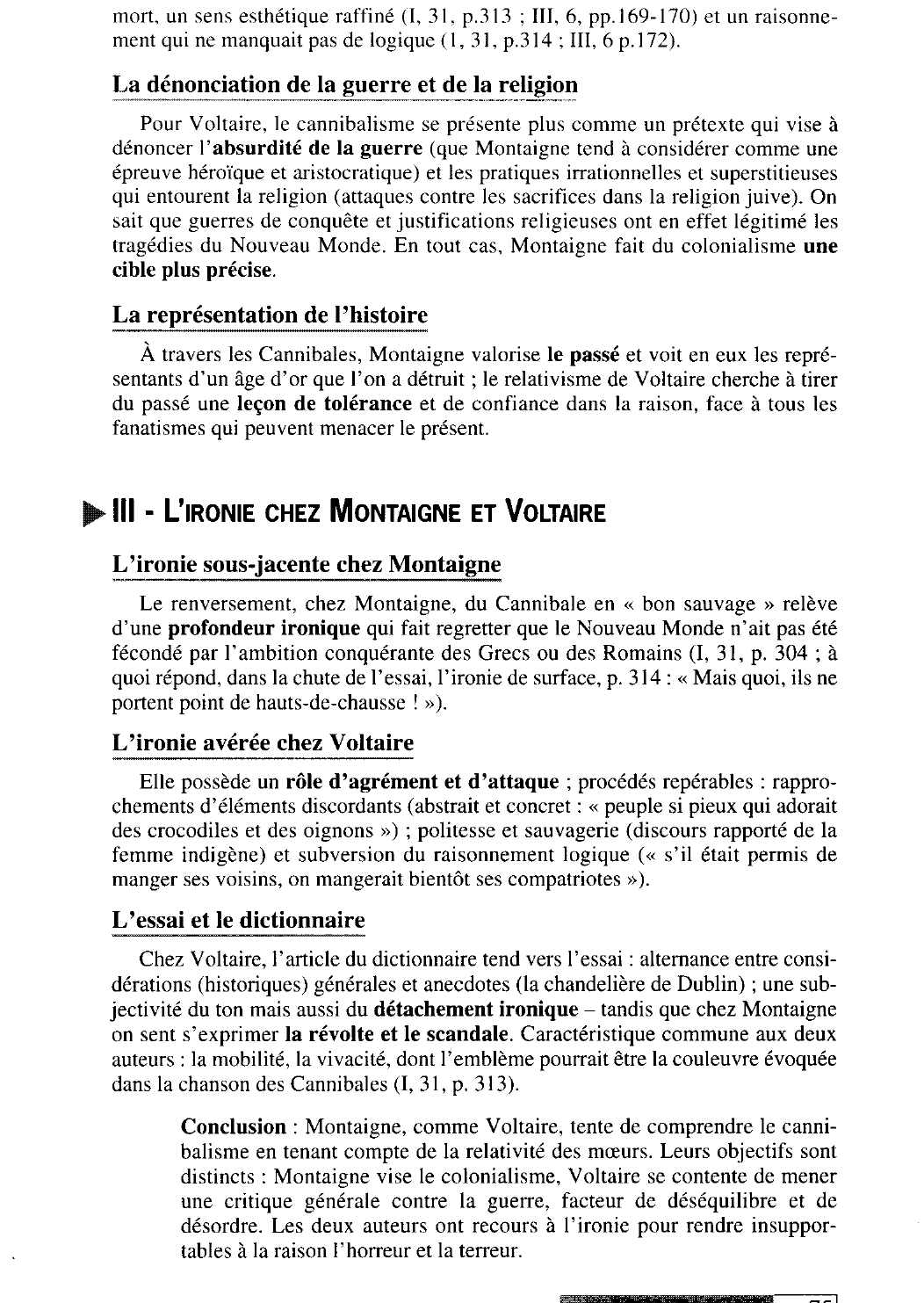Les « Cannibales » de Montaigne et les « Anthropophages » de Voltaire
Publié le 02/08/2014

Extrait du document

Les « Cannibales « de Montaigne et les « Anthropophages « de Voltaire
Si au XVI' siècle, à propos du Nouveau Monde et du statut des « sauvages «, les réflexions de Montaigne apparaissent isolées, il n'en va plus de même au XVIII' siècle où le savoir se rationalise et où se dégage une curiosité ethnologique. On comparera ici l'article « Anthropophages du Dictionnaire philosophique de Voltaire (1764, éd. Garnier-Flammarion, p. 41-43) avec les deux Essais (I, 31 ; III, 6) de Montaigne se rapportant au Nouveau Monde.

«
mort, un sens esthétique raffiné (1, 31, p.313 : III, 6, pp.169-170) et un raisonne
ment qui ne manquait pas de logique ( 1, 31, p.314 ; III, 6 p.172).
La dénoncjat~~ de la guerre et d~-~E~!~~~
Pour Voltaire, le cannibalisme se présente plus comme un prétexte qui vise à
dénoncer l'absurdité de la guerre (que Montaigne tend à considérer comme une
épreuve héroïque et aristocratique) et les pratiques irrationnelles et superstitieuses
qui entourent la religion (attaques contre les sacrifices dans la religion juive).
On
sait que guerres de conquête et justifications religieuses ont en effet légitimé les
tragédies du Nouveau Monde.
En tout cas, Montaigne fait du colonialisme
une cible plus précise.
La représentation de l'histoire
À travers les Cannibales, Montaigne valorise le passé et voit en eux les repré
sentants
d'un âge d'or que l'on a détruit; le relativisme de Voltaire cherche à tirer
du passé une leçon
de tolérance et de confiance dans la raison, face à tous les
fanatismes qui peuvent menacer le présent.
..
Ill -L'IRONIE CHEZ MONTAIGNE ET VOLTAIRE
L'ironie sous-jacente chez Montaigne
Le renversement, chez Montaigne, du Cannibale en « bon sauvage » relève
d'une profondeur ironique qui fait regretter que le Nouveau Monde n'ait pas été
fécondé par
lambition conquérante des Grecs ou des Romains (1, 31, p.
304 ; à
quoi répond, dans la chute de l'essai, l'ironie de surface,
p.
314 : « Mais quoi, ils ne
portent point de hauts-de-chausse
! » ).
L'ironie avérée chez Voltaire
Elle possède un rôle d'agrément et d'attaque ; procédés repérables : rappro
chements d'éléments discordants (abstrait et
concret:« peuple si pieux qui adorait
des crocodiles et des oignons») ; politesse et sauvagerie (discours rapporté de la
femme indigène) et subversion du raisonnement logique
(« s'il était permis de manger ses voisins, on mangerait bientôt ses compatriotes » ).
L'essai et le dictionnaire
Chez Voltaire, l'article du dictionnaire tend vers l'essai: alternance entre consi
dérations (historiques) générales et anecdotes (la chandelière de Dublin) ; une sub
jectivité du ton mais aussi du
détachement ironique -tandis que chez Montaigne
on sent
s'exprimer la révolte et le scandale.
Caractéristique commune aux deux
auteurs : la mobilité, la vivacité, dont
lemblème pourrait être la couleuvre évoquée
dans la chanson des Cannibales
(1, 31, p.
313).
Conclusion : Montaigne, comme Voltaire, tente de comprendre le canni
balisme en tenant compte de la relativité des mœurs.
Leurs objectifs sont
distincts : Montaigne vise le colonialisme, Voltaire se contente de mener
une critique générale contre la guerre, facteur de déséquilibre et de
désordre.
Les deux auteurs ont recours à l'ironie pour rendre insuppor
tables à la raison l'horreur et la terreur..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Analyse de l'essai Des Cannibales, Montaigne.
- Montaigne, des cannibales, I,31
- Des cannibales (1), Montaigne
- Montaigne : Des cannibales, Des coches
- Montaigne, "Cannibales"