LES DÉBUTS LITTERAIRES DE LECONTE DE LISLE A PARIS
Publié le 30/06/2011

Extrait du document
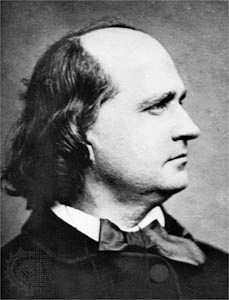
I
Une fois passées les premières effusions de joie qui suivirent le retour de Leconte de Lisle au pays natal, il fallut songer aux affaires sérieuses et choisir une carrière. Sans la licence en droit, le jeune homme ne pouvait ni avoir accès à la magistrature ni être régulièrement inscrit au barreau. Quand il s'installa à Saint-Denis, fût-ce bien, comme le disent ses biographes, en qualité d'avocat ? Ce dut être plutôt, j'imagine, en qualité d'homme d'affaires. Mais quel homme d'affaires que ce poète de vingt-cinq ans ! Il habitait, dans le beau quartier de la ville, et dans une des rues les plus riantes de ce quartier, une maisonnette entourée de manguiers et d'arbres à pain, qui avait vue d'un côté sur la montagne, de l'autre sur la mer. Le site était admirable. Il s'y ennuya. Dans sa résidence nouvelle, il n'avait ni camarades, ni amis, personne avec qui disserter à perte de vue sur ses sujets favoris, religion et politique, littérature et art ; personne avec qui fumer, comme jadis, « le poétique cigare « au bord de la mer. Il se sentait « horriblement seul «. Il n'avait pas oublié son cher Ada- molle, « l'ami «, « le frère «, auquel en quittant Bourbon, il avait juré une amitié éternelle ; et Adamolle ne l'avait pas oublié non plus. Mais Adamolle n'était pas à Saint-Denis ; il était resté sur les Hauts de Saint-Paul, dans l'habitation paternelle ; il s'était marié. Il n'y avait d'autre ressource que de correspondre avec lui de temps à autre. Et c'est grâce aux cinq ou six lettres de Leconte de Lisle à Adamolle qui nous ont été conservées qu'il nous est possible d'avoir, sur cette période de sa vie, quelques demi- clartés.
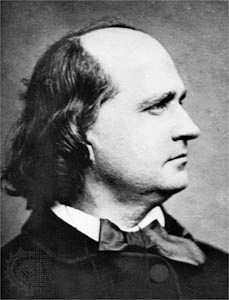
«
« le vulgaire » — lui reconnaissent une belle intelligence, mais l'accusent d'être égoïste et de manquer de cœur.L'objet de sa dissertation est d'établir que l'on ne saurait séparer le cœur de l'intelligence, que « le cœur n'existeque parce qu'il y a intelligence » et que « s'il y a intelligence, il y a virtuellement cœur aussi, alors même que cemode ne nous serait pas visible et palpable.
» Cette démonstration n'a pas paru péremptoire à Adamolle, et il a eusans doute l'imprudence de le dire, car il se fait taxer, dans la lettre suivante, écrite le 18 janvier 1845, d'hérésie enmatière de logique.
Il a eu le tort plus grave — dans les but très louable d'incliner son irritable ami à modérer sesdésirs et à se soumettre à la loi commune — de risquer une distinction entre les joies réelles de l'homme, celles quis'offrent à sa portée, qu'il n'a qu'à étendre la main pour saisir, et les joies factices, qu'il va, à sa peine et à sondam, chercher trop loin ou trop haut.
Son correspondant le rétorque avec vigueur : « Les joies réelles...
ne sont nil'amour, ni l'amitié, ni l'ambition comme on les conçoit sur terre, car tout cela passe et tout cela s'oublie ; mais ellessont dans l'amour de la beauté impérissable, dans l'ambition des richesses inamovibles de l'intelligence, et dansl'étude sans terme du juste, du bien et du vrai absolus, abstraction faite des morales factices d'ici-bas.
Les joiesfausses sont dans la vie vulgaire ; les joies réelles sont en Dieu».
Adamolle s'est permis enfin d'insinuer que siLeconte de Lisle veut aller à Paris, c'est qu'il trouve l'existence, à Saint-Denis, monotone, et qu'il ne serait pasfâché de se distraire un peu.
« Ce que je chercherais à Paris, mon vieil ami, ne serait pas une vie plus émotionnée(sic).....
Ce que je désirerais là-bas, c'est au contraire une vie plus calme que celle-ci, plus propice à l'étude, et nonplus bruyante.
J'ai toujours détesté le bruit que font les hommes, et eux aussi...
» Il veut se persuader qu'au fondAdamolle éprouve les mêmes souffrances que lui, mais qu'il estime plus sage de dissimuler son mal.
« Crois-moi, leremède à cette gangrène générale est une vraie foi en un Dieu vrai.
Quel est ce Dieu ? Nous en parlerons quand tuvoudras ».
Adamolle est tout étourdi de cette philosophie.
11 admire les principes de son ami, il envie la quiétudequ'ils lui ont apportée ; il se déclare prêt à aborder avec lui la question de Dieu, u Hélas ! Hélas ! répond Leconte deLisle, ce sont bien là ces principes tant et si vainement cherchés par beaucoup d'intelligences fortes et belles sansdoute, mais trop préoccupées d'intérêts contingents ; mais pour qu'ils m'aidassent à conquérir cette heureusequiétude dont tu parles, il faudrait que je puisse m'abstraire d'un monde aveugle ou de mauvaise volonté.
Or, unhomme, quel qu'il soit, peut-il s'abstraire incessamment de l'humanité ?» Pour ce qui est de Dieu, de sa substance etde ses attributs, il renvoie son correspondant aux Sept Cordes de la Lyre, de Mme Sand.
« Une part de vérité estcontenue dans ce poème magnifique.
» Adamolle n'est guère capable de suivre son ami si haut.
Ces aperçus sur lanature de l'Être lui rappellent surtout leurs conversations de jadis sur la grève de Saint-Paul.
Il regrette le tempspassé ; il regrette de ne plus retrouver l'ami qu'il a connu.
Et Leconte de Lisle découvre avec stupeur l'abîme quis'est creusé entre lui et celui qu'il aimait le plus, abîme qui ne pourra se combler.
La page vaut qu'on la cite toutentière.
Il y a quelque chose qui serre le cœur dans le spectacle de ces deux âmes qui, malgré elles, se détachentl'une de l'autre, quelque chose aussi qui force le respect dans l'obstination farouche avec laquelle la plus fortementtrempée suit sa voie, sans plus regarder en arrière :
Je m'aperçois avec une sorte de terreur que je vais me détachant, en fait, des individus, pour agir et pour vivre, parla pensée, avec la masse seulement.
Je m'efface, je me synthétise I C'est le tort, — si c'en est un — de la poésieque j'affectionne entre toutes.
J'ai donc dû te paraître un égoïste, mon ami, alors même que tout au rebours, c'étaitl'oubli de ma propre individualité qui donnait cette apparence mauvaise et misérable à mes actions, ou plutôt à monmanque d'action.
Hélas I mon vieux camarade, il ne faut pas s'accoutumer à vivre seul, car le contraire se réapprendfacilement [on attendrait plutôt : se désapprend].
Ne crois pas cependant que cela tue le cœur, parce que celal'élargit.
L'individu en souffre, l'homme s'en irrite, mais qui sait si Dieu n'y gagne pas ? Quant à nous, mon cherAdamolle.
vois un peu I Nous nous sommes séparés durant de longues années, nous avons aimé d'autres hommes, etils nous ont aimés ; notre cœur a ressenti d'autres besoins que ceux auxquels satisfaisait notre première affection.Nous avons été heureux, nous avons souffert et nous nous sommes à demi retrouvés.
D'où vient-il donc que nousdevions nier l'amitié qu'il ne nous a pas été donné de poursuivre aussi naïve qu'autrefois ? La faute n'en est ni à moini à toi.
Tu t'es marié, tu as vécu d'une vie inflexible dans ses limites.
Je me suis aventuré aussi dans une routedivergente, et j'ai cherché ma plus grande somme de bonheur dans la contemplation interne et externe du beauinfini, de l'âme universelle du monde, de Dieu dont nous sommes une des manifestations éternelles.
Il ne faut pasdouter, mon ami.
Il faut laisser aux niais et aux lâches leurs stupides négations du cœur immortel et de l'intelligencedivine de l'homme, car c'est là de la misère morale, mille fois plus affreuse que la misère matérielle, puisque c'est unedégradation de Dieu en nous.
Tu as souffert, mon vieil ami, mais l'épuration est dans la douleur.
Tu as aimésaintement, mais l'amour illumine à jamais notre cœur.
Et tu te dis glacé, désespéré, sans désirs et sans passions !Tu te mens à toi-même.
L'homme qui a souffert et qui a aimé, quelle que soit sa grandeur, quelle que soit sonhumilité, s'il a souffert, s'il a aimé saintement, cet homme ne s'éteindra jamais, pas même sous l'haleine de ce qu'onnomme la mort et qui n'est que le réveil.
De ce pathos romantique, tout enguirlandé des festons de la rhétorique à la mode, il résulte avec la dernièreévidence que Leconte de Lisle ne se sent plus, avec les gens parmi lesquels il vit, rien de commun.
Il n'a, dans cesconditions, qu'une chose à faire : c'est, puisqu'il le peut, de s'en aller.
Après bien des hésitations, il accepte laproposition que lui ont faite, par l'intermédiaire de son ami Villeneuve, un étudiant qu'il a jadis connu à Rennes, lesrédacteurs de La Démocratie Pacifique, journal phalanstérien de Paris.
On lui promet « en attendant mieux, 1.800 fr.par an d'appointements fixes et l'impression, aux frais de l'Ecole sociétaire, d'un volume de poésies prêt à être publié».
En avril 1845, vraisemblablement, il s'embarquait sur le trois-mâts La Thélaïre, capitaine Bastard, à destination deNantes.
La traversée dura deux mois.
A ce voyage se rapporteraient les impressions d'où sont nées beaucoup plustard deux pièces des Poèmes Tragiques, L'Albatros et Sacra fames, qui évoquent, au milieu de la tempête, lepuissant oiseau, le « roi de l'espace »,.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- DERNIERS POÈMES de Leconte de Lisle. (résumé & analyse)
- POÈMES BARBARES de Charles-Marie-René Leconte de Lisle (résumé)
- POÈMES ANTIQUES, recueil de Leconte de Lisle
- POÈMES BARBARES de Leconte de Lisle : Fiche de lecture
- POÈMES BARBARES de Leconte de Lisle

































