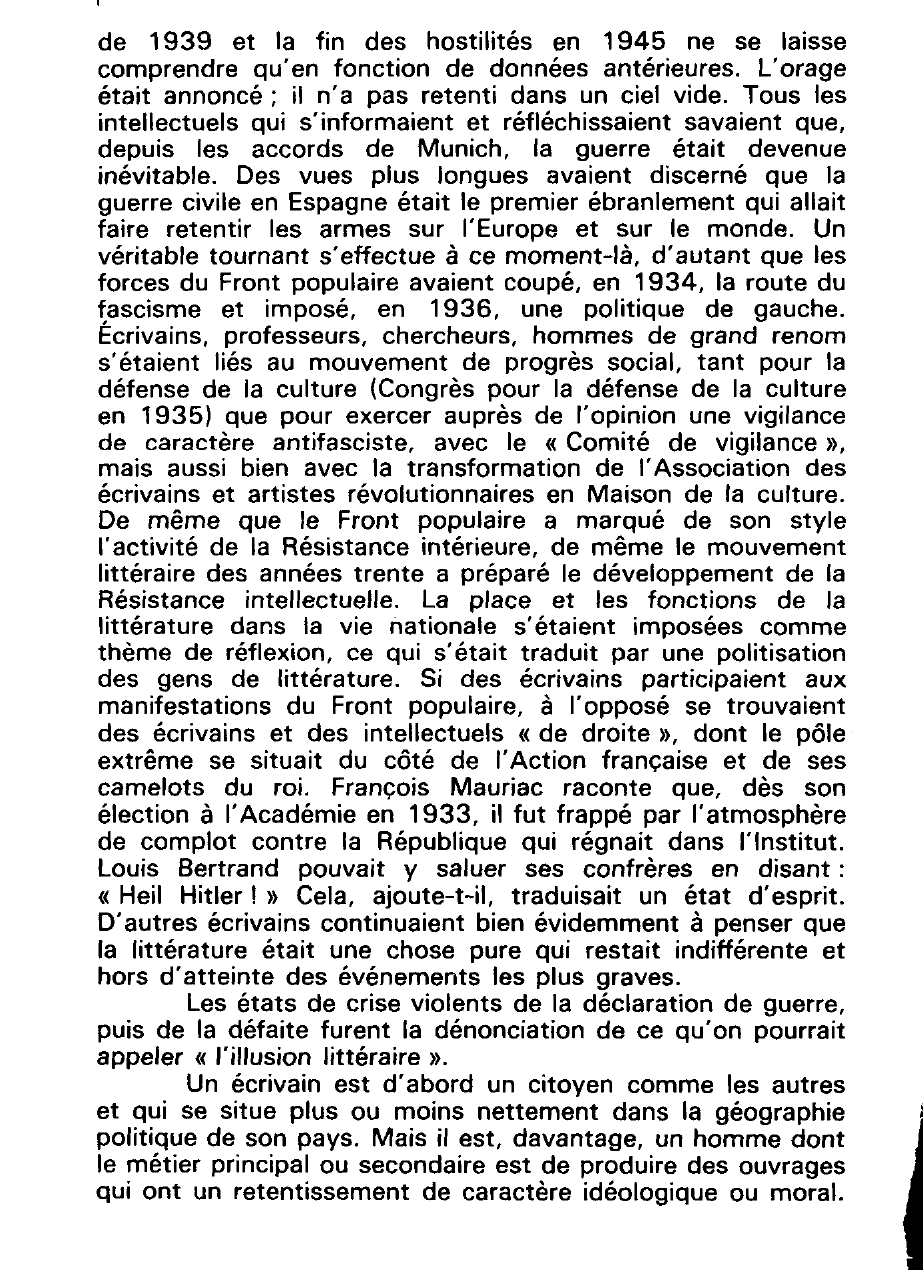LES ÉCRIVAINS ET LA SECONDE GUERRE MONDIALE
Publié le 30/03/2012

Extrait du document
Il est assez remarquable que si certains prosateurs écrivirent dans les journaux de la collaboration, on n'y compte pratiquement pas de poètes, car on ne peut appeler poètes les auteurs de ces pauvres chansons qui devaient célébrer la gloire du Maréchal-nous-voilà, et autres fadaises. Ce qu'on a appelé la poésie de la Résistance est en réalité, durant la guerre, toute la poésie française. Elle en est, non pas un épisode occasionnel comme certains ont tenté de le faire croire, mais un moment essentiel qui reprenait les traditions antérieures estompées, une poésie qui approfondissait les rapports de l'homme avec son temps et le monde, c'est-à-dire qui proposait un ensemble de sentiments et de valeurs nouveau, et en même temps trouvait les formes intelligibles pour l'exprimer.
«
338 HISTOIRE LITTÉRAIRE DE LA FRANCE
de 1939 et la fin des hostilités en 1945 ne se laisse
comprendre qu'en fonction de données antérieures.
L'orage était annoncé; il n'a pas retenti dans un ciel vide.
Tous les
intellectuels qui s'informaient et réfléchissaient savaient que, depuis les accords de Munich, la guerre était devenue
inévitable.
Des vues plus longues avaient discerné que la
guerre civile en Espagne
était le premier ébranlement qui allait faire retentir les armes sur l'Europe et sur le monde.
Un
véritable tournant s'effectue à ce moment-là, d'autant que les
forces du Front populaire avaient coupé, en 1934, la route du
fascisme et imposé, en 1936, une politique de gauche.
Écrivains, professeurs, chercheurs, hommes de grand renom
s'étaient liés au mouvement de progrès social, tant pour la
défense de la culture (Congrès pour la défense de la culture
en 1935) que pour exercer auprès de l'opinion une vigilance
de caractère antifasciste.
avec le « Comité de vigilance ».
mais aussi bien avec la transformation de l'Association des
écrivains et artistes révolutionnaires en Maison de la culture.
De même que le Front populaire a marqué de son style l'activité de la Résistance intérieure, de même le mouvement littéraire des années trente a préparé le développement de la
Résistance intellectuelle.
La place et les fonctions de la littérature dans la vie nationale s'étaient imposées comme thème de réflexion, ce qui s'était traduit par une politisation
des gens de littérature.
Si des écrivains participaient aux
manifestations du Front
populaire.
à l'opposé se trouvaient
des écrivains et des intellectuels «de droite».
dont le pôle
extrême se situait du côté de l'Action française et de ses
camelots du roi.
François Mauriac raconte que, dès son
élection à l'Académie en
1933, il fut frappé par l'atmosphère de complot contre la République qui régnait dans l'Institut.
Louis Bertrand pouvait y saluer ses confrères en disant : « Heil Hitler!» Cela, ajoute-t-il, traduisait un état d'esprit.
D'autres écrivains continuaient bien évidemment à penser que
la littérature était une chose pure qui restait indifférente et hors d'atteinte des événements les plus graves.
Les états de crise violents de la déclaration de guerre,
puis de la défaite furent la dénonciation de ce qu'on pourrait
appeler « l'illusion littéraire ».
Un écrivain est d'abord un citoyen comme les autres et qui se situe plus ou moins nettement dans la géographie
politique de son pays.
Mais il est, davantage, un homme dont le métier principal ou secondaire est de produire des ouvrages
qui ont un retentissement de caractère idéologique ou moral..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Thème 1 - Fragilités des démocraties, totalitarisme et Seconde Guerre Mondiale
- Les soviétiques et la seconde guerre mondiale
- En analysant les documents,en les confrontant et en vous appuyant sur vos connaissances, vous vous interrogerez sur ce qu’apportent les procès à la connaissance historique des crimes contre l’humanité commis par les nazis au cours de la Seconde Guerre Mondiale
- Cours d'histoire sur la seconde guerre mondiale
- Carte mentale-La Seconde guerre mondiale