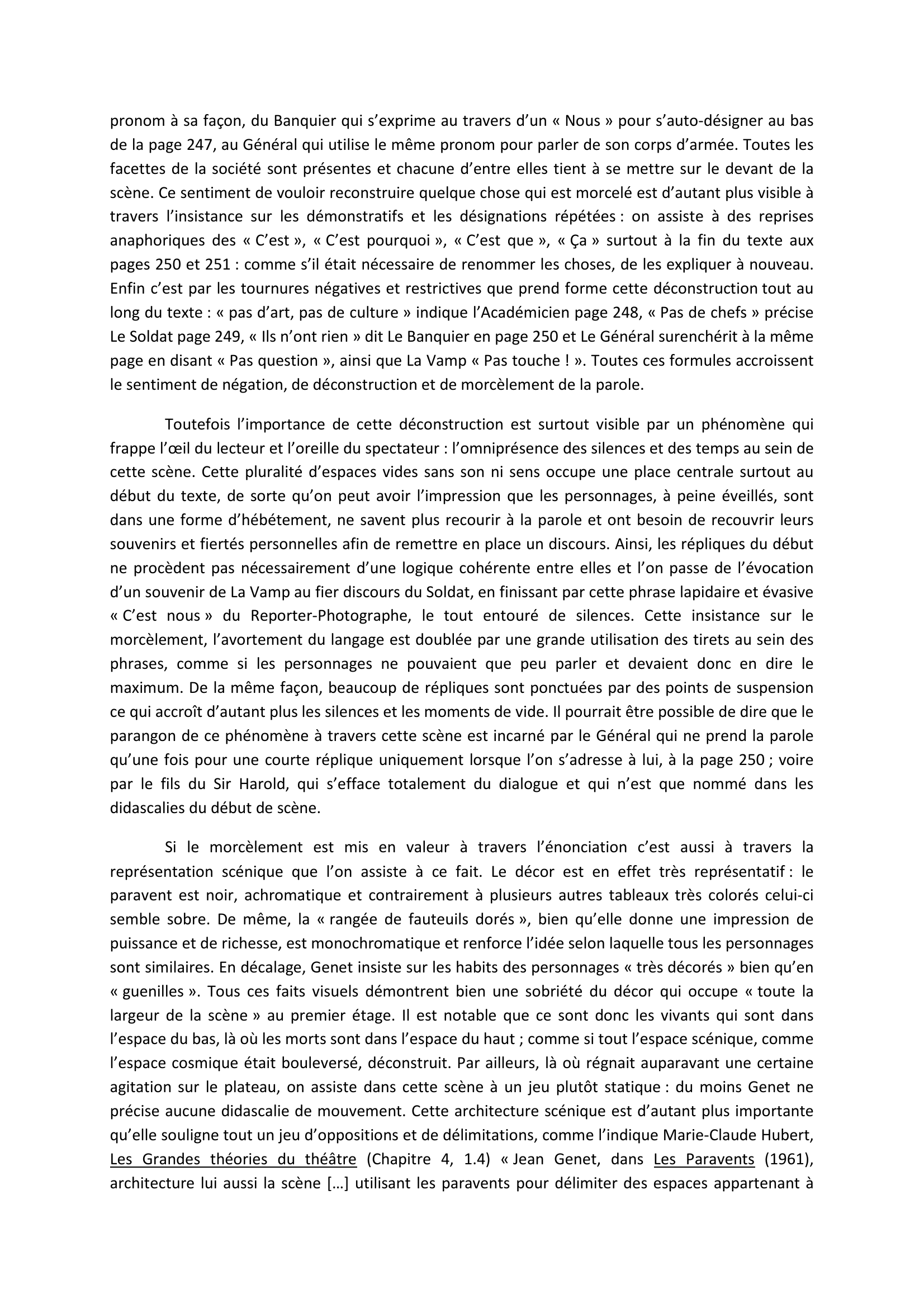Les Paravents, Genet, 16ème Tableau (p. 246-251) - Commentaire Composé
Publié le 21/03/2012

Extrait du document
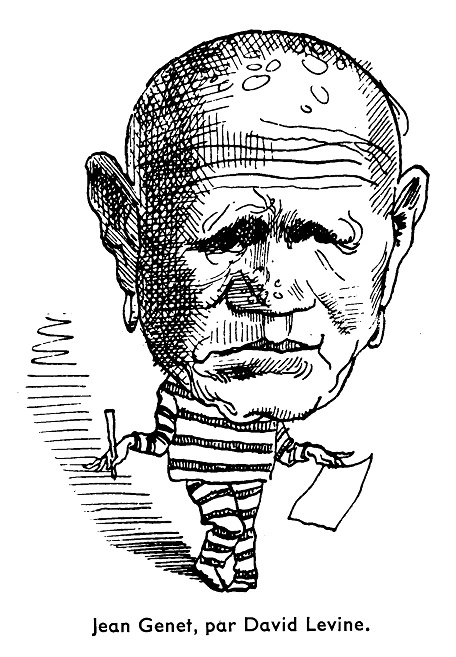
Les Paravents de Genet, publié en 1961, est une pièce absolue et globalisante, telle une machine infernale qui repose sur la multiplicité des rôles et des thèmes, mais qui ne s’arrête jamais. Comme le disait André Malraux, « [cette pièce] est anti-tout «. Ainsi, si la réception de cette pièce dans la mise en scène de Roger Blin en 1966 fut mitigée et provoqua un tollé, c’est bien qu’elle aborde des sujets sensibles et qui posent, encore aujourd’hui, problème. Ces sujets sensibles sont d’autant plus problématiques puisque Genet ne donne jamais de solution véritable, de message clair à son lecteur ; et cela s’observe parfaitement dans l’extrait en présence, issu de la quatrième partie du Seizième tableau, tableau final. Entourée par des scènes où les Algériens d’origine sont présents, il est possible de dire que c’est la dernière scène représentant l’absolu de la société occidentale d’époque ; et cet encadrement est d’autant plus visible qu’il est mis en scène à travers l’artifice technique dont la pièce porte le nom : les paravents. Il faudra donc observer comment Genet met en scène pour la dernière fois une vision sociétale des colonisateurs. Il s’agira de prime abord d’observer une écriture spécifique que Genet met ici en place, écriture de la déconstruction et du morcèlement. Cela impliquera par la suite de s’attarder sur la valse des rôles et de l’écriture qui se joue au sein de ce passage. Enfin, il sera nécessaire de constater l’écriture de l’absolu qui est ici mise en scène.
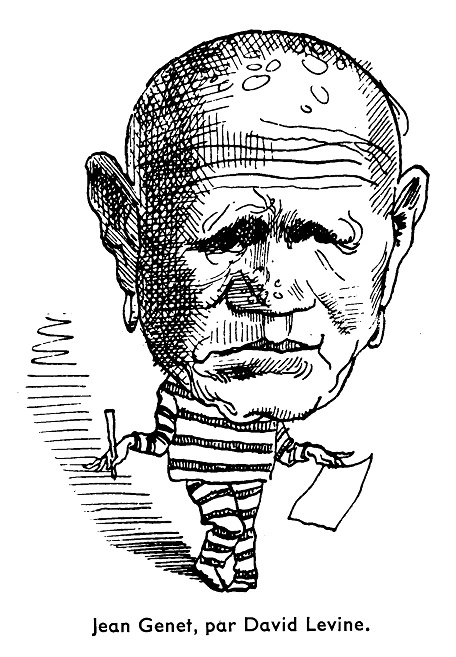
«
pronom à sa façon, du Banquier qui s’exprime au travers d’un « Nous » pour s’auto-désigner au bas
de la page 247, au Général qui utilise le même pronom pour parler de son corps d’armée.
Toutes les
facettes de la société sont présentes et chacune d’entre elles tient à se mettre sur le devant de la
scène.
Ce sentiment de vouloir reconstruire quelque chose qui est morcelé est d’autant plus visible à
travers l’insistance sur les démonstratifs et les désignations répétées : on assiste à des reprises
anaphoriques des « C’est », « C’est pourquoi », « C’est que », « Ça » surtout à la fin du texte aux
pages 250 et 251 : comme s’il était nécessaire de renommer les choses, de les expliquer à nouveau.
Enfin c’est par les tournures négatives et restrictives que prend forme cette déconstruction tout au
long du texte : « pas d’art, pas de culture » indique l’Académicien page 248, « Pas de chefs » précise
Le Soldat page 249, « Ils n’ont rien » dit Le Banquier en page 250 et Le Général surenchérit à la même
page en disant « Pas question », ainsi que La Vamp « Pas touche ! ».
Toutes ces formules accroissent
le sentiment de négation, de déconstruction et de morcèlement de la parole.
Toutefois l’importance de cette déconstruction est surtout visible par un phénomène qui
frappe l’ œil du lecteur et l’oreille du spectateur : l’omniprésence des silences et des temps au sein de
cette scène.
Cette pluralité d’espaces vides sans son ni sens occupe une place centrale surtout au
début du texte, de sorte qu’on peut avoir l’impression que les personnages, à peine éveillés, sont
dans une forme d’hébétement, ne savent plus recourir à la parole et ont besoin de recouvrir leurs
souvenirs et fiertés personnelles afin de remettre en place un discours.
Ainsi, les répliques du début
ne procèdent pas nécessairement d’une logique cohérente entre elles et l’on passe de l’évocation
d’un souvenir de La Vamp au fier discours du Soldat, en finissant par cette phrase lapidaire et évasive
« C’est nous » du Reporter-Photographe, le tout entouré de silences.
Cette insistance sur le
morcèlement, l’avortement du langage est doublée par une grande utilisation des tirets au sein des
phrases, comme si les personnages ne pouvaient que peu parler et devaient donc en dire le
maximum.
De la même façon, beaucoup de répliques sont ponctuées par des points de suspension
ce qui accroît d’autant plus les silences et les moments de vide.
Il pourrait être possible de dire que le
parangon de ce phénomène à travers cette scène est incarné par le Général qui ne prend la parole
qu’une fois pour une courte réplique uniquement lorsque l’on s’adresse à lui, à la page 250 ; voire
par le fils du Sir Harold, qui s’efface totalement du dialogue et qui n’est que nommé dans les
didascalies du début de scène.
Si le morcèlement est mis en valeur à travers l’énonciation c’est aussi à travers la
représentation scénique que l’on assiste à ce fait.
Le décor est en effet très représentatif : le
paravent est noir, achromatique et contrairement à plusieurs autres tableaux très colorés celui-ci
semble sobre.
De même, la « rangée de fauteuils dorés », bien qu’elle donne une impression de
puissance et de richesse, est monochromatique et renforce l’idée selon laquelle tous les personnages
sont similaires.
En décalage, Genet insiste sur les habits des personnages « très décorés » bien qu’en
« guenilles ».
Tous ces faits visuels démontrent bien une sobriété du décor qui occupe « toute la
largeur de la scène » au premier étage.
Il est notable que ce sont donc les vivants qui sont dans
l’espace du bas, là où les morts sont dans l’espace du haut ; comme si tout l’espace scénique, comme
l’espace cosmique était bouleversé, déconstruit.
Par ailleurs, là où régnait auparavant une certaine
agitation sur le plateau, on assiste dans cette scène à un jeu plutôt statique : du moins Genet ne
précise aucune didascalie de mouvement.
Cette architecture scénique est d’autant plus importante
qu’elle souligne tout un jeu d’oppositions et de délimitations, comme l’indique Marie-Claude Hubert,
Les Grandes théories du théâtre (Chapitre 4, 1.4) « Jean Genet, dans Les Paravents (1961),
architecture lui aussi la scène […] utilisant les paravents pour délimiter des espaces appartenant à.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Jean Giono, le Hussard sur le toit. Vous ferez de ce texte un commentaire composé. Vous pourrez montrer, par exemple, comment Jean Giono fait d'un paysage brûlé par la chaleur un tableau fantastique et parfois inquiétant.
- Commentaire Composé - Le Lombric, Jacques Roubaud
- Le Misanthrope : Commentaire composé oral Acte 1, Scène 1
- commentaire composé: Aline - Charles Ferdinand Ramuz
- Queuneau: Commentaire Composé : Les Boueux sont en grève