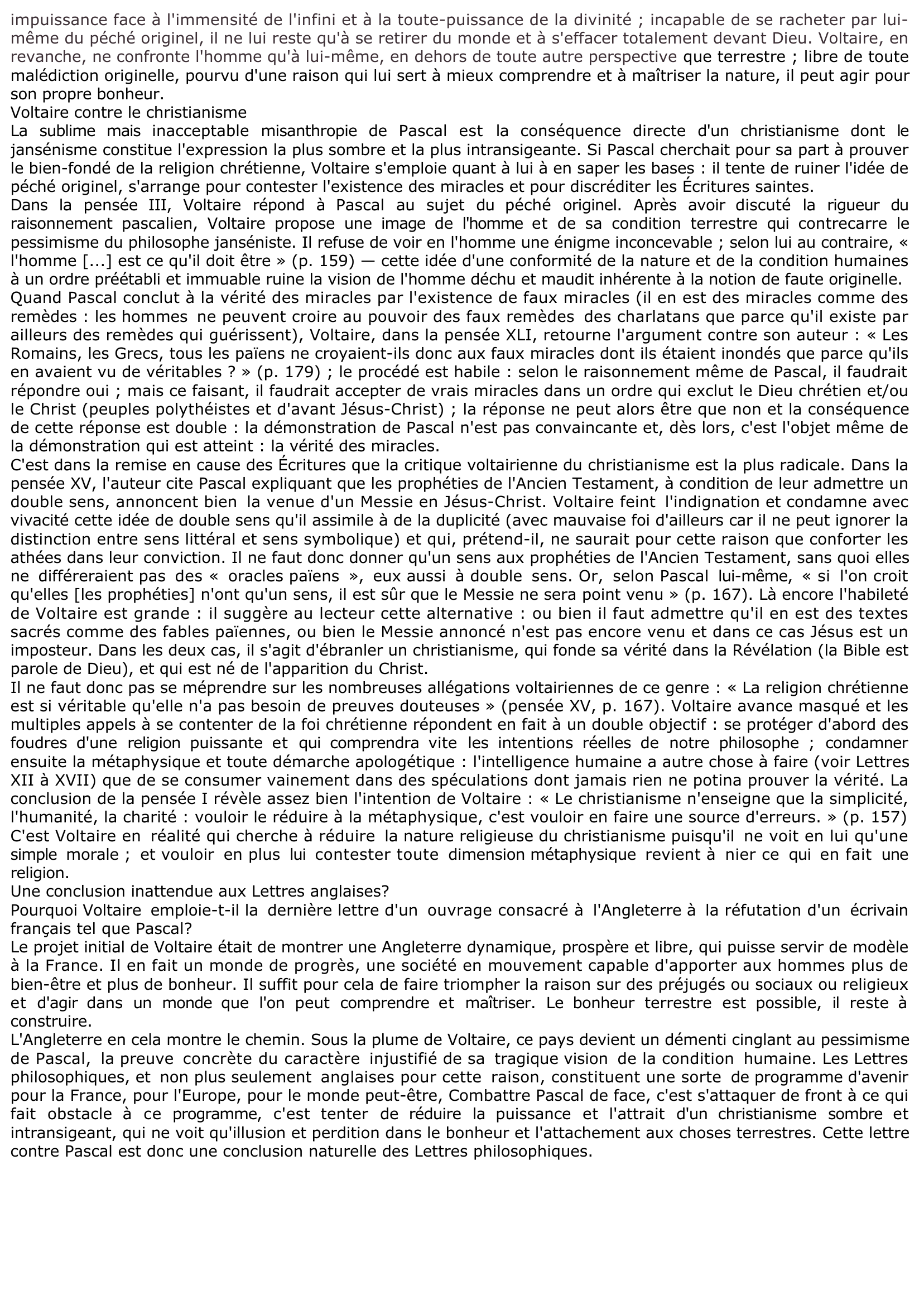LETTRE XXV: Sur les Pensées de M. Pascal (Lettres philosophiques de Voltaire)
Publié le 17/01/2022

Extrait du document
«
impuissance face à l'immensité de l'infini et à la toute-puissance de la divinité ; incapable de se racheter par lui-même du péché originel, il ne lui reste qu'à se retirer du monde et à s'effacer totalement devant Dieu.
Voltaire, enrevanche, ne confronte l'homme qu'à lui-même, en dehors de toute autre perspective que terrestre ; libre de toute malédiction originelle, pourvu d'une raison qui lui sert à mieux comprendre et à maîtriser la nature, il peut agir pourson propre bonheur.Voltaire contre le christianismeLa sublime mais inacceptable misanthropie de Pascal est la conséquence directe d'un christianisme dont lejansénisme constitue l'expression la plus sombre et la plus intransigeante.
Si Pascal cherchait pour sa part à prouverle bien-fondé de la religion chrétienne, Voltaire s'emploie quant à lui à en saper les bases : il tente de ruiner l'idée depéché originel, s'arrange pour contester l'existence des miracles et pour discréditer les Écritures saintes.Dans la pensée III, Voltaire répond à Pascal au sujet du péché originel.
Après avoir discuté la rigueur duraisonnement pascalien, Voltaire propose une image de l'homme et de sa condition terrestre qui contrecarre lepessimisme du philosophe janséniste.
Il refuse de voir en l'homme une énigme inconcevable ; selon lui au contraire, «l'homme [...] est ce qu'il doit être » (p.
159) — cette idée d'une conformité de la nature et de la condition humainesà un ordre préétabli et immuable ruine la vision de l'homme déchu et maudit inhérente à la notion de faute originelle.Quand Pascal conclut à la vérité des miracles par l'existence de faux miracles (il en est des miracles comme desremèdes : les hommes ne peuvent croire au pouvoir des faux remèdes des charlatans que parce qu'il existe parailleurs des remèdes qui guérissent), Voltaire, dans la pensée XLI, retourne l'argument contre son auteur : « LesRomains, les Grecs, tous les païens ne croyaient-ils donc aux faux miracles dont ils étaient inondés que parce qu'ilsen avaient vu de véritables ? » (p.
179) ; le procédé est habile : selon le raisonnement même de Pascal, il faudraitrépondre oui ; mais ce faisant, il faudrait accepter de vrais miracles dans un ordre qui exclut le Dieu chrétien et/oule Christ (peuples polythéistes et d'avant Jésus-Christ) ; la réponse ne peut alors être que non et la conséquencede cette réponse est double : la démonstration de Pascal n'est pas convaincante et, dès lors, c'est l'objet même dela démonstration qui est atteint : la vérité des miracles.C'est dans la remise en cause des Écritures que la critique voltairienne du christianisme est la plus radicale.
Dans lapensée XV, l'auteur cite Pascal expliquant que les prophéties de l'Ancien Testament, à condition de leur admettre undouble sens, annoncent bien la venue d'un Messie en Jésus-Christ.
Voltaire feint l'indignation et condamne avecvivacité cette idée de double sens qu'il assimile à de la duplicité (avec mauvaise foi d'ailleurs car il ne peut ignorer ladistinction entre sens littéral et sens symbolique) et qui, prétend-il, ne saurait pour cette raison que conforter lesathées dans leur conviction.
Il ne faut donc donner qu'un sens aux prophéties de l'Ancien Testament, sans quoi ellesne différeraient pas des « oracles païens », eux aussi à double sens.
Or, selon Pascal lui-même, « si l'on croitqu'elles [les prophéties] n'ont qu'un sens, il est sûr que le Messie ne sera point venu » (p.
167).
Là encore l'habiletéde Voltaire est grande : il suggère au lecteur cette alternative : ou bien il faut admettre qu'il en est des textessacrés comme des fables païennes, ou bien le Messie annoncé n'est pas encore venu et dans ce cas Jésus est unimposteur.
Dans les deux cas, il s'agit d'ébranler un christianisme, qui fonde sa vérité dans la Révélation (la Bible estparole de Dieu), et qui est né de l'apparition du Christ.Il ne faut donc pas se méprendre sur les nombreuses allégations voltairiennes de ce genre : « La religion chrétienneest si véritable qu'elle n'a pas besoin de preuves douteuses » (pensée XV, p.
167).
Voltaire avance masqué et lesmultiples appels à se contenter de la foi chrétienne répondent en fait à un double objectif : se protéger d'abord desfoudres d'une religion puissante et qui comprendra vite les intentions réelles de notre philosophe ; condamnerensuite la métaphysique et toute démarche apologétique : l'intelligence humaine a autre chose à faire (voir LettresXII à XVII) que de se consumer vainement dans des spéculations dont jamais rien ne potina prouver la vérité.
Laconclusion de la pensée I révèle assez bien l'intention de Voltaire : « Le christianisme n'enseigne que la simplicité,l'humanité, la charité : vouloir le réduire à la métaphysique, c'est vouloir en faire une source d'erreurs.
» (p.
157)C'est Voltaire en réalité qui cherche à réduire la nature religieuse du christianisme puisqu'il ne voit en lui qu'unesimple morale ; et vouloir en plus lui contester toute dimension métaphysique revient à nier ce qui en fait unereligion.Une conclusion inattendue aux Lettres anglaises?Pourquoi Voltaire emploie-t-il la dernière lettre d'un ouvrage consacré à l'Angleterre à la réfutation d'un écrivainfrançais tel que Pascal?Le projet initial de Voltaire était de montrer une Angleterre dynamique, prospère et libre, qui puisse servir de modèleà la France.
Il en fait un monde de progrès, une société en mouvement capable d'apporter aux hommes plus debien-être et plus de bonheur.
Il suffit pour cela de faire triompher la raison sur des préjugés ou sociaux ou religieuxet d'agir dans un monde que l'on peut comprendre et maîtriser.
Le bonheur terrestre est possible, il reste àconstruire.L'Angleterre en cela montre le chemin.
Sous la plume de Voltaire, ce pays devient un démenti cinglant au pessimismede Pascal, la preuve concrète du caractère injustifié de sa tragique vision de la condition humaine.
Les Lettresphilosophiques, et non plus seulement anglaises pour cette raison, constituent une sorte de programme d'avenirpour la France, pour l'Europe, pour le monde peut-être, Combattre Pascal de face, c'est s'attaquer de front à ce quifait obstacle à ce programme, c'est tenter de réduire la puissance et l'attrait d'un christianisme sombre etintransigeant, qui ne voit qu'illusion et perdition dans le bonheur et l'attachement aux choses terrestres.
Cette lettrecontre Pascal est donc une conclusion naturelle des Lettres philosophiques..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Voltaire écrit dans ses Lettres philosophiques : « Il me paraît qu'en général l'esprit dans lequel Pascal écrivit ces Pensées était de montrer l'homme sous un jour odieux. Il s'acharne à nous peindre tous méchants et malheureux. Il écrit contre la nature humaine à peu près comme il écrit contre les jésuites. Il impute à l'essence de notre nature ce qui n'appartient qu'à certains hommes. Il dit éloquemment des injures au genre humain. » Expliquer et discuter ce jugement.
- En quoi réside l'efficacité du texte de Voltaire ? ■ VOLTAIRE, Lettres philosophiques, Dixième lettre, « Sur le commerce »
- Voltaire, Première lettre, « Sur les quakers », Lettres philosophiques (1734): Vous ferez le commentaire du texte, de la ligne 1 : << J’ai cru que la doctrine ... >> à la ligne 26 : << ... interroger mon homme >>.
- Voltaire (1694-1778), Première lettre, « Sur les quakers », Lettres philosophiques
- Voltaire, Lettres philosophiques, Lettre 10 « Sur le commerce » , 1734 - Commentaire composé