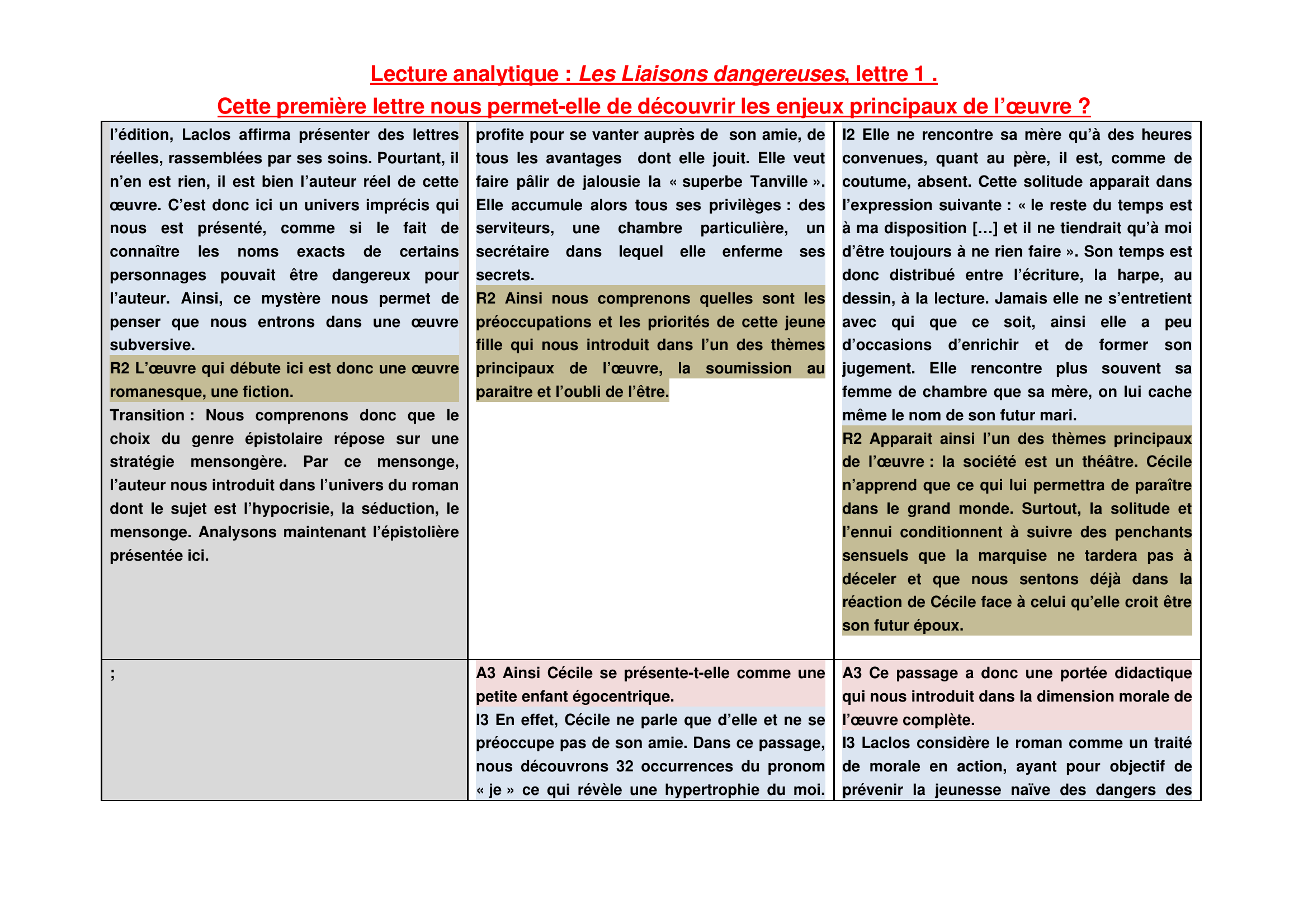liaison dangereuse
Publié le 24/10/2012
Extrait du document
«
Lecture analytique : Les Liaisons dangereuses , lettre 1 .
Cette première lettre nous permetelle de d écouvrir les enjeux principaux de l’œuvre ?
l’
édition, Laclos affirma pr ésenter des lettres
r
éelles, rassembl ées par ses soins. Pourtant, il
n’en est rien, il est bien l’auteur r
éel de cette
œuvre.
C’est donc ici un univers impr
écis qui
nous est pr
ésent é, comme si le fait de
conna
ître les noms exacts de certains
personnages pouvait
être dangereux pour
l’auteur.
Ainsi, ce myst
ère nous permet de
penser que nous entrons dans une œuvre
subversive.
R2 L’œuvre qui d
ébute ici est donc une œuvre
romanesque, une fiction.
Transition : Nous comprenons donc que le
choix du genre
épistolaire r épose sur une
strat
égie mensong ère.
Par ce mensonge,
l’auteur nous introduit dans l’univers du roman
dont le sujet est l’hypocrisie, la s
éduction, le
mensonge.
Analysons maintenant l’
épistoli ère
pr
ésent ée ici.
profite pour se vanter aupr
ès de son amie, de
tous les avantages dont elle jouit.
Elle veut
faire p
âlir de jalousie la « superbe Tanville ».
Elle accumule alors tous ses privil
èges : des
serviteurs, une chambre particuli
ère, un
secr
étaire dans lequel elle enferme ses
secrets.
R2 Ainsi nous comprenons quelles sont les
pr
éoccupations et les priorit és de cette jeune
fille qui nous introduit dans l’un des th
èmes
principaux de l’œuvre, la soumission au
paraitre et l’oubli de l’
être.
I2 Elle ne rencontre sa m
ère qu’ à des heures
convenues, quant au p
ère, il est, comme de
coutume, absent.
Cette solitude apparait dans
l’expression suivante : « le reste du temps est
à
ma disposition […] et il ne tiendrait qu’ à moi
d’
être toujours à ne rien faire ». Son temps est
donc distribu
é entre l’ écriture, la harpe, au
dessin,
à la lecture. Jamais elle ne s’entretient
avec qui que ce soit, ainsi elle a peu
d’occasions d’enrichir et de former son
jugement.
Elle rencontre plus souvent sa
femme de chambre que sa m
ère, on lui cache
m
ême le nom de son futur mari.
R2 Apparait ainsi l’un des th
èmes principaux
de l’œuvre : la soci
été est un th éâ tre.
C écile
n’apprend que ce qui lui permettra de para
ître
dans le grand monde.
Surtout, la solitude et
l’ennui conditionnent
à suivre des penchants
sensuels que la marquise ne tardera pas
à
d
éceler et que nous sentons d éjà dans la
r
éaction de C écile face à celui qu’elle croit être
son futur
époux.
; A3 Ainsi C
écile se pr ésentetelle comme une
petite enfant
égocentrique.
I3 En effet, C
écile ne parle que d’elle et ne se
pr
éoccupe pas de son amie. Dans ce passage,
nous d
écouvrons 32 occurrences du pronom
« je » ce qui r
évèle une hypertrophie du moi.
A3 Ce passage a donc une port
ée didactique
qui nous introduit dans la dimension morale de
l’œuvre compl
ète.
I3 Laclos consid
ère le roman comme un trait é
de morale en action, ayant pour objectif de
pr
évenir la jeunesse na ïve des dangers des .
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Lecture Cursive n°5 Laclos, Liaison Dangereuse
- STRUCTURES ET PROPRIETES DES MOLECULES ET DES IONS 1G SPE Chap.5 Objectifs : Etablir des schémas de Lewis et géométrie de molécules Déterminer les caractères polaire d’une liaison, d’une molécule.
- PITIÉ DANGEREUSE (La) Stefan Zweig (résumé)
- La technique est-elle dangereuse
- La philosophie est-elle dangereuse?