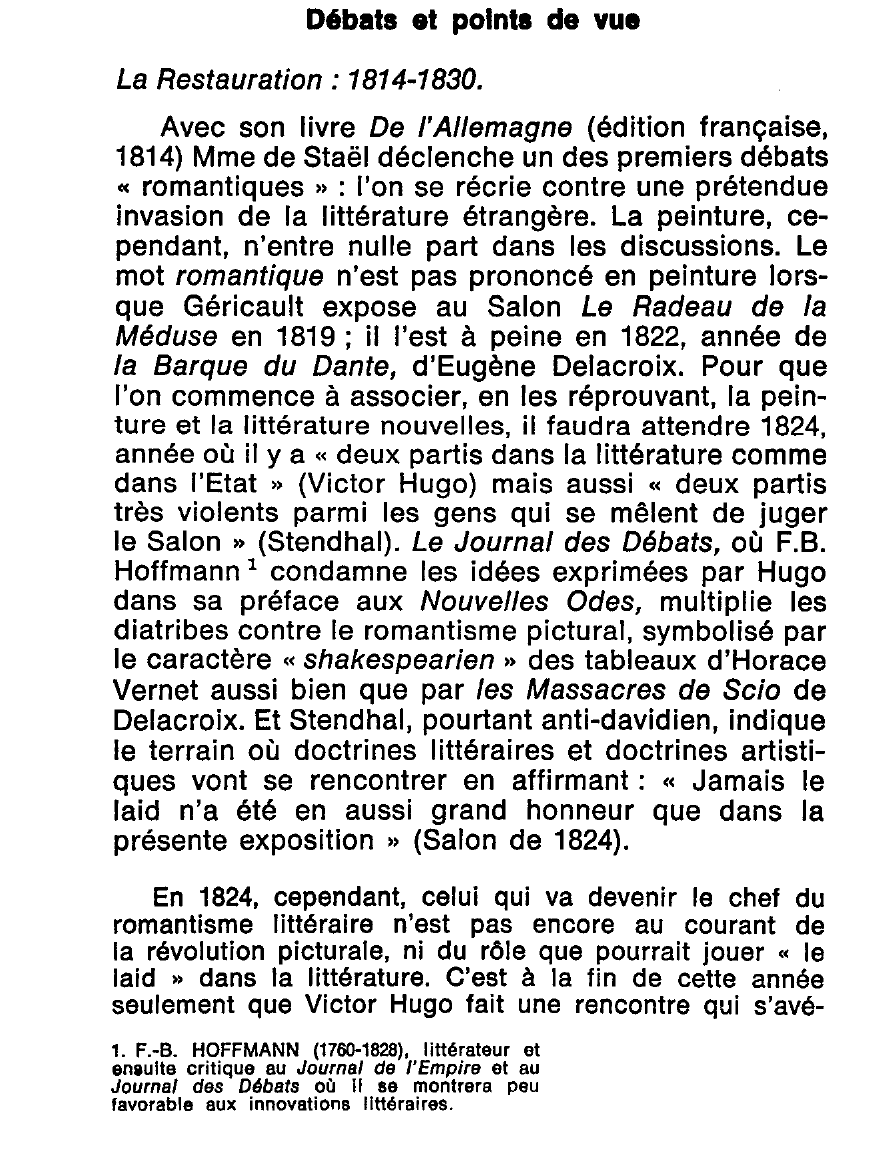LITIERATURE ET ARTS PLASTIQUES: LA «FRATERNITE DES ARTS»
Publié le 30/03/2012
Extrait du document
En ce temps-là, la peinture et la poésie fraternisaient. Théophile Gautier énonce ainsi, dans l'Histoire du romantisme, l'un de ses thèmes préférés. Mais que veut dire au juste sa phrase ? Si l'on ne considère que ses écrits historiques ou critiques, la fraternité, pour Gautier, semble revêtir trois aspects : des vocations doubles comme la sienne (Louis Boulanger et Euqène Déveria rimaient ; Musset, lui aussi, avait débuté par la peinture) ; des fréquentations entre peintres et écrivains aux Cénacles et dans les ateliers (chez Nodier, à l'Arsenal, chez les frères Devéria, rue de l'Ouest, ou chez Hugo, rue Notre-Dame-des-Champs) ; et le recours des artistes aux sujets tirés de la littérature (« On trouvait Shakespeare, Goethe, Lord Byron et Walter Scott dans l'atelier comme dans le cabinet d'études «). Rien de très précis pour ce qui est de la littérature française de cette époque. Gautier, en tant qu'historien de cette fraternité dont il a pourtant créé la légende est d'autant plus décevant que sa poésie en indique un autre aspect capital : l'inspiration que l'écrivain peut tirer de sources picturales. Sans doute Gautier n'est-il pas le seul à évoquer les rapports entre les deux arts, mais son témoignage est significatif parce que justement le thème a pour lui une grande importance et qu'à l'instar de tous les autres contemporains, il n'en analyse pas précisément le contenu...
«
Débats et pointa de vue
La Restauration: 1814-1830.
Avec son livre De l'Allemagne (édition française,
1814) Mme de Staël déclenche un des premiers débats
« romantiques " : l'on se récrie contre une prétendue
invasion de
la littérature étrangère.
La peinture, ce
pendant, n'entre
nulle part dans les discussions.
Le
mot
romantique n'est pas prononcé en peinture lors
que Géricault expose
au Salon Le Radeau de la
Méduse
en 1819; il l'est à peine en 1822, année de
la Barque du Dante, d'Eugène Delacroix.
Pour que
l'on commence
à associer, en les réprouvant, la pein
ture et
la littérature nouvelles, il faudra attendre 1824,
année où il y a '' deux partis dans la littérature comme
dans
l'Etat " (Victor Hugo) mais aussi « deux partis
très violents parmi
les gens qui se mêlent de juger
le Salon " (Stendhal).
Le Journal des Débats, où F.B.
Hoffmann 1 condamne les idées exprimées par Hugo
dans sa préface aux
Nouvelles Odes, multiplie les
diatribes contre le romantisme pictural, symbolisé par
le caractère « shakespearien " des tableaux d'Horace
Vernet aussi bien que par /es Massacres
de Scio de
Delacroix.
Et
Stendhal, pourtant anti-davidien, indique
le terrain où doctrines littéraires et doctrines artisti
ques vont
se rencontrer en affirmant : « Jamais le
laid n'a été en aussi grand honneur que dans la
présente exposition " (Salon de 1824).
En 1824, cependant, celui qui va devenir le chef du romantisme littéraire n'est pas encore au courant de la révolution picturale, ni du rôle que pourrait jouer « le laid » dans la littérature.
C'est à la fin de cette année seulement que Victor Hugo fait une rencontre qui s'avé-
1.
F.-B.
HOFFMANN (1760-1828), littérateur et enaulte critique au Journal de l'Empire et au Journal des D6bats où Il se montrera peu favorable aux innovations littéraires..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- PROBLÈME DE LA FORME DANS LES ARTS PLASTIQUES (Le) Adolf Hildebrand (résumé et analyse de l’oeuvre)
- land art - arts plastiques.
- Weiner, Lawrence - arts plastiques.
- Vostell, Wolf - arts plastiques.
- Viola, Bill - arts plastiques.