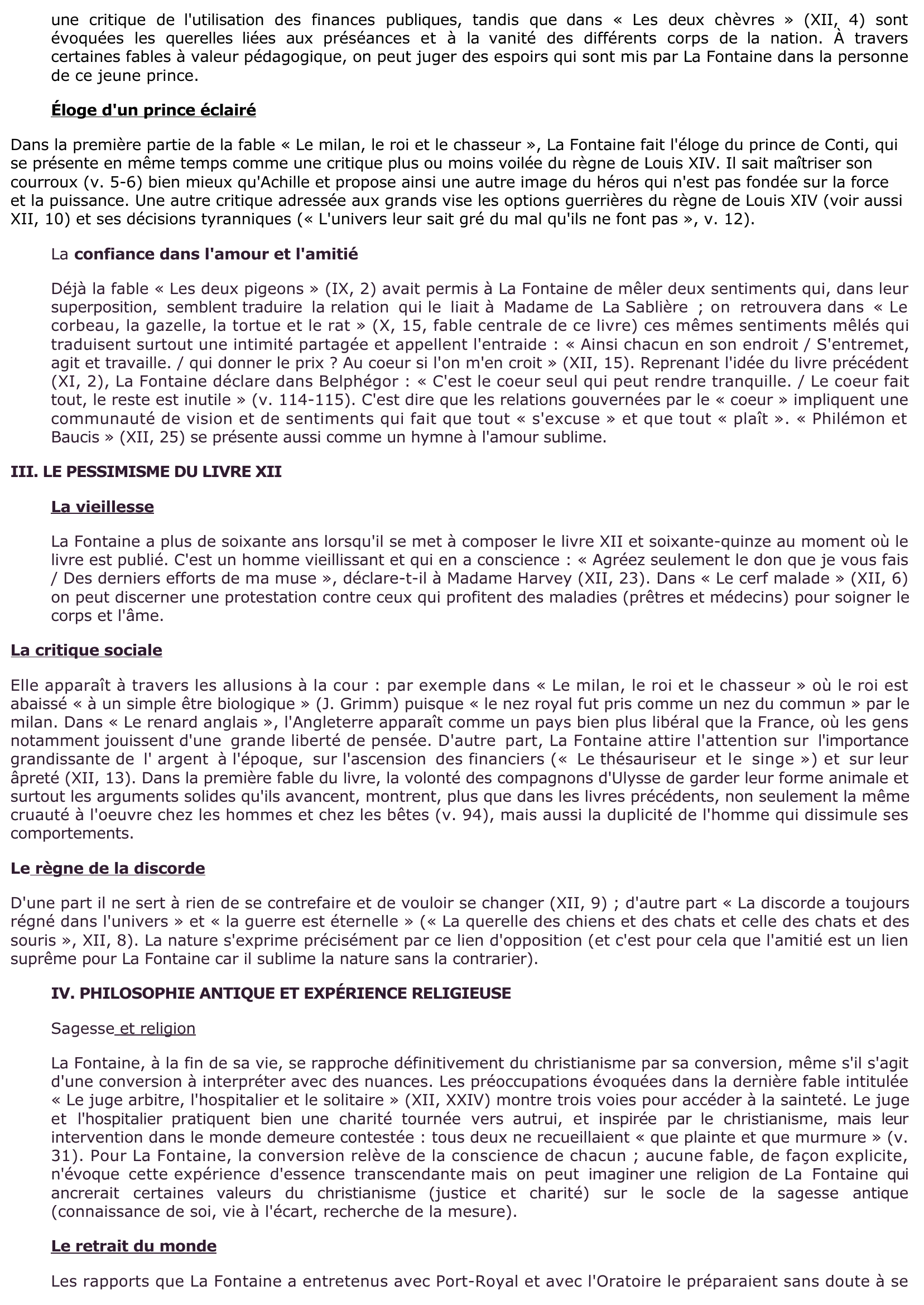Livre XII des Fables de La Fontaine
Publié le 17/01/2022

Extrait du document
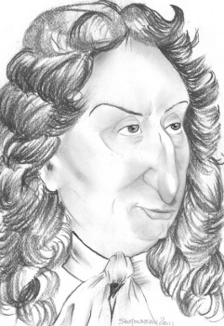
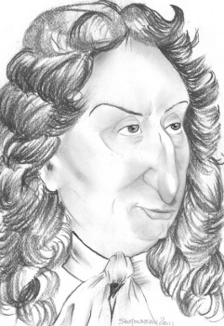
«
une critique de l'utilisation des finances publiques, tandis que dans « Les deux chèvres » (XII, 4) sontévoquées les querelles liées aux préséances et à la vanité des différents corps de la nation.
À traverscertaines fables à valeur pédagogique, on peut juger des espoirs qui sont mis par La Fontaine dans la personnede ce jeune prince.
Éloge d'un prince éclairé
Dans la première partie de la fable « Le milan, le roi et le chasseur », La Fontaine fait l'éloge du prince de Conti, quise présente en même temps comme une critique plus ou moins voilée du règne de Louis XIV.
Il sait maîtriser soncourroux (v.
5-6) bien mieux qu'Achille et propose ainsi une autre image du héros qui n'est pas fondée sur la forceet la puissance.
Une autre critique adressée aux grands vise les options guerrières du règne de Louis XIV (voir aussiXII, 10) et ses décisions tyranniques (« L'univers leur sait gré du mal qu'ils ne font pas », v.
12).
La confiance dans l'amour et l'amitié
Déjà la fable « Les deux pigeons » (IX, 2) avait permis à La Fontaine de mêler deux sentiments qui, dans leursuperposition, semblent traduire la relation qui le liait à Madame de La Sablière ; on retrouvera dans « Lecorbeau, la gazelle, la tortue et le rat » (X, 15, fable centrale de ce livre) ces mêmes sentiments mêlés quitraduisent surtout une intimité partagée et appellent l'entraide : « Ainsi chacun en son endroit / S'entremet,agit et travaille.
/ qui donner le prix ? Au coeur si l'on m'en croit » (XII, 15).
Reprenant l'idée du livre précédent(XI, 2), La Fontaine déclare dans Belphégor : « C'est le coeur seul qui peut rendre tranquille.
/ Le coeur faittout, le reste est inutile » (v.
114-115).
C'est dire que les relations gouvernées par le « coeur » impliquent unecommunauté de vision et de sentiments qui fait que tout « s'excuse » et que tout « plaît ».
« Philémon etBaucis » (XII, 25) se présente aussi comme un hymne à l'amour sublime.
III.
LE PESSIMISME DU LIVRE XII
La vieillesse
La Fontaine a plus de soixante ans lorsqu'il se met à composer le livre XII et soixante-quinze au moment où lelivre est publié.
C'est un homme vieillissant et qui en a conscience : « Agréez seulement le don que je vous fais/ Des derniers efforts de ma muse », déclare-t-il à Madame Harvey (XII, 23).
Dans « Le cerf malade » (XII, 6)on peut discerner une protestation contre ceux qui profitent des maladies (prêtres et médecins) pour soigner lecorps et l'âme.
La critique sociale
Elle apparaît à travers les allusions à la cour : par exemple dans « Le milan, le roi et le chasseur » où le roi estabaissé « à un simple être biologique » (J.
Grimm) puisque « le nez royal fut pris comme un nez du commun » par lemilan.
Dans « Le renard anglais », l'Angleterre apparaît comme un pays bien plus libéral que la France, où les gensnotamment jouissent d'une grande liberté de pensée.
D'autre part, La Fontaine attire l'attention sur l'importancegrandissante de l' argent à l'époque, sur l'ascension des financiers (« Le thésauriseur et le singe ») et sur leurâpreté (XII, 13).
Dans la première fable du livre, la volonté des compagnons d'Ulysse de garder leur forme animale etsurtout les arguments solides qu'ils avancent, montrent, plus que dans les livres précédents, non seulement la mêmecruauté à l'oeuvre chez les hommes et chez les bêtes (v.
94), mais aussi la duplicité de l'homme qui dissimule sescomportements.
Le règne de la discorde
D'une part il ne sert à rien de se contrefaire et de vouloir se changer (XII, 9) ; d'autre part « La discorde a toujoursrégné dans l'univers » et « la guerre est éternelle » (« La querelle des chiens et des chats et celle des chats et dessouris », XII, 8).
La nature s'exprime précisément par ce lien d'opposition (et c'est pour cela que l'amitié est un liensuprême pour La Fontaine car il sublime la nature sans la contrarier).
IV.
PHILOSOPHIE ANTIQUE ET EXPÉRIENCE RELIGIEUSE
Sagesse et religion
La Fontaine, à la fin de sa vie, se rapproche définitivement du christianisme par sa conversion, même s'il s'agitd'une conversion à interpréter avec des nuances.
Les préoccupations évoquées dans la dernière fable intitulée« Le juge arbitre, l'hospitalier et le solitaire » (XII, XXIV) montre trois voies pour accéder à la sainteté.
Le jugeet l'hospitalier pratiquent bien une charité tournée vers autrui, et inspirée par le christianisme, mais leurintervention dans le monde demeure contestée : tous deux ne recueillaient « que plainte et que murmure » (v.31).
Pour La Fontaine, la conversion relève de la conscience de chacun ; aucune fable, de façon explicite,n'évoque cette expérience d'essence transcendante mais on peut imaginer une religion de La Fontaine quiancrerait certaines valeurs du christianisme (justice et charité) sur le socle de la sagesse antique(connaissance de soi, vie à l'écart, recherche de la mesure).
Le retrait du monde
Les rapports que La Fontaine a entretenus avec Port-Royal et avec l'Oratoire le préparaient sans doute à se.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- « Les longs ouvrages me font peur», écrit La Fontaine dans l'Épilogue du Livre VI. A la lumière des fables contenues dans les Livres VII à XII, vous direz en quoi cette confidence du fabuliste éclaire son art poétique. ?
- Lecture Analytique : La Fontaine, ''Le philosophe scythe'' Fables - Livre XII, Fable 20
- Livre XII des Fables de La Fontaine
- Dissertation Fables de La Fontaine (livre VII)
- SYNTHESE FABLES DE LA FONTAINE - LIVRES VII-XII