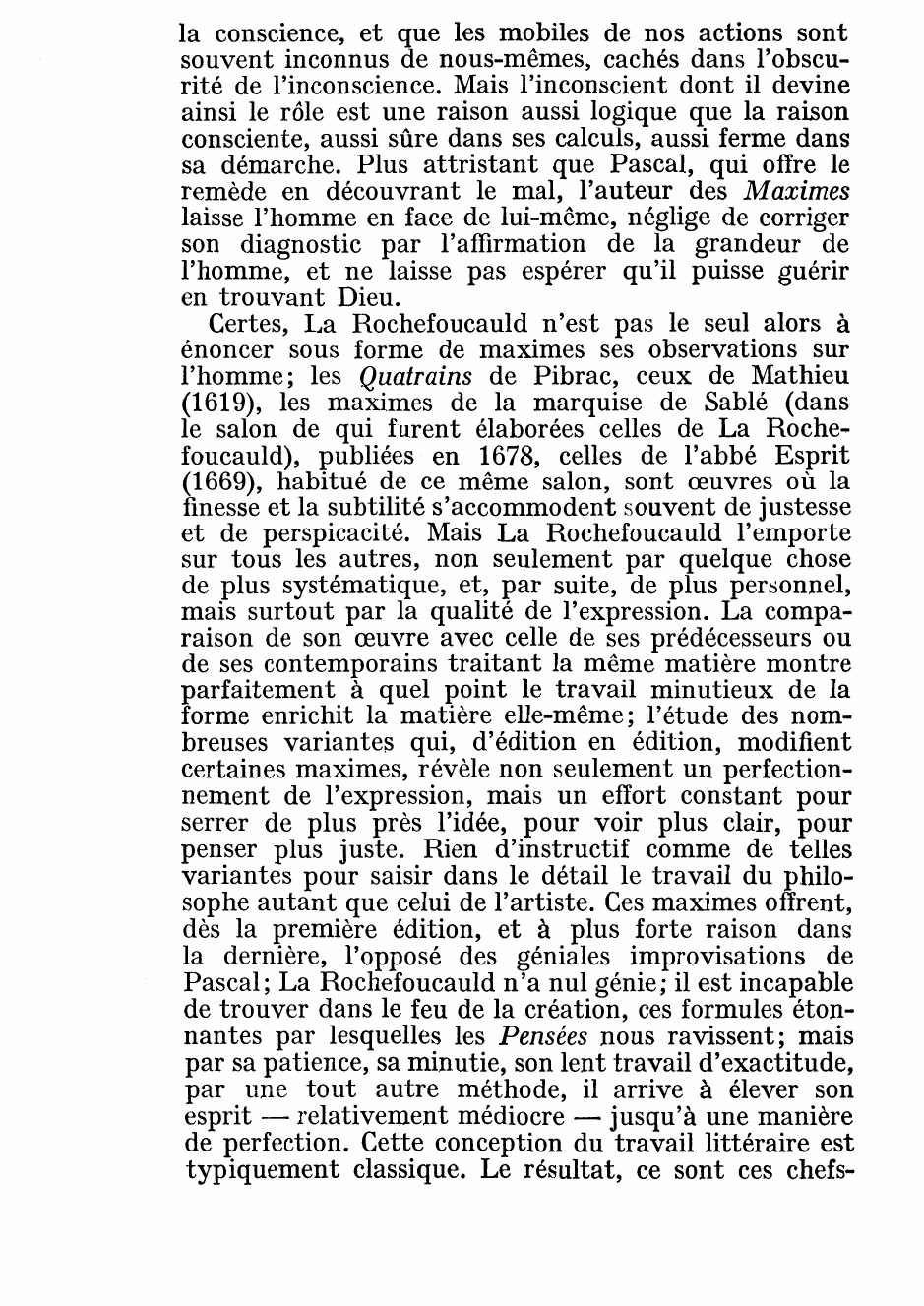L'oeuvre de La Rochefoucauld
Publié le 27/06/2012

Extrait du document

Au moment même où Pascal éclaire de sa pénétrante lumière le coeur humain pour y chercher l'angoisse et le besoin de Dieu, à l'autre extrémité de la société, un grand seigneur, La Rochefoucauld (1613-1680), désabusé de l'homme après une vie remplie d'aventures éclatantes et d'échecs, élaborait, dans la vanité d'un salon mondain, des Maximes dont le pessimisme devait faire aussitôt réclamer l'auteur comme un des leurs par les jansénistes. Les Réflexions ou Sentences et Maximes morales, élaborées de 1656 à 1665, parurent à cette dernière date; cinq éditions se succédèrent jusqu'à 1678, régulièrement augmentées,

«
160 HISTOIRE DE LA LITTÉRATURE
la conscience, et que les mobiles de nos actions sont
souvent inconnus de nous-mêmes, cachés dans l'obscu
rité de l'inconscience.
Mais l'inconscient dont il devine
ainsi le rôle est une raison aussi logique que la raison
consciente, aussi sûre dans ses calculs, aussi ferme dans
sa démarche.
Plus attristant que Pascal, qui offre le
remède en découvrant le mal, l'auteur des Maximes laisse l'homme en face de lui-même, néglige de corriger
son diagnostic par l'affirmation de la grandeur de
l'homme, et ne laisse pas espérer qu'il puisse guérir
en trouvant Dieu.
Certes, La Rochefoucauld n'est pas le seul alors à
énoncer sous forme de maximes ses observations sur
l'homme; les
Quatrains de Pibrac, ceux de Mathieu
(1619), les maximes de la marquise de Sablé (dans
le salon de qui furent élaborées celles de
La Roche
foucauld), publiées en 1678, celles de l'abbé Esprit (1669), habitué de ce même salon, sont œuvres où la
finesse et la subtilité s'accommodent souvent de justesse et de perspicacité.
Mais La Rochefoucauld l'emporte
sur tous les autres, non seulement par quelque chose
de plus systématique, et, par suite, de plus personnel, mais surtout par la qualité de l'expression.
La compa
raison de son œuvre avec celle de ses prédécesseurs ou
de ses contemporains
traitant la même matière montre parfaitement à quel point le travail minutieux de la forme enrichit la matière elle-même; l'étude des nom
breuses variantes qui, d'édition en édition, modifient
certaines maximes, révèle non seulement un perfection
nement de l'expression, mais
un effort constant pour
serrer de plus près l'idée, pour voir plus clair, pour
penser plus juste.
Rien d'instructif comme de telles
variantes pour saisir dans le détail le
travail du philo
sophe autant que celui de l'artiste.
Ces maximes offrent,
dès la première édition, et à plus forte raison dans
la dernière, l'opposé des géniales improvisations de
Pascal;
La Rochefoucauld n'a nul génie; il est incapable
de trouver dans le feu de la création, ces formules éton
nantes par lesquelles les Pensées nous ravissent; mais par sa patience, sa minutie, son lent travail d'exactitude, par une tout autre méthode, il arrive à élever son
esprit -relativement médiocre -jusqu'à une manière
de perfection.
Cette conception du travail littéraire est typiquement classique.
Le résultat, ce sont ces chefs-.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Réflexions ou Sentences et MAXIMES MORALES, duc de La Rochefoucauld (résumé et analyse de l'oeuvre)
- L'OEUVRE DE LA ROCHEFOUCAULD
- L'oeuvre d'art est-elle l'oeuvre d'un génie? (plan)
- les contemplations d'Hugo (résumé et analyse de l'oeuvre)
- VICTOR HUGO (oeuvre)