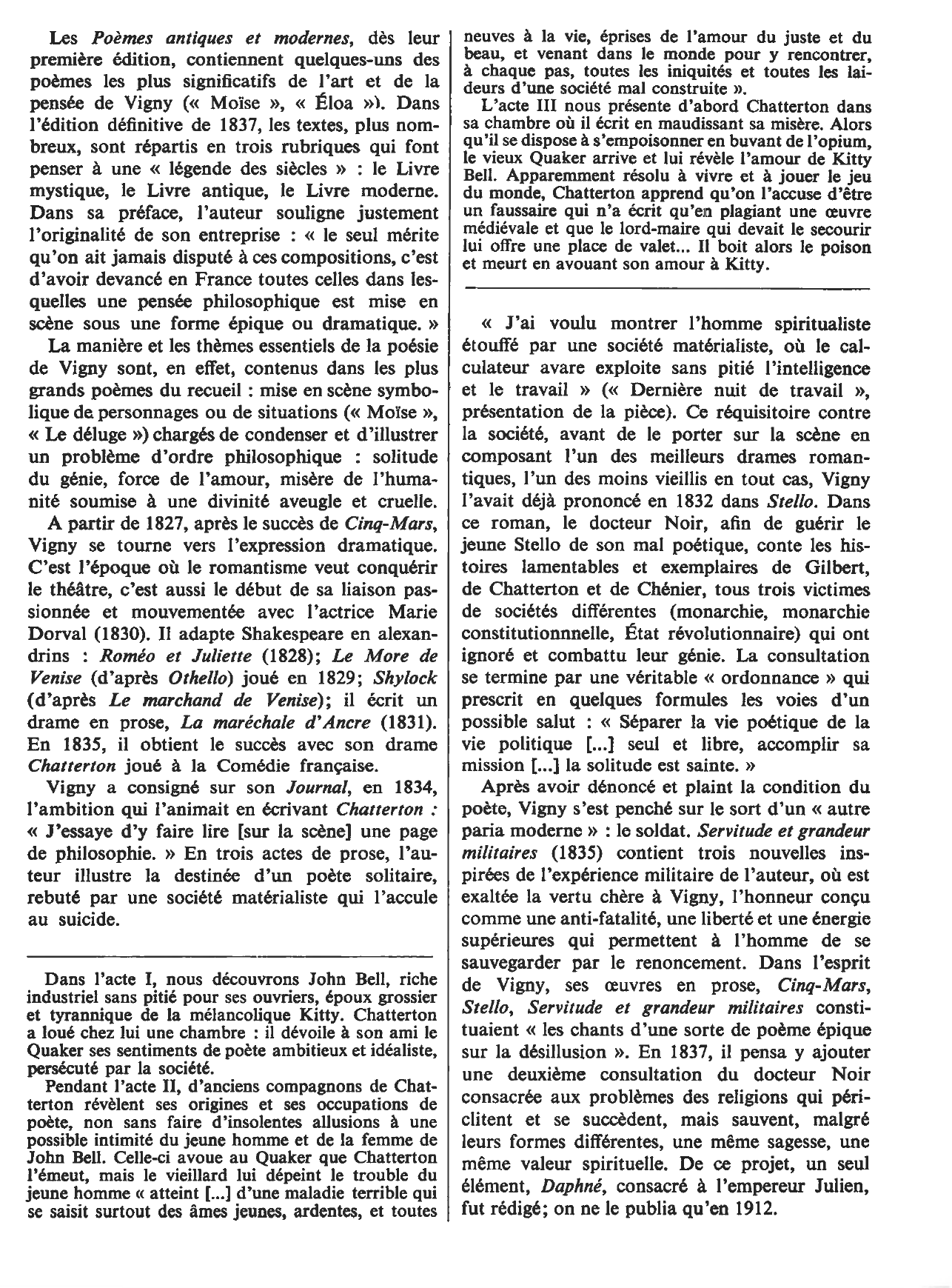L'oeuvre de Vigny
Publié le 04/04/2012

Extrait du document
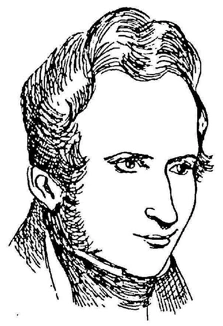
POÈMES
POÈMES (1822)
POÈMES ANTIQUES ET MODERNES (1826)
POÈMES (1829 et 1837) :
HÉLÉNA
MOÏSE
ELOA
LE DÉLUGE
LA FILLE DE JEPHTÉ
SYMÉTHA
LA NEIGE
LE COR
DOLORIDA
LA PRISON
LA FRÉGATE “ LA SÉRIEUSE ”
PARIS ‑ ÉLÉVATION, etc.
LES DESTINÉES,
“ POÈMES PHILOSOPHIQUES ”
(1864) :
LES DESTINÉES
LA MAISON DU BERGER
LES ORACLES
LA SAUVAGE
LA COLÈRE DE SAMSON
LA MORT DU LOUP
LA FLUTE
LE MONT DES OLIVIERS
LA BOUTEILLE A LA MER
WANDA
L'ESPRIT PUR
THÉATRE
LE MORE DE VENISE, OTHELLO (1830)
LA MARÉCHALE D'ANCRE, drame (1831)
CHATTERTON, drame (1835)
SHYLOCK (1839)
QUITTE POUR LA PEUR, proverbe (1833)
ROMANS
CINQ‑MARS (1826)
STELLO, LES CONSULTATIONS DU DOCTEUR NOIR (1832)
SERVITUDE ET GRANDEUR MILITAIRES (1835)
DAPHNÉ, DEUXIÈME CONSULTATION DU DOCTEUR NOIR (1912)
ŒUVRES DIVERSES
DE MADEMOISELLE SEDAINE ET DE LA PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE (1841)
DISCOURS DE RÉCEPTION A L'ACADÉMIE FRANÇAISE (1846)
JOURNAL D'UN POÈTE (1867)
CORRESPONDANCE
LETTRES
A ED. DELPRAT, AU MARQUIS ET A LA MARQUISE DE LA GRANGE, A BARBIER, A HUGO,
A LA DUCHESSE DE MAILLÉ, A BRIZEUX, A LA COMTESSE D AGOULT, etc.
CORRESPONDANCE (1905‑1914)
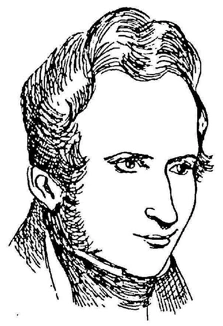
«
Les Poèmes antiques et modernes, dès leur
première édition, contiennent quelques-uns des
poèmes les plus significatifs de 1 'art et de la
pensée
de Vigny (« Moïse », « Éloa »).
Dans
l'édition définitive de 1837, les textes , plus nom
breux , sont répartis en trois rubriques qui font
penser à une « légende des siècles » : le Livre
mystique, le Livre antique, le Livre moderne.
Dans sa préface, 1 'auteur souligne justement
l'originalité de son entreprise : « le seul mérite
qu 'on ait jamais disputé à ces compositions, c'est
d'avoir devancé en France toutes celles dans les
quelles une pensée philosophique est mise en
scène sous une forme épique ou dramatique.
»
La manière et les thèmes essentiels de la poésie
de Vigny sont, en effet, contenus dans les plus
grands poèmes du recueil : mise en scène symbo
lique de personnages ou de situations (« Moïse »,
« Le déluge »)chargés de condenser et d'illustrer
un problème d'ordre philosophique : solitude
du génie, force de l'amour, misère de l'huma
nité soumise à une divinité aveugle et cruelle.
A
partir de 1827, après le succès de Cinq-Mars,
Vigny se tourne vers 1 'expression dramatique.
C'est l'époque où le romantisme veut conquérir
le théâtre, c'est aussi le début de sa liaison pas
sionnée et mouvementée avec l 'actrice Marie
Dorval (1830).
Il adapte Shakespeare en alexan
drins : Rom éo et Juliette (1828); Le More de
Venise (d'après Othello) joué en 1829; Shylock
(d'après Le marchand de Venise); il écrit un
drame en prose, La maréchale d'Ancre (1831).
En 1835, il obtient le succès avec son drame
Chatterton joué à la Comédie française.
Vigny a
consigné sur son Journal, en 1834,
l'ambition qui l'animait en écrivant Chatterton :
« J'essaye d'y faire lire [sur la scène] une page
de philosophie.
» En trois actes de prose, 1 'au
teur illustre la destinée d'un poète solitaire,
rebuté par une société matérialiste qui 1 'accule
au suicide.
Dans l'acte
1, nous découvrons John Bell, riche
industriel sans pitié pour ses ouvriers, époux grossier
et tyrannique de la mélancolique Kitty.
Chatterton
a loué chez lui une chambre :
il dévoile à son ami le Quaker ses sentiments de poète ambitieux et idéaliste,
persécuté par la société.
Pendant l'acte II, d'anciens compagnons de Chat terton révèlent ses origines et ses occupations de
poète, non sans faire d'insolentes allusions à une
possible intimité du jeune homme et de la femme de
John Bell.
Celle-ci avoue au Quaker que Chatterton
l'émeut, mais le vieillard lui dépeint
le trouble du
jeune homme cc atteint[ ...
] d'une maladie terrible qui
se saisit surtout des âmes jeunes, ardentes, et toutes neuves
à la
vie, éprises de l'amour du juste et du
beau, et venant dans le monde pour y rencontrer,
à chaque pas, toutes les iniquités et toutes les lai deurs d'une société mal construite JJ.
L'acte III nous présente d'abord Chatterton dans
sa chambre où il écrit en maudissant sa misère.
Alors
qu'il se dispose à s'empoisonner en buvant de l'opium, Je vieux Quaker arrive et lui révèle l'amour de Kitty
Bell.
Apparemment résolu à vivre et à jouer Je jeu
du monde, Chatterton apprend qu'on l'accuse d'être un faussaire qui n'a écrit qu'en plagiant une œuvre
médiévale et que le lord-maire qui devait Je secourir
lui offre une place de valet...
Il boit alors le poison
et meurt en avouant son amour à Kitty.
« J'ai voulu montrer l'homme spiritualiste
étouffé par une société matérialiste, où le cal
culateur avare exploite sans pitié l'intelligence
et le travail
» (« Dernière nuit de travail »,
présentation de la pièce).
Ce réquisitoire contre
la société, avant de le porter sur la scène en
composant 1 'un des meilleurs drames roman
tiques, l'un des moins vieillis en tout cas, Vigny
l'avait déjà prononcé en 1832 dans Stella.
Dans
ce roman, le docteur Noir, afin de guérir le
jeune Stello de son mal poétique, conte les his
toires lamentables et exemplaires de Gilbert,
de Chatterton et de Chénier, tous trois victimes
de sociétés différentes
(monarchie, monarchie
constitutionnnelle, État révolutionnaire) qui ont
ignoré et combattu leur génie.
La consultation
se termine par une véritable « ordonnance » qui
prescrit en quelques formules les voies d'un
possible salut : « Séparer la vie poétique de la
vie politique [ ...
] seul et libre, accomplir sa
mission [ ...
] la solitude est sainte.
»
Après avoir dénoncé et plaint la condition du
poète, Vigny s'est penché sur le sort d'un « autre
paria moderne » : le soldat.
S ervitude et grandeur
militaires
(1835) contient trois nouvelles ins
pirées de l 'expérie nce militaire de l 'auteur, où est
exaltée la
vertu chère à Vigny, l 'honneur conçu
comme une anti-fatalité, une liberté et une énergie
supérieures qui permettent à l'homme de se
sauvegarder par le renoncement.
Dans 1 'espri t
de Vigny, ses œuvres
en prose, Cinq-Mars,
Stello, Servitude et grandeur militaires consti
tuaient « les chants d'une sorte de poème épique
sur la désillusion».
En 1837, il pensa y ajouter
une deuxième consultation du docteur Noir
consacrée aux problèmes des religions qui péri
clitent et se succèdent, mais sauvent, malgré
leurs formes différentes, une même sagesse, une
même valeur spiritue lle.
De ce projet, un seul
élément,
Daphné, consacré à l 'empere ur Julien,
fut
rédigé; on ne le publia qu'en 1912..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- CHATTERTON Alfred de Vigny - résumé de l'oeuvre
- VIGNY Alfred Victor, comte de : sa vie et son oeuvre
- L'oeuvre d'A. de Vigny correspond-elle à cette définition de Sully Prudhomme : « Il me semble qu'il n'y a dans le domaine de la pensée rien de si haut et de si profond à qui le poète n'ait mission d'intéresser le coeur » ?
- L'oeuvre d'A. de Vigny correspond-elle à cette définition de Sully Prudhomme : « Il me semble qu'il n'y a dans le domaine de la pensée rien de si haut et de si profond à qui le poète n'ait mission d'intéresser le coeur » ?
- Alfred de Vigny a écrit (Journal d'un Poète) : « Les animaux lâches vont en troupes. — Le Lion marche seul dans le désert. Qu'ainsi marche toujours le Poète. » Qu'y a-t-il de romantique dans cette conception ? Quelle place tient-elle dans l'oeuvre de Vigny ? Qu'est-ce qui,dans cette oeuvre, corrige et atténue l'orgueilleuse dureté de cette idée ?