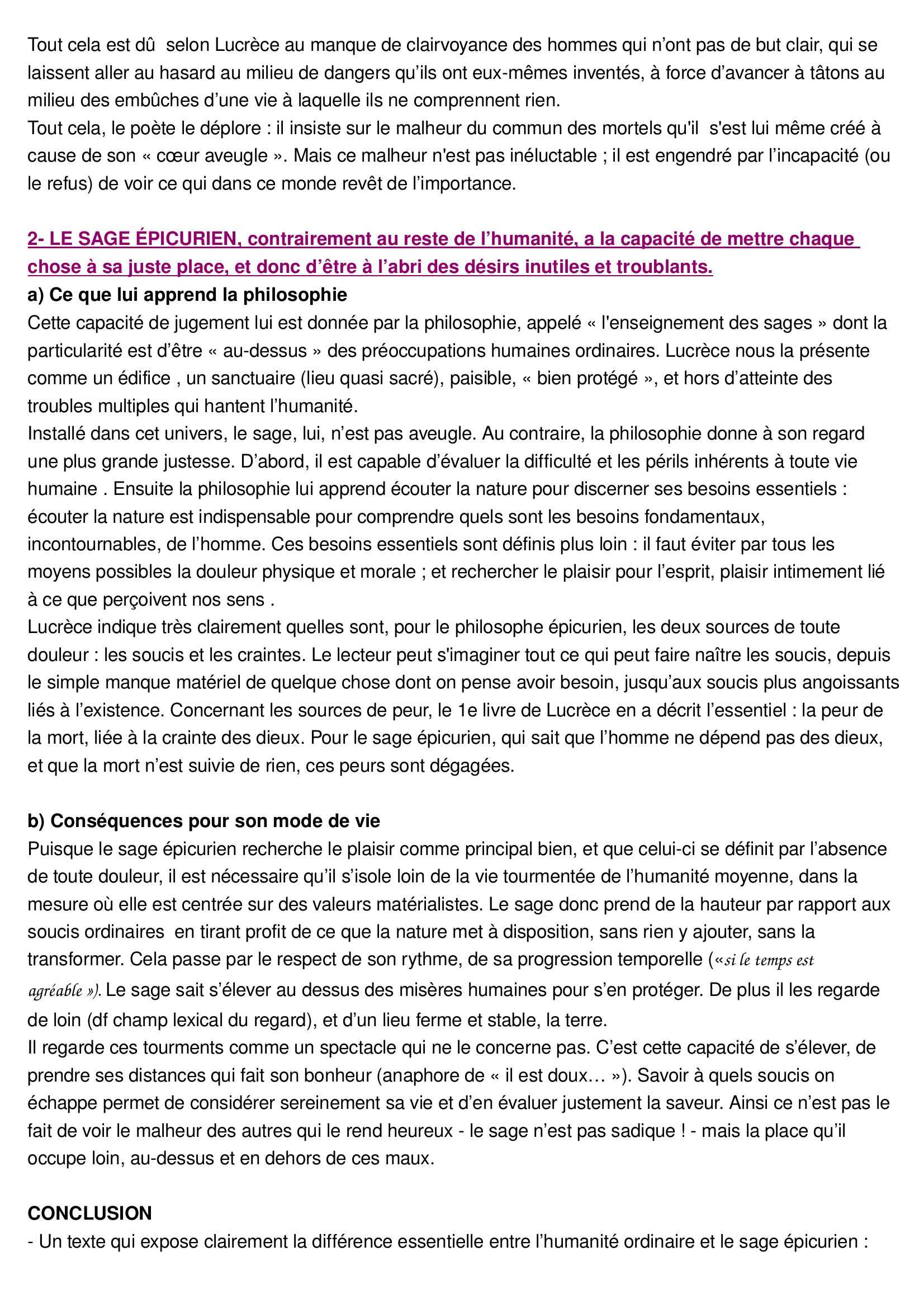lucrèce
Publié le 20/06/2014

Extrait du document
«
Tout cela est dû selon Lucr èce au manque de clairvoyance des hommes qui n’ont pas de but clair, qui se
laissent aller au hasard au milieu de dangers qu’ils ont euxm
êmes invent és, à force d’avancer à tâtons au
milieu des emb
ûches d’une vie à laquelle ils ne comprennent rien.
Tout cela, le po
ète le d éplore : il insiste sur le malheur du commun des mortels qu'il s'est lui m ême cr éé à
cause de son « cœur aveugle ». Mais ce malheur n'est pas in
éluctable ; il est engendr é par l’incapacit é (ou
le refus) de voir ce qui dans ce monde rev
êt de l’importance.
2 LE SAGE
ÉPICURIEN, contrairement au reste de l’humanit é, a la capacit é de mettre chaque
chose
à sa juste place, et donc d’ être à l’abri des d ésirs inutiles et troublants.
a) Ce que lui apprend la philosophie
Cette capacit
é de jugement lui est donn ée par la philosophie, appel é « l'enseignement des sages » dont la
particularit
é est d’ être « audessus » des pr éoccupations humaines ordinaires. Lucr èce nous la pr ésente
comme un
édifice , un sanctuaire (lieu quasi sacr é), paisible, « bien prot égé », et hors d’atteinte des
troubles multiples qui hantent l’humanit
é.
Install
é dans cet univers, le sage, lui, n’est pas aveugle. Au contraire, la philosophie donne à son regard
une plus grande justesse. D’abord, il est capable d’
évaluer la difficult é et les p érils inh érents à toute vie
humaine . Ensuite la philosophie lui apprend
écouter la nature pour discerner ses besoins essentiels :
é
couter la nature est indispensable pour comprendre quels sont les besoins fondamentaux,
incontournables, de l’homme. Ces besoins essentiels sont d
éfinis plus loin : il faut éviter par tous les
moyens possibles la douleur physique et morale ; et rechercher le plaisir pour l’esprit, plaisir intimement li
é
à
ce que per çoivent nos sens .
Lucr
èce indique tr ès clairement quelles sont, pour le philosophe épicurien, les deux sources de toute
douleur : les soucis et les craintes. Le lecteur peut s'imaginer tout ce qui peut faire na
ître les soucis, depuis
le simple manque mat
ériel de quelque chose dont on pense avoir besoin, jusqu’aux soucis plus angoissants
li
és à l’existence. Concernant les sources de peur, le 1e livre de Lucr èce en a d écrit l’essentiel : la peur de
la mort, li
ée à la crainte des dieux. Pour le sage épicurien, qui sait que l’homme ne d épend pas des dieux,
et que la mort n’est suivie de rien, ces peurs sont d
égag ées.
b) Cons
équences pour son mode de vie
Puisque le sage
épicurien recherche le plaisir comme principal bien, et que celuici se d éfinit par l’absence
de toute douleur, il est n
écessaire qu’il s’isole loin de la vie tourment ée de l’humanit é moyenne, dans la
mesure o
ù elle est centr ée sur des valeurs mat érialistes. Le sage donc prend de la hauteur par rapport aux
soucis ordinaires en tirant profit de ce que la nature met
à disposition, sans rien y ajouter, sans la
transformer. Cela passe par le respect de son rythme, de sa progression temporelle (« si le temps est
agr
éable »).
Le sage sait s’ élever au dessus des mis ères humaines pour s’en prot éger. De plus il les regarde de loin (df champ lexical du regard), et d’un lieu ferme et stable, la terre. Il regarde ces tourments comme un spectacle qui ne le concerne pas. C’est cette capacit é de s’ élever, de prendre ses distances qui fait son bonheur (anaphore de « il est doux… »). Savoir à quels soucis on é chappe permet de consid érer sereinement sa vie et d’en évaluer justement la saveur. Ainsi ce n’est pas le fait de voir le malheur des autres qui le rend heureux le sage n’est pas sadique ! mais la place qu’il occupe loin, audessus et en dehors de ces maux. CONCLUSION Un texte qui expose clairement la diff érence essentielle entre l’humanit é ordinaire et le sage épicurien : . »
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- NATURE DES CHOSES (DE LA), De natura rerum. Lucrèce - résumé de l'oeuvre
- Le personnage de BORGIA Lucrèce de Victor Hugo
- LUCRÈCE ou l'Adultère puni d'Alexandre Hardy (analyse détaillée)
- Le personnage de LUCRÈCE
- NATURE (De la) de Lucrèce (résumé de l’oeuvre)